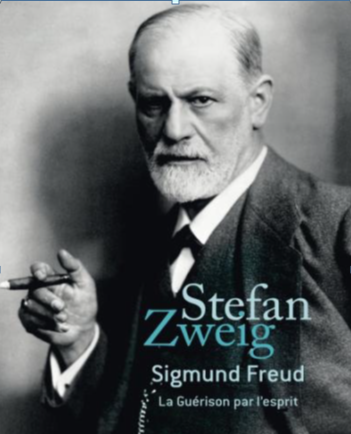
Sigmund
Freud
La guérison par l’esprit
Stefan
Zweig
Table des matières
I : La situation au tournant du siècle
II : Portrait caractérologique
IV : Le monde de l’inconscient
VI : La technique de la psychanalyse
VIII : Regard crépusculaire au loin
Introduction
Chaque trouble de la nature
est le rappel d’une patrie plus haute.
Novalis
La
santé, pour l’homme, est une chose naturelle, la maladie une chose
antinaturelle. Le corps en jouit aussi naturellement que le poumon jouit de
l’air et l’oeil de la lumière. La santé vit et croît
silencieusement en l’homme en même temps que le sentiment général de la vie. La
maladie, au contraire, s’introduit subitement en lui comme une étrangère, se
rue à l’improviste sur l’âme effrayée et agite en elle une foule de questions.
Car puisque cet ennemi inquiétant vient du dehors, qui l’a envoyé ? Se
maintiendra-t-il, se retirera-t-il ? Peut-on le conjurer, l’implorer ou le
maîtriser ? Les griffes aiguës de la maladie suscitent au cœur de l’homme les
sentiments les plus opposés : crainte, confiance, espérance, résignation, malédiction,
humilité et désespoir. La maladie pousse le malade à questionner, à penser et à
prier, à lever dans le vide son regard épouvanté et à inventer un être vers qui
il puisse se tourner dans son angoisse. C’est la souffrance tout d’abord qui a
créé chez l’homme le sentiment de la religion, l’idée de Dieu.
La
santé étant l’état normal de l’homme ne s’explique pas et ne demande pas à être
expliquée. Mais tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa
souffrance. La maladie s’emparerait-elle de nous sans cause ? Notre corps
serait-il incendié par la fièvre sans faute de notre part, les fers brûlants de
la douleur fouailleraient-ils nos entrailles sans but et sans raison ?
Cette
idée effrayante de l’absurdité totale de la souffrance, chose qui suffirait
pour détruire l’ordre moral de l’univers, jamais l’humanité n’a osé la
poursuivre jusqu’au bout. La maladie lui paraît toujours envoyée par quelqu’un,
et l’être inconcevable qui l’envoie doit avoir ses raisons pour la faire
pénétrer précisément dans tel ou tel corps. Quelqu’un doit en vouloir à l’homme
qu’elle atteint, être irrité contre lui, le haïr. Quelqu’un veut le punir pour
une faute, pour une infraction, pour un commandement transgressé. Et ce ne peut
être que celui qui peut tout, celui qui fait éclater la foudre, qui répand sur
la terre le froid et la chaleur, qui allume ou voile les étoiles, LUI, le
Tout-Puissant : Dieu.
C’est
pourquoi, dès le début, le phénomène de la maladie est indissolublement lié au
sentiment religieux. Les dieux envoient la maladie, les dieux seuls peuvent la
faire partir : cette pensée se dresse, immuable, à l’aube de toute médecine.
Encore inconscient de son propre savoir, pauvre, impuissant, faible et solitaire,
l’homme primitif, en proie à l’aiguillon de la maladie, ne voit rien d’autre à
faire que d’élever son âme vers le dieu magicien, que de lui crier sa
souffrance, en le suppliant de l’en délivrer. Le seul remède qu’il connaisse
est l’invocation, la prière, le sacrifice.
On ne
peut pas se défendre contre Lui, le tout-puissant, l’invincible caché derrière
les ténèbres : il ne reste donc qu’à s’humilier, à implorer son pardon, à le
supplier de retirer la douleur qui tourmente la chair. Mais comment atteindre l’Invisible
? Comment parler à celui dont on ne connaît pas la demeure ? Comment lui donner
des preuves de son remords, de sa soumission, de sa volonté de sacrifice ?
Le malheureux l’ignore, comme il ignore tout. Dieu ne se révèle pas à lui ; il
ne se penche pas sur son humble existence, ne prête pas l’oreille à sa prière,
ne daigne pas lui donner de réponse. Alors, dans sa détresse, l’homme
impuissant et désemparé doit faire appel à un autre homme, plus sage, plus
expérimenté, qui connaît les formules magiques susceptibles de conjurer les
forces ténébreuses, d’apaiser les puissances irritées, pour servir d’intermédiaire
entre lui et Dieu. Et cet intermédiaire au temps des cultures primitives est toujours
le prêtre.
Lutter
pour la santé, aux premiers âges de l’humanité, ne signifie donc pas combattre
sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Toute médecine au début n’est que théologie,
culte, rite, magie, réaction psychique de l’homme devant l’épreuve envoyée par
Dieu. On oppose à la souffrance physique non pas une technique, mais un acte religieux.
On ne cherche pas à connaître la maladie, on cherche Dieu. On ne traite pas les
phénomènes de la douleur, mais on s’efforce de les expier, de les écarter par
la prière, de les racheter à Dieu par des serments, des cérémonies et des sacrifices,
car la maladie ne peut s’en aller que comme elle est venue : par voie
surnaturelle. Il n’y a qu’une santé et qu’une maladie et cette dernière n’a qu’une
cause et qu’un remède : Dieu. Entre Dieu et la souffrance il n’y a qu’un seul
et même intermédiaire : le prêtre, à la fois gardien de l’âme et du corps. Le monde
n’est pas encore divisé, partagé, la foi et la science n’ont pas cessé de se
confondre : on ne peut se délivrer de la douleur sans rite, prière ou
conjuration, sans faire entrer en jeu simultanément toutes les forces de l’âme.
C’est pourquoi les prêtres, maîtres des démons, confidents et interprétateurs
des rêves, eux qui sont renseignés sur la marche mystérieuse des astres, n’exercent
pas leur art médical comme une science pratique, mais exclusivement comme un
mystère religieux. Cet art qui ne s’apprend pas, qui ne se communique qu’aux initiés,
ils se le transmettent de génération en génération ; et, bien que l’expérience
leur ait beaucoup appris sous le rapport médical, jamais ils ne donnent de
conseil purement pratique : toujours ils exigent la guérison-miracle, des temples,
la foi et la présence des dieux. Le malade ne peut obtenir la guérison sans que
l’âme et le corps soient purifiés et sanctifiés ; les pèlerins qui se rendent
au temple d’Épidaure, voyage long et pénible, doivent passer la veille en prières,
se baigner, sacrifier chacun un animal, dormir dans la cour du temple sur la peau
du bélier immolé et conter au prêtre les rêves de la nuit afin qu’il les
interprète : alors seulement il leur accorde, en même temps que la bénédiction
religieuse, l’aide médicale. Mais le premier gage de toute guérison, le gage indispensable,
est l’élévation confiante de l’âme vers Dieu ; celui qui veut le miracle de la
santé doit s’y préparer. La doctrine médicale, à ses origines, est
indissolublement liée à la doctrine religieuse ; au commencement, la médecine
et la théologie ne font qu’un.
Cette
unité du début ne tarde pas à être brisée. Pour devenir indépendante et pour
pouvoir servir d’intermédiaire pratique entre la maladie et le malade, la
science doit dépouiller la souffrance de son origine divine et exclure comme superflues
les pratiques religieuses : prière, culte, sacrifice. Le médecin se dresse à
côté du prêtre et bientôt contre lui – la tragédie d’Empédocle – et en ramenant
le mal du domaine surnaturel dans la sphère des phénomènes naturels, il cherche
à éliminer le trouble de la nature au moyen de ses éléments extérieurs, ses
herbes, ses sucs et ses minéraux. Le prêtre se borne au culte et ne s’occupe
plus de soins médicaux ; le médecin renonce à toute influence psychique, au
culte et à la magie : les deux courants suivent désormais des voies distinctes.
Par
suite de cette grande rupture de l’ancienne unité, les éléments de la médecine acquièrent
immédiatement un sens et un aspect tout à fait nouveaux. En premier lieu, le
phénomène psychique général dénommé « maladie » se divise en d’innombrables
maladies isolées, déterminées, classées. Par là, son existence
en quelque sorte se sépare de la personnalité psychique de l’individu. La
maladie n’est plus un phénomène qui s’attaque à l’homme tout entier, mais
seulement à un de ses organes (Virchow, au congrès de Rome, dit : « Il n’y a
pas de maladies générales, mais seulement des maladies d’organes et de cellules
»). La mission originelle du médecin qui était de combattre la maladie en la traitant comme un tout, se transforme naturellement en
une tâche, au fond, plus médiocre : localiser tout mal et sa cause et le classer
dans une catégorie de maladies systématiquement décrites et déterminées. Dès
que le médecin a mené à bien son diagnostic et désigné la maladie, il a fait la
plupart du temps le principal, et le traitement se poursuit de lui-même par la «
thérapie » prescrite à l’avance pour ce « cas ».
La
médecine moderne, science établie sur la connaissance et entièrement détachée de
toute religion, de toute magie, s’appuie sur des certitudes absolues au lieu de
faire appel aux intuitions individuelles ; bien qu’elle prenne encore
volontiers le nom poétique d’« art médical », ce grand mot n’exprime plus
qu’une sorte de métier d’art. La médecine n’exige plus comme jadis de ses
disciples une prédestination sacerdotale ni des dons de visionnaire leur
permettant de communiquer avec les forces universelles de la nature : la vocation
est devenue métier ; la magie, système ; le mystère de la guérison,
connaissance des organes et science médicale. Une guérison ne s’accomplit plus
comme une action morale, un événement miraculeux, mais comme un fait purement raisonné
et calculé par le médecin ; la pratique remplace la spontanéité, le manuel, le
logos, la conjuration mystérieuse et créatrice. Là où l’ancienne méthode de
guérison magique réclamait la plus haute tension de l’âme, le clinicien a besoin
de toute sa lucidité et de tout son sang-froid.
Cet
acheminement inévitable des méthodes de guérison vers le matérialisme et le
professionnalisme devait atteindre au XIXe siècle un degré extraordinaire ;
entre le traitant et le traité intervient alors un troisième élément dépourvu
de vie : l’appareil. Le coup d’oeil du médecin-né,
qui embrasse tous les symptômes dans une synthèse créatrice, devient de moins
en moins indispensable à la diagnose : le microscope est là pour découvrir le germe
bactériologique, le cardiographe pour enregistrer les mouvements et le rythme
du cœur, les rayons Roentgen viennent remplacer la vision intuitive.
De
plus en plus, le laboratoire ravit au médecin ce que son métier avait encore de
personnel dans le domaine du diagnostic ; pour ce qui est du traitement, les
ateliers de chimie lui offrent le remède tout préparé, dosé et mis en boîte que
le guérisseur du Moyen Âge, lui, était obligé chaque fois de mesurer, calculer
et mélanger lui-même. La toute-puissance de la technique qui a envahi la
médecine – plus tard, il est vrai, que les autres domaines, mais qui a fini
quand même par s’y installer victorieusement – trace du processus de la
guérison un tableau admirablement nuancé ; peu à peu la maladie, jadis
considérée comme une irruption du surnaturel dans le monde individuel, devient
précisément le contraire de ce qu’elle était aux commencements de l’humanité :
un cas « ordinaire », « typique », au cours déterminé, à la durée calculée
d’avance, un problème résolu par la raison.
Cette
rationalisation à l’intérieur est puissamment complétée par l’organisation
extérieure ; dans les hôpitaux, ces magasins généraux de misère humaine, les
maladies sont classées par catégories avec leurs spécialistes et les médecins
n’y traitent plus que des « cas », n’examinent plus, généralement, que l’organe
malade, sans même jeter un regard sur la physionomie de l’être humain aux
prises avec la souffrance. Ajoutez à cela les organisations géantes, caisses de
secours, assurances sociales, qui contribuent encore à cette dépersonnalisation
et cette rationalisation ; il en résulte une espèce de standardisation qui
étouffe tout contact intérieur entre le médecin et le patient ; avec la
meilleure volonté du monde, il devient de plus en plus impossible de susciter
entre le médecin et le patient la moindre vibration de cette force magnétique
mystérieuse qui va d’âme à âme. Le médecin de famille, le seul qui voyait
encore l’homme dans le malade, qui connaissait non seulement son état physique,
sa nature et ses modifications, mais aussi sa famille et par conséquent
certains de ses antécédents, le dernier qui représentait encore quelque chose
de l’ancienne dualité du prêtre et du guérisseur, prend peu à peu figure de
fossile. Le temps l’écarte. Il jure avec la loi de la spécialisation, la
systématisation, comme le fiacre avec l’automobile. Trop humain, il ne peut
plus s’adapter à la mécanique perfectionnée de la médecine.
La
grande masse ignorante, mais intuitive, du peuple proprement dit a toujours
résisté à cette dépersonnalisation et cette rationalisation absolues de la médecine.
Aujourd’hui comme il y a mille ans, l’homme primitif, non encore touché par la
« culture », considère craintivement la maladie comme quelque chose de
surnaturel et lui oppose la résistance morale de l’espoir, de la prière et du
serment ; il ne pense pas tout d’abord à l’infection et à l’obstruction de ses artères,
mais à Dieu.
Aucun
manuel, aucun maître d’école ne pourra jamais le persuader que la maladie naît
« naturellement », c’est-à-dire sans le moindre sens et sans qu’intervienne une
question de culpabilité ; c’est pourquoi il se méfie par avance de toute
pratique qui promet d’éliminer la maladie froidement, techniquement, d’une façon
rationnelle. La récusation par le peuple du médecin sorti des universités
correspond à un instinct collectif héréditaire qui exige un médecin « naturiste
» en relation avec l’universel, sympathisant avec les plantes et les bêtes, au
courant des mystères de la nature, devenu guérisseur par prédestination et non à
la suite d’examens ; le peuple veut toujours, au lieu de l’homme du métier connaissant
les maladies, l’homme tout court « dominant » la maladie. Et bien que la
diablerie et la sorcellerie se soient depuis longtemps évanouies à la lumière électrique,
la foi en ce faiseur de miracles, en ce magicien, est bien plus vivante qu’on
ne le reconnaît publiquement.
La
vénération émue que nous ressentons devant l’inexplicable
génie créateur d’un Beethoven, d’un Balzac ou d’un Van Gogh, le peuple, lui, la
concentre encore aujourd’hui sur tous ceux en qui il croit reconnaître des
forces supérieures de guérison. Toujours il réclame comme intermédiaire, au lieu
de la drogue inanimée et froide, la chaleur humaine vivante qui irradie la «
puissance ». Le sorcier, le magnétiseur, le berger et la guérisseuse de village
éveillent en lui plus de confiance que le docteur appointé par une municipalité
et ayant droit à pension, parce qu’eux exercent la médecine non pas comme une
science, mais comme un art, et surtout comme une magie noire interdite.
À
mesure que la médecine se spécialise, se rationalise, se perfectionne
techniquement, l’instinct de la grande masse se dresse contre elle de plus en
plus violemment : le courant obscur et souterrain qui depuis des siècles lutte
contre la médecine académique continue à sillonner les profondeurs du peuple en
dépit de toute instruction publique.
Cette
résistance, la science la sent et la combat en vain, bien qu’elle ait réussi,
en faisant appel au concours de l’État, à obtenir une loi contre les guérisseurs
et les médicastres : on n’étouffe pas complètement par des décrets des
mouvements qui ont un fond religieux. À l’ombre de la loi opèrent aujourd’hui
comme au Moyen Âge d’innombrables guérisseurs non diplômés, c’est-à-dire illégaux
du point de vue de l’État ; la guerre entre les traitements naturels, les
guérisons religieuses et la thérapeutique scientifique se poursuit toujours.
Pourtant
les adversaires les plus dangereux de la science académique ne sont pas sortis
des chaumières, ni des camps de bohémiens, mais de ses propres rangs ; de même
que la Révolution française n’a pas pris tous ses guides dans le peuple et que
la domination de la noblesse a été, au fond, sapée par les nobles eux-mêmes
ayant pris parti contre elle, de même dans la grande révolte contre la
spécialisation à outrance de la médecine officielle les leaders les plus déterminés
ont toujours été des médecins indépendants. Le premier qui combat la
matérialisation, l’explication du miracle de la guérison, est Paracelse. Il
fonce contre les « doctores » avec la brutalité
paysanne qui lui est propre et les accuse de vouloir, avec leur science
livresque, démonter et remonter le microcosme comme s’il s’agissait d’une
montre. Il combat l’orgueil, le dogmatisme d’une science qui a perdu tout lien
avec la haute magie de la natura
naturans, qui ne devine ni ne
respecte les forces élémentaires et ignore le fluide que dégage tant l’âme individuelle
que l’âme universelle.
Et
quelque suspectes que nous paraissent aujourd’hui ses formules, l’influence
spirituelle de cet homme s’accroît, pour ainsi dire, sous la peau du temps, et
se manifeste au début du XIXe siècle dans la médecine dite « romantique », qui,
se rattachant au mouvement poétique et philosophique de cette époque, aspire à une
union supérieure de l’âme et du corps.
Avec
sa foi absolue en l’âme universelle, la médecine romantique affirme que la
nature elle-même est la plus sage des guérisseuses et qu’elle n’a besoin de
l’homme que comme auxiliaire tout au plus. De même que sans l’intervention du
chimiste le sang se crée des antitoxines contre tout poison, l’organisme qui se
maintient et se transforme seul réussit généralement, sans aucun concours, à
venir à bout de sa maladie.
La tâche
principale de toute médecine serait, par conséquent, de ne pas contrecarrer
obstinément la nature, mais seulement de renforcer, en cas de maladie, la
volonté de guérir toujours existante chez l’individu.
Une impulsion
morale, religieuse ou intellectuelle est souvent plus efficace que la drogue ou
l’appareil lui-même, déclare-t-elle ; le résultat, en réalité, vient toujours
du dedans, jamais du dehors. La nature est le « médecin intérieur » que chacun porte
en soi dès sa naissance et qui en sait plus long sur les maladies que le
spécialiste, lequel ne fait que s’appuyer sur les symptômes extérieurs,
ajoute-t-elle. La médecine romantique, on le voit, considère la maladie,
l’organisme et le problème de la guérison comme une « unité ».
Cette
idée fondamentale de la résistance de l’organisme à la maladie fait naître au
cours du XIXe siècle toute une série de systèmes. Mesmer avait fondé sa
doctrine sur la « volonté de guérir » qui est en l’homme, la Christian Science
établit la sienne sur la force féconde de la foi, résultat de la connaissance
de soi. Et de même que ces guérisseurs se servent des forces intérieures de la nature,
d’autres utilisent ses forces extérieures : les homéopathes recourent aux
simples, Kneipp et les médecins naturistes aux
éléments revivifiants : eau, soleil, lumière ; mais
tous renoncent unanimement aux médicaments chimiques, aux appareils médicaux et
par là aux conquêtes dont s’enorgueillit la science moderne. Le contraste général
que l’on relève entre tous ces traitements naturels, ces cures miraculeuses,
ces « guérisons par l’esprit » et la pathologie officielle, se résume en une
brève formule.
Dans
la médecine scientifique le malade est considéré comme objet
et il lui est imposé presque dédaigneusement une passivité absolue
; il n’a rien à dire ni à demander, rien à faire qu’à suivre docilement, sans
réfléchir, les prescriptions du médecin et à éviter le plus possible
d’intervenir dans le traitement. La méthode psychique, elle, exige avant tout
du patient qu’il agisse lui-même, qu’il
déploie la plus grande activité contre la maladie, en sa qualité de sujet, de porteur
et de réalisateur de la cure.
Le seul,
le véritable médicament de toutes les cures psychiques est cet appel au malade,
qu’elles engagent à ramasser ses forces morales, à les concentrer en un
faisceau de volonté et à les opposer à la maladie. La plupart du temps
l’assistance des guérisseurs se réduit à des mots ; mais celui qui sait les
miracles opérés par le logos, le verbe créateur, cette vibration magique de la
lèvre dans le vide qui a construit et détruit des mondes innombrables, ne s’étonnera
pas de voir, dans l’art de guérir comme dans tous les autres domaines, les
merveilles réalisées uniquement par les mots. Il ne s’étonnera pas de voir,
dans des organismes parfois complètement ravagés, la santé reconstituée uniquement
par l’esprit, au moyen de la parole et du regard.
Ces
guérisons admirables ne sont en réalité ni rares ni miraculeuses : elles
reflètent vaguement une loi encore secrète pour nous, et que les temps à venir
approfondiront peut-être, la loi des rapports supérieurs entre le corps et
l’esprit ; c’est déjà bien pour notre temps de ne plus nier la possibilité des
cures purement psychiques et de s’incliner avec une certaine gêne devant des phénomènes
que la science à elle seule ne peut expliquer.
L’abandon
volontaire de la médecine académique par quelques médecins indépendants est, à
mon avis, un des épisodes les plus intéressants de l’histoire de la civilisation.
Car rien dans l’histoire, celle des faits comme celle de l’esprit, n’égale en
grandeur dramatique l’attitude morale d’un homme isolé, faible, solitaire, qui s’insurge
contre une organisation embrassant le monde. Chaque fois qu’un homme a osé,
armé de sa seule foi, entrer en conflit avec les puissances coalisées du monde
et se lancer dans une bataille qui semblait absurde et sans chance de succès – qu’il
s’agisse de l’esclave Spartacus luttant avec les cohortes et les légions
romaines, du pauvre cosaque Pougatchev ayant rêvé de régner sur la gigantesque
Russie, ou de Luther, le moine au front têtu se dressant contre la
toute-puissante fides
catholica – toujours il a su
communiquer aux autres hommes son énergie intérieure et tirer du néant des
forces incommensurables.
Chacun
de nos grands fanatiques de la « Guérison par l’Esprit » a groupé autour de lui
des centaines de milliers d’individus ; chacun par ses actes et ses guérisons a
ébranlé et secoué la conscience de son temps ; chacun a suscité dans la science
des courants formidables. Chose fantastique : à une époque où la médecine,
grâce à une technique féeriquement perfectionnée, accomplit de véritables
miracles, où elle a appris à observer, décomposer, mesurer, photographier,
influencer et transformer les plus minuscules atomes et molécules de substance vivante,
où toutes les autres sciences naturelles exactes la suivent et lui prêtent leur
concours, où tout l’élément organique semble enfin dénué de mystère, à pareille
époque une série de chercheurs indépendants démontrent l’inutilité dans
beaucoup de cas de toutes ces connaissances.
Ils
prouvent publiquement et d’une façon irréfutable qu’aujourd’hui comme jadis on
peut obtenir des guérisons rien que par des moyens psychiques et cela même dans
des cas où l’admirable machinerie de la médecine universitaire a échoué.
Vu du
dehors, leur système est inconcevable, presque ridicule dans son invraisemblance
; le médecin et le patient, paisiblement assis l’un en face de l’autre,
paraissent simplement bavarder. Pas de rayons Roentgen, pas de courant
électrique, pas même de thermomètre, rien de tout l’arsenal technique qui fait l’orgueil
justifié de notre temps : et cependant leur méthode archaïque agit souvent plus
efficacement que la thérapeutique la plus avancée.
Le
fait qu’il y a des chemins de fer n’a rien changé à la mentalité de l’humanité.
N’amènent-ils pas tous les ans à la grotte de Lourdes des centaines de milliers
de pèlerins qui veulent y guérir uniquement par le miracle ? L’invention des
courants à haute fréquence n’a rien changé, elle non plus, à l’attitude de
l’âme vis-à-vis du mystère, car ces mêmes courants cachés dans la baguette
magique d’un « preneur d’âmes » n’ont-ils point fait surgir du néant autour
d’un seul homme, à Gallspach, en 1930, toute une
ville avec hôtels, sanatoriums et lieux de divertissement ? Rien n’a montré d’une
façon aussi visible que les succès multipliés des traitements par la suggestion
et les guérisons dites miraculeuses de quelles formidables énergies dispose
encore le
XXe siècle,
quelles possibilités de guérison pratiques ont été sciemment négligées par la médecine
bactériologique et cellulaire en niant obstinément l’intervention de
l’irrationnel et en excluant arbitrairement de ses calculs l’auto traitement
psychique.
Bien
entendu, aucun de ces systèmes de guérison à la fois anciens et nouveaux n’a
ébranlé, un seul instant, l’organisation magnifique de la médecine moderne, insurpassable
dans sa diversité et ses méthodes d’examen ; le triomphe de certains systèmes
et traitements ne prouve en aucune façon que la médecine scientifique moderne
en soi ait eu tort ; seul est démasqué ce dogmatisme qui s’acharnait à ne trouver
valable et admissible que la méthode la plus récente et considérait
effrontément toutes les autres comme fausses, inacceptables et surannées.
Cette
suffisance seule a reçu un coup des plus durs. Les succès désormais indéniables
des méthodes psychiques décrites dans ce livre n’ont pas peu contribué à éveiller
chez les leaders intellectuels de la médecine des réflexions salutaires. Un
doute léger, mais déjà perceptible pour nous autres profanes, s’est infiltré dans
leurs rangs. Et l’on se demande, comme le fait un homme de la valeur de Sauerbruch, si la conception purement bactériologique et sérologique
des maladies n’a pas poussé la médecine dans une impasse ; si la spécialisation
d’une part, et la prédominance des généralisations sur le diagnostic individuel
d’autre part, n’ont pas commencé à transformer peu à peu l’art médical destiné
à servir les hommes en une science étrangère à l’humanité et n’ayant pour but qu’elle-même
? Ou, pour citer une excellente formule, si « le docteur n’est pas devenu par
trop médecin » ?
Ce
que l’on appelle aujourd’hui une « crise de conscience de la médecine » n’a
rien de commun avec une étroite affaire de métier ; elle participe du phénomène
général de l’incertitude européenne, du relativisme universel, qui – après des
dizaines d’années d’affirmations absolues dans tous les domaines de la science –
apprend enfin aux spécialistes à regarder derrière eux et à questionner. Une
certaine largeur d’esprit, d’ordinaire, hélas, étrangère aux académiciens,
commence heureusement à se manifester : ainsi, le livre excellent d’Aschner sur la « Crise de la médecine » cite une foule d’exemples
surprenants, qui nous apprennent comment des cures raillées et condamnées hier
encore comme moyenâgeuses (par exemple le cautère et la saignée) sont
redevenues aujourd’hui des plus modernes et des plus actuelles.
La médecine,
enfin curieuse de leurs lois, considère avec plus de justice et de curiosité le
phénomène des « guérisons par l’esprit », que les professeurs diplômés, au XIXe
siècle, qualifiaient encore avec mépris de bluff, truquage et mensonge ; on
fait des efforts sérieux pour adapter peu à peu les méthodes psychiques aux
méthodes cliniques exactes.
Chez
les médecins les plus humains et les plus intelligents, on sent poindre, sans aucun
doute, une certaine nostalgie de l’ancien universalisme, un désir de passer
d’une pathologie purement locale à une thérapeutique générale, un besoin de
connaître non seulement les maladies qui s’abattent sur l’individu, mais
l’individu lui-même.
Après
avoir décomposé le corps humain et étudié ses cellules et ses molécules,
l’homme de science tourne enfin sa curiosité vers la « totalité » de l’individu
considéré comme tel et cherche derrière les causes locales de sa maladie
d’autres causes supérieures.
De
nouvelles sciences – la typologie, la physiognomonie, la théorie de l’hérédité,
la psychanalyse, la psychologie individuelle – s’efforcent de placer au premier
plan ce qu’il y a de personnel, d’unique, de particulier dans chaque individu ;
et les résultats de la psychologie non officielle, les phénomènes de la
suggestion, de l’autosuggestion, les découvertes de Freud, d’Adler, occupent de
plus en plus l’attention de tout médecin sérieux.
Les
courants de la médecine organique et psychique, séparés depuis des siècles,
commencent à se rapprocher, car tout développement – à l’image de la spirale de
Goethe ! – parvenu à un certain degré, regagne obligatoirement son point de départ.
Toute mécanique revient finalement à la loi fondamentale de son mouvement, ce
qui est divisé aspire au retour à l’unité, le rationnel retombe dans l’irrationnel
; après des siècles d’une science rigoureuse qui a étudié à fond la forme et la
matière du corps humain, on se tourne à nouveau vers « l’esprit qui fait le corps
».
I : La situation au
tournant du siècle
Si le jeu secret des désirs se dissimule à la
lumière plus mate des émotions communes, il devient, à l’état de passion
violente, d’autant plus éclatant, saillant, formidable ; le fin connaisseur de
l’âme humaine qui sait combien l’on peut, en somme, compter sur le mécanisme du
libre arbitre et dans quelle mesure il est permis de déduire par analogie
transportera mainte expérience de ce domaine dans sa doctrine et la recréera
pour la vie morale… Quelle surprise s’il se dressait, comme pour les autres
domaines de la nature, un Linné qui procéderait à une classification selon les
instincts et les penchants !...
Schiller
Combien
de vérité supporte, combien de vérité ose
un esprit ? C’est ce qui est devenu pour moi, de plus en plus, la
véritable mesure des valeurs.
L’erreur
(la foi en l’idéal) n’est pas de l’aveuglement, l’erreur est de la lâcheté…
Chaque
conquête, chaque pas en avant dans la connaissance découle
du courage, de la dureté envers soi, de la propreté envers soi.
La
mesure la plus sûre de toute force est la résistance qu’elle surmonte.
Ainsi,
l’action d’abord révolutionnaire, puis reconstructrice de Sigmund Freud n’est
vraiment compréhensible que si l’on se représente la morale d’avant-guerre et
l’idée qu’on se faisait alors des instincts humains. Aujourd’hui les pensées de
Freud – qui, il y a vingt ans, étaient encore des blasphèmes et des hérésies –
circulent couramment dans le langage et dans le sang de l’époque ; les formules
conçues par lui apparaissent si naturelles qu’il faut un plus grand effort pour
les rejeter que pour les adopter.
Précisément
parce que notre XXe siècle ne peut plus concevoir pourquoi le XIXe siècle se
défendait avec tant d’exaspération contre la découverte, attendue depuis longtemps,
des forces instinctives de l’âme, il est nécessaire d’examiner
rétrospectivement l’attitude psychologique des générations d’alors et de tirer
encore une fois de son cercueil la momie ridicule de la morale d’avant-guerre.
Le
mépris de cette morale – notre jeunesse en a trop souffert pour que nous ne la
haïssions pas ardemment – ne signifie pas celui de l’idée de la morale et de sa
nécessité. Toute communauté humaine, liée par esprit religieux ou national, se
voit forcée, dans l’intérêt de sa conservation, de refréner les tendances
agressives, sexuelles, anarchiques de l’individu et de les endiguer derrière
des barrages appelés Morale et Loi. Il va de soi que chacun de ces groupes se crée
des normes et des formes particulières de la morale : de la horde primitive au
siècle électrique chaque communauté s’efforce par des moyens différents de
dompter les instincts primitifs. Les civilisations dures exerçaient durement
leur pouvoir : les époques lacédémonienne, judaïque, calviniste, puritaine,
cherchaient à extirper l’instinct de volupté panique de l’humanité en le
brûlant au fer rouge. Mais, quelque féroces que fussent leurs commandements et
leurs prohibitions, ces époques draconiennes servaient quand même la logique
d’une idée. Et toute idée, toute foi, sanctifie à un certain degré la violence
de son application. Si les Spartiates poussent la discipline jusqu’à
l’inhumanité, c’est dans le but d’épurer la race, de créer une génération
virile, apte à la guerre : du point de vue de son idéal de la Communauté, la
sensualité relâchée devait être aux yeux de l’État un empiétement sur son
autorité. Le christianisme, lui, combat le penchant charnel au nom du salut de l’âme,
de la spiritualisation de la nature toujours dévoyée. Justement parce que
l’Église, le plus sage des psychologues, connaît la passion de la chair chez
l’homme éternellement adamite, elle lui oppose brutalement la passion de
l’esprit comme idéal ; elle brise son entêtement orgueilleux dans les geôles et
sur les bûchers, pour faire retourner l’âme dans sa patrie suprême – logique
cruelle, mais logique quand même. Là comme ailleurs, l’application de la loi
morale a pour base une conception du monde solidement ancrée. La morale
apparaît comme la forme physique d’une idée métaphysique.
Mais
au nom de quoi, au service de quelle idée le XIXe siècle dont la piété, depuis
longtemps, n’est que surface, exige-t-il encore une morale codifiée ?
Grossièrement matériel, jouisseur, gagneur d’argent, sans l’ombre de la grande foi
cohérente des anciennes époques religieuses, défenseur de la démocratie et des
droits de l’homme, il ne peut plus vouloir sérieusement interdire à ses
citoyens le droit à la libre jouissance. Celui qui, sur l’édifice de la civilisation,
a hissé la tolérance en guise de drapeau, ne possède plus le droit seigneurial
de s’immiscer dans la conception morale de l’individu. En effet, l’État moderne
ne s’efforce plus franchement, comme jadis l’Église, d’imposer une morale intérieure
à ses sujets ; seul le code de la société exige le maintien d’une convention
extérieure. On ne demande donc point à l’individu d’être moral, mais de le
paraître, d’avoir une attitude morale. Quant à savoir s’il agit d’une façon véritablement
morale, l’État ne s’en préoccupe pas : ça ne regarde que l’individu lui-même,
qui est uniquement tenu de ne pas se laisser prendre en flagrant délit de manquement
aux convenances.
Maintes
choses peuvent se passer, mais qu’il n’en soit point parlé ! Pour être
rigoureusement exact, on peut donc dire que la morale du XIXe siècle n’aborde
même pas le problème réel. Elle l’évite, et toute son activité se réduit à
passer outre.
Durant
trois ou quatre générations, la civilisation a traité, ou plutôt écarté, tous
les problèmes sexuels et moraux uniquement au moyen de cet illogisme niais qui
veut qu’une chose dissimulée n’existe plus. Cette situation se trouve exprimée
de la façon la plus tranchante par ce mot d’esprit : moralement, le XIXe siècle
n’a pas été régi par Kant, mais par le « cant ».
Comment
une époque si raisonnable et lucide a-t-elle pu se fourvoyer à ce point et
afficher une psychologie aussi insoutenable et aussi fausse ? Comment le siècle
des grandes découvertes, des conquêtes techniques, a-t-il
pu rabaisser sa morale jusqu’à en faire un tour de prestidigitation cousu de
fil blanc ?
La
réponse est simple : justement par orgueil de sa raison. Par infatuation
optimiste de sa culture, par arrogance de sa civilisation. Les progrès inouïs
de la science avaient plongé le XIXe siècle dans une sorte de griserie de la
raison. Tout semblait se soumettre servilement à la domination de l’intellect.
Chaque jour, chaque heure, presque, annonçait de nouvelles victoires de l’esprit
; on conquérait de plus en plus les éléments réfractaires du temps et de
l’espace, les sommets et les abîmes révélaient leur mystère à la curiosité
systématique du regard humain ; partout l’anarchie cédait à l’organisation, le
chaos à la volonté de l’intelligence spéculative. La raison n’était-elle donc
pas capable de maîtriser les instincts anarchiques dans le sang de l’individu,
de discipliner et d’assagir la foule indocile des passions ? La besogne
principale sous ce rapport est accomplie depuis bien longtemps, disait-on, et
ce qui s’allume de temps en temps dans le sang d’un homme moderne, d’un homme «
cultivé », ce ne sont plus que les derniers et pâles éclairs d’un orage passé,
les ultimes convulsions de la vieille bestialité agonisante. Patience quelques
années encore, quelques décennies, et le genre humain, qui a fait une si
magnifique ascension du cannibalisme à l’humanité et au sens social, épurera et
absorbera ces dernières et misérables scories dans ses flammes éthiques : donc,
inutile même de mentionner leur existence.
N’attirez
pas surtout l’attention des hommes sur les choses sexuelles, et ils les
oublieront. N’excitez pas par des discours cette bête antédiluvienne,
emprisonnée derrière les barreaux de fer de la morale, ne la nourrissez pas de questions,
et elle s’apprivoisera. Passer vite, en détournant le regard devant tout ce qui
est désagréable, toujours faire comme si l’on ne voyait rien : c’est là, en
somme, tout le code moral du XIXe siècle.
L’État
arme toutes les puissances qui dépendent de lui pour cette campagne
concentrique contre la franchise. Toutes, science, art, famille, église, école,
université, reçoivent les mêmes instructions de guerre : éluder toute
explication, ne pas attaquer l’adversaire mais l’éviter en faisant un grand
détour, ne jamais entrer en discussion sérieuse, ne jamais lutter à l’aide d’arguments
mais en recourant au silence seul, sans cesse boycotter et ignorer.
Admirablement
obéissantes à cette tactique, toutes les puissances intellectuelles, servantes
de la culture, de gaieté de cœur, ont hypocritement laissé le problème de côté.
Pendant un siècle, dans toute l’Europe, la question sexuelle est mise en
quarantaine. Elle n’est ni niée, ni confirmée, ni soulevée, ni résolue, mais
tout doucement poussée derrière un paravent.
Une
armée formidable de gardiens déguisés en instituteurs, précepteurs, pasteurs et
censeurs, se dresse pour ravir à la jeunesse sa spontanéité et sa joie
charnelle. Aucun souffle d’air frais ne doit effleurer le corps de ces
adolescents, aucun mot sincère, aucun éclaircissement leur âme chaste. Tandis
qu’autrefois, n’importe où, chez tout peuple sain, à toute époque normale,
l’adolescent nubile entre dans l’âge viril comme dans une fête, tandis que dans
les cultures grecque, romaine, judaïque, et même là où il n’y a pas de culture,
le garçon de treize ou de quatorze ans est franchement reçu dans la communauté
de ceux qui savent, homme parmi les hommes, guerrier parmi les guerriers, au
XIXe siècle une pédagogie maudite, par des moyens artificiels et antinaturels, l’éloigne
de toute sincérité. Personne devant lui ne parle librement, et par là ne le libère. Ce qu’il sait, il n’a pu l’apprendre
que chez les filles ou par les chuchotements des camarades aînés. Et comme
chacun n’ose répéter qu’à voix basse cette science des choses les plus naturelles
de la nature, tout adolescent qui grandit sert inconsciemment d’auxiliaire
nouveau à cette hypocrisie de la civilisation.
La
conséquence de ce siècle de retenue et d’hypocrisie obstinées,
nous la voyons dans un ravalement inouï de la psychologie au sein d’une culture
intellectuellement élevée. Car, comment une science profonde de l’âme
aurait-elle pu se développer sans droiture ni honnêteté, comment la clarté se
serait-elle propagée, quand justement ceux qui étaient appelés à répandre le
savoir, les maîtres, les pasteurs, les artistes, les savants, restaient
eux-mêmes ignorants ou hypocrites ? L’ignorance engendre toujours la dureté.
Donc une génération de pédagogues sans pitié, parce que sans savoir, fait un
mal irréparable aux âmes de la jeunesse, en prescrivant éternellement à celle-ci
de « se maîtriser » et d’être « morale ».
Des
garçons à demi formés, qui, sous la pression de la puberté, sans connaître la
femme, cherchent le seul exutoire possible à leur corps, n’ont pour les
renseigner que les sages recommandations de ces mentors « éclairés » qui, en
leur disant qu’ils se livrent à un « vice
épouvantable » qui détruit la santé, leur
blessent profondément l’âme et leur inculquent de force un sentiment
d’infériorité, une conscience mystique du péché. Les étudiants à l’Université
(j’ai moi-même passé par là) reçoivent de ce genre de professeurs qu’on aimait
alors désigner par l’expression fleurie d’« éminents pédagogues » des notices
par lesquelles ils apprennent que toute maladie sexuelle, sans exception, est «
inguérissable ».
Tels sont
les canons dont le vertigo moral de l’époque bombarde sans hésiter le cerveau
des jeunes gens. Et c’est chaussée de ces bottes
cloutées que l’éthique pédagogique piétine le monde des adolescents. Qu’on ne s’étonne
donc point si, du fait de cette éducation systématique de la crainte à laquelle
sont soumises des âmes encore indécises, un coup de revolver part à tout moment
; qu’on ne s’étonne point non plus si cet endiguement violent ébranle l’équilibre
intérieur d’innombrables enfants et si l’on fabrique en série ce type de
neurasthéniques qui portent toute la vie le fardeau de leurs craintes
d’adolescence et de leurs refoulements.
Privés
de conseil, des milliers de ces êtres, estropiés par une morale hypocrite, errent
de médecin en médecin. Mais comme alors les professionnels de la médecine
n’arrivaient pas à dépister la racine de la maladie, c’est-à-dire la sexualité,
et que la psychologie de l’époque pré-freudienne, par bienséance éthique, ne se
hasardait pas dans ces domaines secrets – parce que devant rester secrets – les
neurologues, en ces cas critiques, sont pris au dépourvu. Ne sachant que faire,
ils envoient tous les malades de l’âme, non encore mûrs pour la clinique ou
l’asile d’aliénés, dans des établissements hydrothérapiques. On les gave de
bromure, on les maltraite avec l’électricité, mais personne n’ose aborder les
causes réelles de leur maladie. Les anormaux sont, bien plus encore, victimes
de la sottise humaine. Jugés par la science comme des êtres éthiquement inférieurs,
par la loi comme des criminels, ces malheureux, chargés d’une terrible
hérédité, traînent toute une vie, ayant devant eux la prison, derrière eux le
chantage, le joug invisible de leur secret meurtrier. À personne ils ne peuvent
demander assistance ni conseil.
Car
si, à l’époque pré-freudienne, un homosexuel s’adressait au médecin, ce monsieur,
fronçant les sourcils, s’indignait qu’on osât venir l’importuner avec ces «
cochonneries ». On ne s’occupe pas de ces choses privées dans un cabinet de
consultations ! Mais, où donc s’en occupe-t-on ? Mais à qui doit s’adresser
l’homme troublé ou égaré dans sa vie sentimentale, quelle porte s’ouvrira pour
secourir, pour délivrer ces millions d’individus ? Les universités se dérobent,
les juges se cramponnent aux lois, les philosophes (à l’exception du vaillant
Schopenhauer) préfèrent ne pas remarquer dans leur Cosmos ces déviations
d’Éros, si compréhensibles à toutes les cultures antérieures ; la société ferme
les yeux par principe et déclare que ces choses pénibles ne peuvent pas être discutées.
Donc, silence dans les journaux, dans la littérature, dans les milieux
scientifiques ; la police est informée, c’est suffisant. Que des centaines de
milliers de captifs délirent dans le cachot raffiné de ce mystère, cela, le siècle
suprêmement moral et tolérant le sait et s’en moque ; ce qui importe, c’est qu’aucun
cri ne perce au-dehors, que l’auréole que s’est fabriquée la civilisation, ce
plus moral des mondes, reste intacte aux yeux du public. Car cette époque met l’apparence
morale au-dessus de l’être humain !
Tout
un siècle, un siècle horriblement long, cette lâche conjuration du silence «
moral » domine l’Europe. Soudain une voix le rompt. Un jour, sans la moindre
intention révolutionnaire, un jeune médecin, dans le cercle de ses collègues,
se lève et, prenant pour point de départ ses recherches sur l’hystérie, il
parle des troubles, du refoulement des instincts et de leur délivrance possible.
Il n’use pas de grands gestes pathétiques, ne proclame pas sur un ton ému qu’il
est temps d’appuyer les conceptions morales sur une nouvelle base, que le
moment est venu de discuter librement de la question sexuelle. Non, ce jeune
médecin rigoureusement réaliste ne joue pas les prédicateurs dans le milieu académique.
Il fait exclusivement une conférence diagnostique sur les psychoses et leurs
origines. C’est précisément le calme et le naturel avec lesquels il établit
qu’une grande partie des névroses, presque toutes, en somme, découlent du
refoulement du désir sexuel, qui provoquent l’épouvante glacée de ses
collègues. Non qu’ils considèrent cette étiologie comme fausse – au contraire,
la plupart d’entre eux ont souvent deviné ou expérimenté ces choses, ils se
rendent fort bien compte personnellement du rôle du sexe dans l’équilibre de l’individu.
Mais en tant que représentants de leur époque, en tant que valets de la morale
en cours, ils se sentent aussi blessés par cette franche constatation d’un fait
clair comme le jour que si l’indication du jeune professeur équivalait déjà en
elle-même à un geste indécent. Ils se regardent, embarrassés. Ce jeune « Dozent » ignore-t-il donc la convention tacite qui interdit
d’aborder ces sujets épineux, surtout dans une séance publique de la très
honorable
«
Société des médecins » ? Cette convention, pourtant, le nouveau venu devrait la
connaître et la respecter : sur le chapitre sexuel, on s’entend entre collègues
par un clignement d’yeux, on lance à l’occasion une petite plaisanterie durant
la partie de cartes, mais on n’expose point ces thèses, en plein XIXe siècle,
un siècle aussi cultivé, dans une réunion académique. Déjà, cette première
manifestation publique de Freud – la scène s’est réellement produite – est pour
ses collègues de la Faculté comme un coup de revolver dans une église. Et les
plus bienveillants d’entre eux lui font immédiatement remarquer qu’il serait sage,
dans son intérêt, pour sa carrière académique, de renoncer à l’avenir à des recherches
qui touchent des sujets aussi gênants et qui ne mènent à rien, ou du moins à rien
qui soit susceptible d’être discuté en public.
Mais
Freud, lui, se soucie de sincérité et non de convenance. Il a trouvé une piste
et il la suit.
Justement,
le sursaut de ses auditeurs lui montre qu’il a, sans le vouloir, mis le doigt
sur un endroit malade, que du premier coup il a touché le nerf de la question.
Il tient bon. Il ne se laisse intimider ni par les avertissements, partant d’un
bon cœur, de quelques-uns de ses aînés, ni par les lamentations d’une morale offensée,
qui n’est pas habituée à se sentir empoignée aussi brusquement in
puncto puncti. Avec
cette intrépidité tenace, ce courage viril et cette capacité d’intuition qui, réunis, forment son génie, il ne cesse de presser de plus en
plus fortement l’endroit sensible, jusqu’à ce que finalement l’abcès crève, que
la plaie soit débridée et qu’on puisse travailler à la guérison. Au premier coup
de sonde dans l’inconnu, ce médecin solitaire ne pressent pas encore tout ce
qu’il découvrira dans cette obscurité. Mais il devine l’abîme, et la profondeur
attire toujours magnétiquement l’esprit créateur.
Le
fait qu’en dépit de l’insignifiance apparente du motif la première rencontre de
Freud avec sa génération se transforma en choc, est un symbole et non un
hasard. Ce ne sont pas seulement la pudibonderie choquée, la dignité morale en
vigueur qui s’offensent d’une théorie isolée : non, la morale périmée de
passer-les-choses-sous silence flaire ici, avec la clairvoyance nerveuse qu’on
a dans le danger, une opposition réelle. Ce n’est pas la manière
dont Freud aborde cette sphère, mais le fait
qu’il y touche, qu’il ose y toucher, qui équivaut à une
provocation en duel, où l’un des deux adversaires doit succomber.
Dès
le premier instant, il ne s’agit pas d’amélioration, mais de bouleversement
total. Il n’y va pas de préceptes, mais de principes. Il n’est pas question de
détails, mais d’un tout. Front contre front se dressent deux formes de la
pensée, deux méthodes si opposées qu’entre elles il n’y a pas d’accord possible
et qu’il ne peut jamais y en avoir. La psychologie pré-freudienne, enfermée
dans l’idéologie de la domination du cerveau sur le sang, exige de l’individu,
de l’homme instruit et civilisé, qu’il réprime ses instincts par la raison.
Freud répond nettement et brutalement : les instincts ne se laissent pas réprimer,
et il est vain de supposer que, lorsqu’on les réprime, ils sont chassés et
disparus à jamais. Tout au plus arrive-t-on à refouler les instincts du
conscient dans l’inconscient. Mais alors, soumis à cette déviation dangereuse,
ils se tassent dans le fond de l’âme et engendrent par leur constante fermentation
l’inquiétude nerveuse, les troubles et la maladie. Sans illusions, sans
indulgence, sans croyance au progrès, Freud établit péremptoirement que ces
forces instinctives de la libido, stigmatisées par la morale, constituent une
partie indestructible de l’être humain qui renaît dans chaque embryon ; que cet
élément ne peut jamais être écarté, mais que dans certains cas on réussit à
rendre son activité inoffensive par le passage dans le conscient. Donc, la
prise de conscience, que l’ancienne éthique sociale considère comme un danger
capital, Freud l’envisage comme un remède ; le refoulement qu’elle estimait bienfaisant,
il en démontre le danger.
Ce que
la vieille méthode tenait à mettre sous le boisseau, il veut l’étaler au grand
jour. Il veut identifier au lieu d’ignorer, aborder au lieu d’éviter,
approfondir au lieu de détourner le regard. Mettre à nu au lieu de voiler. Seul
peut discipliner les instincts celui qui les connaît, seul peut dompter les démons
celui qui les tire de leur abîme et les regarde face à face.
La médecine
a aussi peu de rapport avec la morale et la pudeur qu’avec l’esthétique ou la
philologie ; sa tâche la plus importante n’est pas de réduire au silence les
secrets les plus mystérieux de l’homme, mais de les forcer à parler.
Sans
le moindre ménagement pour la pudibonderie du siècle, Freud lance ces problèmes
du refoulement et de l’inconscient au beau milieu de l’époque. Par là, il entreprend la cure non seulement d’innombrables
individus, mais de toute l’époque moralement malade, en transportant de la
dissimulation dans la science le conflit fondamental qu’elle voulait tenir caché.
Cette
méthode révolutionnaire de Freud a non seulement transformé notre conception de
l’âme, mais indiqué une direction nouvelle à toutes les questions capitales de notre
culture présente et à venir. C’est pourquoi tous ceux qui, depuis 1890, veulent
considérer l’effort de Freud comme une simple besogne médicale, la
sous-estiment grossièrement et commettent une plate erreur, car ils confondent consciemment
ou inconsciemment le point de départ avec le but. Le fait que Freud ait fendu
la muraille de Chine de la psychologie ancienne en partant de la médecine est
un hasard historiquement exact, mais sans importance pour ses résultats. Ce qui
importe, chez un créateur, ce n’est pas d’où il vient, mais où il est arrivé.
Freud vient de la médecine de la même façon que Pascal des mathématiques ou
Nietzsche de la philologie ancienne. Sans doute, cette origine donne à son œuvre
une certaine tonalité, mais elle ne détermine ni ne limite sa grandeur.
Car
il serait enfin temps de remarquer, maintenant qu’il entre dans sa
soixante-quinzième année, que son œuvre et sa valeur, depuis longtemps, ne se
basent plus sur le détail secondaire de la guérison annuelle par la
psychanalyse de quelques centaines de névrosés de plus ou de moins, ni sur
l’exactitude de chacune de ses théories et de ses hypothèses. Que la libido
soit sexuellement « fixée » ou non, que le complexe de la castration et l’attitude
narcissique – et Dieu sait quels autres articles de foi codifiés – soient
canonisés ou non pour l’éternité, ces questions sont devenues depuis longtemps
un objet de chicanes scolastiques entre universitaires et n’ont pas la moindre
importance pour la réforme historique et durable que Freud a imposée au monde
par sa découverte du dynamisme de l’âme et sa technique nouvelle vis-à-vis des problèmes
psychologiques.
Ce
qui nous intéresse, c’est qu’un homme, par sa vision créatrice, a transformé notre
sphère intérieure. Et le fait qu’il s’agissait là d’une véritable révolution,
que son « sadisme de la vérité » bouleversait toutes les conceptions du monde
de l’âme, les représentants de la génération mourante le reconnurent les premiers
; ils comprirent le danger de sa théorie. Car c’est bien pour eux qu’elle était
dangereuse ; ils s’en aperçurent immédiatement avec épouvante, ces
illusionnistes, ces optimistes, ces idéalistes, ces avocats de la pudeur et de
la bonne vieille morale, lorsqu’ils se virent en face d’un homme qui brûlait
tous les signaux avertisseurs, que ne faisait reculer aucun tabou et
n’intimidait aucune contradiction, à qui, en vérité, rien ne restait « sacré ».
Ils ont
senti instinctivement qu’avec Freud, aussitôt après Nietzsche, l’Antéchrist,
venait un autre grand destructeur des vieilles tables saintes, un
anti-illusionniste, dont le rayon Roentgen du regard éclairait impitoyablement
tous les arrière-plans, voyait sous la libido le sexe, en l’enfant innocent
l’homme primitif, dans la douce intimité familiale les antiques et dangereuses tensions
entre père et fils, et dans les rêves les plus anodins les ardents
bouillonnements du sang. Dès le premier instant ils sont torturés par un
pressentiment pénible : un tel homme qui, dans leurs valeurs les plus sacrées,
culture, civilisation, humanité, morale et progrès, ne voit rien d’autre que
des rêves-désirs, ne poussera-t-il pas encore plus loin sa sonde féroce ? Cet
iconoclaste ne transportera-t-il pas finalement son impudente technique
analytique de l’âme individuelle à l’âme collective ? N’ira-t-il pas
jusqu’à frapper de son marteau les fondements de la morale d’État et les complexes
familiaux agglutinés au prix de tant d’efforts, jusqu’à dissoudre par ses
acides violemment caustiques l’idée de patrie et même l’esprit religieux ?
En
effet, l’instinct du monde agonisant d’avant-guerre a vu juste : le courage
illimité, l’intrépidité intellectuelle de Freud ne se sont arrêtés nulle part. Indifférent
aux objections et aux jalousies, au bruit et au silence, avec la patience
inébranlable et systématique de l’artisan, il a continué à perfectionner son
levier d’Archimède jusqu’à pouvoir s’attaquer au monde. En la soixante-dixième
année de sa vie, Freud a entrepris l’œuvre ultime d’appliquer
sa méthode, dont il avait fait l’expérience sur
l’individu, à l’humanité entière et même à Dieu. Il a eu le courage d’avancer
encore et toujours, par-delà les illusions, jusqu’au néant suprême, jusqu’à cet
infini grandiose où il n’y a plus de foi, plus d’espoirs ni de rêves, pas même
ceux du ciel et où il n’est plus question du sens et de la tâche de l’humanité.
Sigmund
Freud a donné à l’humanité – œuvre admirable d’un homme isolé – une notion plus
claire d’elle-même, plus claire, dis-je, non pas plus heureuse. Il a approfondi
la conception du monde de toute une génération : approfondi, dis-je, non pas
embelli.
Car l’absolu
ne rend jamais heureux, il ne fait qu’imposer des décisions. La science n’a pas
pour devoir de bercer de nouvelles rêveries apaisantes le cœur éternellement puéril
de l’humanité ; sa mission est d’apprendre aux hommes à marcher droit et ferme
sur notre dure planète.
La part
de Sigmund Freud dans cette tâche indispensable a été exemplaire : au cours de
l’œuvre qu’il a entreprise sa dureté est devenue
force, sa sévérité loi inflexible. Jamais, pour le plaisir de consoler, Freud
n’a montré à l’homme une issue commode, un refuge dans un paradis terrestre ou céleste,
mais toujours et uniquement le chemin qui conduit à la connaissance de soi-même,
la voie dangereuse aboutissant au plus profond de son Moi. Sa clairvoyance est
sans indulgence ; sa façon de penser n’a allégé en rien la vie humaine. Aiguë
et tranchante comme la bise, son irruption dans une atmosphère étouffante a
dissipé bien des brouillards dorés et des nuages roses mais par-delà les
horizons éclaircis s’étend maintenant une nouvelle
perspective sur le domaine de l’esprit.
Grâce
à l’effort de Freud une nouvelle génération regarde une époque nouvelle avec
des yeux plus pénétrants, plus libres et plus sincères. Si la dangereuse
psychose de la dissimulation, qui a tenu en laisse pendant un siècle la morale européenne,
est définitivement écartée, si nous avons appris à regarder sans fausse honte
au fond de notre vie ; si les mots de « vice » et de « péché » nous font frémir
d’horreur ; si les juges, renseignés sur la force dominante des instincts
humains, hésitent parfois à prononcer une condamnation ; si les instituteurs
admettent naturellement les choses naturelles et la famille
franchement
les choses franches ; s’il y a dans la conception morale plus de sincérité et
dans la jeunesse plus de camaraderie ; si les femmes acceptent plus librement
leur sexe et leur désir ; si nous avons appris à respecter l’essence unique de
tout individu et possédons la compréhension créatrice du mystère de notre être
spirituel – tous ces éléments de redressement moral, nous les devons, nous et
notre monde nouveau, en première ligne à cet homme, qui a eu le courage de savoir
ce qu’il savait et le triple courage d’imposer ce savoir à la morale
obstructive et lâchement résistante de l’époque.
Maints
détails de l’œuvre de Freud peuvent être discutables, mais qu’importent les détails
! Les pensées vivent autant de dénégations que de confirmations, une œuvre existe
non moins par la haine que par l’amour qu’elle éveille. Le seul triomphe
décisif d’une idée, le seul aussi que nous soyons encore prêts aujourd’hui à révérer,
est son incorporation à la vie. Car rien, en notre temps de justice incertaine,
ne rallume autant la foi en la prédominance de l’esprit que l’exemple vécu du
fait qu’il suffit toujours qu’un seul homme ait le courage de la vérité pour
augmenter le vrai dans tout l’univers.
II : Portrait
caractérologique
La sincérité est la source de tout génie.
La
porte sévère d’un immeuble viennois se referme depuis un demi-siècle sur la vie
privée de Sigmund Freud : on serait presque tenté de dire qu’il n’en a point
eu, tant son existence personnelle, modestement reléguée à l’arrière-plan, suit
un cours silencieux. Soixante-dix ans dans la même ville, plus de quarante ans
dans la même maison. Ici, la consultation dans la même pièce, la lecture dans
le même fauteuil, le travail littéraire devant le même bureau. Pater
familias de six enfants, sans aucun besoin personnel, sans autre passion
que celle du métier et de la vocation. Jamais un atome de son temps,
parcimonieusement et pourtant généreusement utilisé, ne se perd en vue de
grades et de dignités, en vaniteuses attitudes extérieures : jamais, pour la
publicité, le créateur ne se campe devant l’œuvre créée ; chez cet homme, le
rythme de la vie se soumet uniquement et totalement au rythme incessant,
uniforme et patient du travail. Chacune des mille et mille semaines de ses soixante-quinze
ans est enfermée dans le cercle unique d’une activité délimitée, chaque jour
est pareil à l’autre. Pendant toute la session universitaire, conférence une
fois par semaine ; le mercredi soir, régulièrement, selon la méthode socratique,
un symposion intellectuel au milieu des disciples ; le
samedi après-midi une partie de cartes ; à part cela, du matin au soir, ou
plutôt à minuit, chaque minute, chaque seconde, est employée à l’analyse, au
traitement des malades, à l’étude, à la lecture et à la tâche scientifique.
Cet
inexorable calendrier de travail ne connaît pas de feuilles blanches, cette
journée sans fin, au cours d’un demi-siècle, ne compte pas une seule heure de repos
d’esprit. L’activité perpétuelle est aussi naturelle à ce cerveau toujours en
mouvement que l’est au cœur le battement régénérateur du sang ; le travail, chez
Freud, n’apparaît pas comme une action soumise à la volonté, mais au contraire
comme une fonction permanente et inhérente à l’individu.
L’indéfectibilité
de ce zèle et de cette vigilance est précisément le trait le plus surprenant de
son être intellectuel : la norme se mue en phénomène. Depuis quarante ans Freud
se livre journellement à huit, neuf, dix, parfois même onze analyses ;
c’est-à-dire que neuf, dix, onze fois, il se concentre pendant une heure
entière, dans une tension extrême, presque palpitante, de manière à ne faire
qu’un avec son « sujet », dont il écoute et pèse chaque parole, cependant que
sa mémoire, jamais en défaut, lui permet de comparer simultanément les données
de la psychanalyse présente à celles de toutes les séances précédentes. Il vit
ainsi au cœur de cette personnalité étrangère, tandis qu’en même temps,
établissant le diagnostic de l’âme, il l’observe du dehors. Et tout d’un coup,
à la fin de cette séance, il doit quitter ce malade, entrer dans la vie du
suivant, et cela huit, neuf fois par jour – gardant en lui, sans annotations ni
moyens mnémoniques, les fils séparés de centaines et de centaines de destins,
qu’il domine et dont il discerne les ramifications les plus délicates.
Un
effort aussi constamment renouvelé exige une vigilance de l’esprit, un guet de
l’âme, une tension des nerfs que personne d’autre ne serait de taille à
supporter plus de deux ou trois heures. Mais la vitalité étonnante de Freud, sa
surforce dans le domaine de la puissance
intellectuelle, ne connaît point l’épuisement ni la lassitude.
Lorsque
bien tard, le soir, le travail analytique, la journée de neuf ou dix heures au
service de l’humain sont terminés, l’autre travail commence, celui que le monde
croit être sa tâche unique : l’élaboration créatrice des résultats. Et ce
labeur gigantesque, pratiqué sans arrêt sur des milliers d’hommes et qui se répercute
sur des millions, s’opère tout le long d’un demi-siècle, sans aide, sans
secrétaire, sans assistant ; chaque lettre de Freud est manuscrite, ses
recherches sont poursuivies jusqu’au bout par lui seul et c’est sans faire
appel au moindre concours qu’il donne leur forme définitive à tous ses travaux.
Seule
la régularité grandiose de sa puissance créatrice trahit sous la surface banale
de cette existence l’élément foncièrement démoniaque.
Ce
n’est que dans la sphère de la création que cette vie apparemment normale
révèle ce qu’il y a en elle d’unique et
d’incomparable.
Cet
instrument de précision, qui pendant des décennies fonctionne sans jamais
s’arrêter ni faiblir ni dévier, serait inconcevable si la matière n’en était
parfaite. Comme chez Haendel, Rubens et Balzac, créateurs torrentiels, la surabondance
intellectuelle découle chez Freud d’une santé splendide.
Jusqu’à
l’âge de soixante-dix ans, ce grand médecin n’a jamais été gravement malade, ce
profond explorateur de toutes les maladies nerveuses n’a jamais ressenti le moindre
trouble nerveux ; cet investigateur lucide de toutes les anomalies de l’âme, ce
sexualiste tant décrié, est resté toute une vie, dans ses manifestations personnelles,
d’une uniformité et d’une santé étonnantes. Ce corps ne connaît même pas par
expérience les malaises les plus ordinaires, les plus quotidiens, qui viennent
troubler le travail intellectuel, et il n’a pour ainsi dire jamais connu la
migraine, ni la fatigue. Pendant des dizaines d’années, Freud n’a jamais eu
besoin de consulter un confrère, jamais une indisposition ne l’a obligé à
remettre un cours. Ce n’est qu’à l’âge patriarcal qu’une maladie maligne s’efforce
de briser cette santé polycratique. Mais en vain. À
peine la blessure est-elle cicatrisée que, sur-le-champ et sans diminution aucune,
reprend l’ancienne vitalité.
Pour
Freud, la santé va avec la respiration, l’état de veille avec le travail, la
création avec la vie. Et plus est vive et continue la tension du jour, plus est
complète, pour ce corps taillé dans le roc, la détente nocturne. Un sommeil
bref, mais total, renouvelle de matin en matin cette vigueur magnifiquement normale
et en même temps magnifiquement surnormale de l’esprit.
Freud, quand il dort, dort très profondément, et quand il veille, est
formidablement éveillé.
L’image
extérieure de l’être ne contredit point cet équilibre complet des forces
intérieures. Proportions parfaites de tous les traits, aspect essentiellement
harmonieux. La taille ni trop grande ni trop petite, le corps ni trop lourd ni
trop frêle : partout et toujours une moyenne véritablement exemplaire. Depuis des
années les caricaturistes désespèrent en face de ce visage dont l’ovale parfaitement
régulier ne donne aucune prise à l’exagération du dessin. C’est en vain qu’on
range côte à côte les portraits de ses jeunes années pour y saisir quelque
trait dominant, quelque signe caractéristique. Et à trente, à quarante, à
cinquante ans, ces images ne nous montrent qu’un bel homme, un homme viril, un
monsieur aux traits réguliers, trop réguliers peut-être.
L’œil
sombre et concentré trahit, il est vrai, l’être intellectuel, mais avec la
meilleure volonté on ne trouve dans ces photographies pâlies rien d’autre qu’un
de ces visages de savants, d’une virilité idéalisée, à la barbe soignée, tels
qu’aimaient en peindre Lenbach et Makart,
ténébreux, grave et doux, mais en somme rien moins que révélateur.
On
croit déjà devoir renoncer à toute étude caractérologique devant ce visage
enfermé dans sa propre harmonie. Mais soudain les dernières photos commencent à
parler. Seul l’âge, qui chez la plupart des hommes dissout les traits personnels
et les émiette en argile grise, seule la vie patriarcale, la vieillesse et la
maladie, de leur ciseau créateur, donnent au visage de Freud un caractère
spécial indéniable. Depuis que les cheveux grisonnent, que la barbe n’encadre
plus aussi richement le menton obstiné, que la moustache ombrage moins la
bouche sévère, depuis que s’avance le soubassement osseux et cependant
plastique de sa figure, quelque chose de dur, d’incontestablement offensif, se découvre
: la volonté inexorable, pénétrante et presque irritée de sa nature. Plus
profond, plus sombre, le regard, jadis simplement contemplateur, est maintenant
aigu et perçant ; un pli amer et méfiant fend comme une blessure le front découvert
et sillonné de rides. Les lèvres minces et serrées se ferment comme sur un « non
» ou un « ce n’est pas vrai ». Pour la première fois on sent dans le visage de
Freud la rigueur et la véhémence de son être, et l’on devine que ce n’est point
là un good grey old
man, que l’âge a rendu doux et sociable, mais un analyste
impitoyable, qui ne se laisse duper par personne et n’admet point de duperie.
Un homme devant lequel on aurait peur de mentir, qui, de son regard soupçonneux
et décoché comme une flèche du fond de l’obscurité, barre la route à tout
faux-fuyant et empêche d’avance toute échappatoire ; un homme au visage
tyrannique peut-être, plutôt que libérateur, mais doué d’une admirable
intensité de pénétration ; non pas un simple contemplateur, mais un psychologue
inexorable.
Qu’on
n’essaie point d’affadir le masque de cet homme, d’atténuer sa dureté biblique,
ou l’énergique intransigeance qui flamboie dans l’œil presque menaçant du vieux
lutteur. Car si cette énergie tranchante et implacable avait manqué à Freud,
son œuvre eût été privée de ce qu’elle contient de meilleur et de plus décisif.
Comme Nietzsche avec le marteau, Freud a philosophé toute une vie avec le
scalpel : ces instruments-là ne peuvent guère être maniés par des mains
indulgentes et douces. L’obligeance, la complaisance, la politesse et la
compassion seraient absolument inconciliables avec la pensée radicale de sa
nature créatrice, dont le sens et la mission sont uniquement la révélation des extrêmes
et non leur harmonisation.
La
volonté combative de Freud exige toujours le pour ou le contre nets, le oui ou
le non, mais pas de « qui sait » et de « néanmoins », de « cependant » et de « peut-être
». Quand il s’agit de raison et d’avoir raison dans le domaine de l’esprit,
Freud ne connaît ni réserves ni ménagements, ni compromis ni pitié : comme Jahvê, l’Éternel, il pardonne moins à un tiède qu’à un apostat.
Les à peu près n’ont pas de valeur pour lui, il n’est tenté que par la vérité
cent pour cent. Toute pénombre, autant dans les relations personnelles d’homme
à homme que dans ces sublimes clairs-obscurs intellectuels
de l’humanité que l’on qualifie d’illusions, provoque inévitablement son besoin
violent et presque exacerbé de diviser, de délimiter, d’ordonner – son regard veut
ou doit toujours faire ressortir les phénomènes avec l’acuité de la lumière
directe.
Voir
clair, penser clair, agir clair, n’est pas pour Freud un effort ni un acte de
sa volonté ; le besoin d’analyser est, chez lui, instinctif, inné, organique et
irrépressible. Quand Freud ne comprend pas entièrement et immédiatement une chose,
il est incapable d’épouser le point de vue de qui que ce soit ; ce qui ne lui
paraît point clair du fond de lui-même, personne ne peut le lui éclaircir. Son œil,
comme son esprit, est autocratique et absolument intransigeant ; et c’est
dans la lutte, lorsqu’il est dressé seul contre des ennemis cent fois
supérieurs en nombre, que se déploie en sa plénitude l’instinct agressif de
cette volonté intellectuelle que la nature a faite tranchante comme un
couperet.
Dur,
sévère et impitoyable pour les autres, Freud ne l’est pas moins envers
lui-même. Exercé à la méfiance, accoutumé à dépister la moindre fausseté jusque
dans les replis les plus secrets de l’inconscient, à démasquer derrière chaque
aveu une confession encore plus sincère, sous chaque vérité une vérité plus
profonde, il applique à sa propre personne la vigilance de ce contrôle
analytique. C’est pourquoi le mot si souvent employé de « penseur audacieux »
me paraît fort mal convenir à Freud. Sa pensée n’a rien de l’improvisation, à
peine quelque chose de l’intuition. Ce n’est point un étourdi qui modèle des formules
en un tour de main : il hésite parfois des années avant de muer ouvertement une
supposition en affirmation ; pour un génie constructif comme le sien, des généralisations
prématurées, des sauts périlleux de l’intellect, seraient de véritables
contresens. N’allant qu’à petits pas, avec circonspection et sans jamais
éprouver la moindre exaltation, Freud dépiste le premier tout ce qui n’est pas
sûr ; on trouve dans ses écrits maints avertissements qu’il s’adresse à lui-même,
tels que : « Ceci n’est qu’une hypothèse », ou : « Je sais que sous ce rapport
j’ai peu de nouveau à dire. » Le vrai courage de Freud commence tard, avec la
certitude.
C’est
seulement lorsque cet impitoyable désillusionniste
s’est entièrement convaincu lui-même, a triomphé de sa propre méfiance, a surmonté
sa crainte d’enrichir la chimère du monde d’une illusion nouvelle, qu’il expose
sa conception.
Mais
dès qu’il a admis et défendu publiquement une idée, elle entre dans son sang et
sa chair, devient une partie de son existence intellectuelle, et aucun Shylock
ne pourrait en exciser une once de son corps vivant. La certitude de Freud
s’affirme tard : mais une fois acquise, elle ne peut plus être brisée. Cette
ténacité, cette énergie à maintenir son point de vue envers et contre tous, les
adversaires irrités de Freud l’ont traitée de dogmatisme, et même ses partisans
s’en sont plaints à voix basse ou haute. Mais ce caractère entier de Freud est indissolublement
lié à sa nature : il découle d’une attitude non pas volontaire, mais spontanée,
d’une façon particulière de voir les choses.
Ce qu’embrasse
son regard créateur, il le voit comme si personne avant lui
ne l’avait vu. Quand il pense, il oublie ce que d’autres ont pensé sur le
même sujet. Il perçoit ses problèmes sur un mode naturel et indéniable, et quel
que soit l’endroit où il entrouvre le livre sibyllin de l’âme humaine, il tombe
toujours sur une nouvelle page ; avant même que sa pensée critique s’en soit emparée,
son œil a déjà accompli la création. On peut corriger une erreur d’opinion,
mais jamais modifier la perception créatrice d’un regard : la vision est hors
de toute influence, la création au-delà de la volonté ; qu’est-ce donc que nous
qualifions de création, sinon ce don de voir des choses archi-vieilles et immuables
comme si jamais ne les avait illuminées l’étoile d’un œil humain, d’exprimer ce
qui fut dit mille fois avec autant de fraîcheur virginale que si jamais la
bouche d’un mortel ne l’avait prononcé ?
Impossible
à apprendre, cette magie de la vision intuitive du savant est en même temps
impossible à éduquer, et l’obstination avec laquelle une nature géniale
maintient sa première et unique vision n’est point de l’entêtement, mais une
inéluctable nécessité.
C’est
pourquoi Freud n’essaie jamais de convaincre, de persuader, d’enjôler ses
lecteurs et ses auditeurs. Il expose, c’est tout. Sa loyauté sans réserve
renonce absolument à servir même les pensées qui lui semblent les plus
importantes sous une forme poétiquement séduisante et, en adoucissant
l’expression, à faciliter aux âmes sensibles la digestion des parties dures et
amères. Comparée à la prose enivrante de Nietzsche, qui toujours fait jaillir
les feux d’artifice les plus fous de l’art et de l’artisterie, la sienne paraît
de prime abord incolore, sobre et froide. La prose de Freud ne fascine pas, ne
conquiert pas ; elle renonce totalement à toute poétisation, à toute eurythmie
musicale (il lui manque, comme il l’avoue lui-même, tout penchant intérieur à
la musique – évidemment dans le sens de Platon qui l’accuse de troubler la
pensée pure). Et c’est précisément le but unique de Freud, qui agit selon le mot
de Stendhal : « Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans
illusion. » La clarté, dans le langage comme dans toutes les manifestations
humaines, lui paraît l’Optimum et l’Ultimum ; il
subordonne toutes les valeurs artistiques, comme secondaires, à cette netteté
et à cette luminosité et il obtient ainsi le tranchant diamantin des contours
auquel il doit l’incomparable vis plastica de son style. Prose latine,
prose romaine, dénuée de tout ornement, s’en tenant, rigide, à son sujet, elle
ne le survole jamais à la façon des poètes, mais l’exprime en mots durs et
drus. Elle n’enjolive pas, n’accumule pas les vocables, elle n’est pas touffue,
elle évite les répétitions ; elle est, jusqu’à la limite, avare d’images et de comparaisons.
Mais quand elle en choisit une, elle est puissamment persuasive et porte comme
une balle.
Certaines
formules de Freud ont la sensualité translucide des gemmes taillées et se
dressent dans la clarté glacée de sa prose comme des camées enchâssés dans des
coupes de cristal. Chacune d’elles est inoubliable. Au cours de ses
démonstrations philosophiques, Freud n’abandonne pas une seule fois le droit
chemin – il hait les circonlocutions stylistiques autant que les déviations
intellectuelles – et dans toute son œuvre si vaste on ne trouve pas une seule
phrase qui ne soit nettement accessible, sans effort, même à un homme de
culture moyenne. Son expression, comme sa pensée, tend toujours à une précision
quasi géométrique : seul un style apparemment terne, mais en réalité d’une
extrême luminosité, pouvait servir son effort vers la clarté.
Tout
génie, dit Nietzsche, porte un masque. Freud a choisi l’un des masques les plus
impénétrables : celui de la discrétion. Sa vie extérieure dissimule une
puissance démoniaque de travail sous une sorte de bourgeoisisme sobre de
philistin. Son visage : le génie créateur sous des traits calmes et réguliers.
Son œuvre, hardie et révolutionnaire à l’extrême, revêt les dehors modestes propres
aux méthodes universitaires d’une science naturelle exacte. La froideur
incolore de son style cache l’art cristallin de sa puissance créatrice. Génie
de la sobriété, il aime manifester ce qui, en son être, est sobre et non ce qui
est génial.
Seule
apparaît d’abord la mesure, le démesuré se révèle plus tard en profondeur. En
toutes choses Freud est plus qu’il ne veut paraître, et cependant, en chacune
de ses manifestations, il demeure le même sans équivoque. Car là où domine et
s’épanouit en l’homme la loi de l’unité supérieure, elle transparaît et s’incarne
triomphalement dans tous les éléments de son être, vie, œuvre, style et aspect.
III : Le point de départ
Dans
ma jeunesse, pas plus qu’ensuite, d’ailleurs, je n’ai jamais ressenti de
préférence spéciale pour la situation et le métier de médecin », avoue Freud
dans l’histoire de sa vie, avec cette franchise inexorable envers lui-même, si
caractéristique de son être. Mais à cet aveu viennent encore s’ajouter ces
paroles riches d’éclaircissements : « J’étais plutôt mû par une sorte de soif
de savoir, qui se rapportait aux relations humaines bien plus qu’aux objets
naturels. »
Mais
à ce penchant intime ne correspond aucune branche, le programme d’études médicales
de l’Université de Vienne ne connaît pas de matière d’enseignement intitulée «
Relations humaines ». D’autre part, comme le jeune étudiant doit songer bientôt
à gagner son pain, il ne peut s’abandonner longuement à ses préférences et il
se voit forcé de marquer patiemment le pas avec les autres pendant les douze
semestres prescrits. Comme étudiant, déjà, Freud travaille sérieusement à des
recherches indépendantes ; ses devoirs universitaires, il les remplit, par contre,
selon son sincère aveu, « assez négligemment » et n’obtient son diplôme de
docteur en médecine qu’en 1881, à l’âge de vingt-cinq ans, « avec un assez
grand retard ».
C’est
le sort d’un grand nombre : en cet homme, incertain de sa voie, se prépare une
vocation mystérieuse de l’esprit, qu’il doit échanger avant tout contre une
profession qui ne lui dit rien. Car dès le début l’artisanat de la médecine, la
partie classique et la technique curative n’attirent guère cet esprit fixé sur
l’universel.
Psychologue-né
– ce qu’il ignorera longtemps – le jeune médecin cherche toutefois
instinctivement à transporter son champ d’activité théorique dans le voisinage
de l’âme. Il choisit donc comme spécialité la psychiatrie, et s’occupe de
l’anatomie du cerveau, car alors
il n’est pas encore question dans les auditoires
médicaux de la psychologie de l’individu pris en particulier ; cette science de
l’âme dont nous ne pouvons plus nous passer aujourd’hui, Freud devra nous
l’inventer. La conception mécanique de l’époque considère toute anomalie de
l’âme uniquement comme une déviation des nerfs, comme une dépravation ; on est dominé
par l’inébranlable illusion de pouvoir, grâce à une connaissance toujours plus approfondie
des organes et à des expériences dans le domaine animal, calculer exactement un
jour le mécanisme de l’âme et en corriger toute déviation. C’est pourquoi l’atelier de psychologie est, à
cette époque, situé dans le laboratoire de physiologie, où l’on croit faire des
expériences concluantes en recourant à la lancette, au scalpel, au microscope
et aux appareils de réaction électriques pour mesurer les oscillations et les
vibrations des nerfs.
Freud,
lui aussi, doit s’asseoir d’abord à la table de dissection et rechercher à
l’aide de toutes sortes d’appareils techniques des causes qui, en réalité, ne
se manifestent jamais sous une forme matérielle. Il travaille pendant plusieurs
années dans le laboratoire des célèbres anatomistes Brücke et Meynert, qui ne tardent pas à reconnaître chez le jeune
assistant le don inné de la découverte créatrice et indépendante.
Tous
deux cherchent à l’avoir comme collaborateur permanent. S’il le veut, le jeune
médecin donnera même à la place du maître Meynert un
cours sur l’anatomie du cerveau. Mais une force intérieure résiste
inconsciemment chez Freud.
Peut-être
son instinct pressent-il la destinée qui l’attend ; quoi qu’il en soit, il
décline la proposition flatteuse. D’ailleurs, ses travaux histologiques et
cliniques conformes à la méthode universitaire suffisent déjà à le faire nommer
agrégé de neurologie à l’Université de Vienne.
Agrégé
de neurologie, c’est, à ce moment-là, pour un médecin sans fortune et âgé de
vingt-neuf ans seulement, un titre envié et une fonction lucrative. Maintenant
Freud devrait soigner ses malades, d’année en année, sans s’éloigner du droit
chemin, selon la brave méthode universitaire prescrite et consciencieusement
apprise, et il pourrait faire une carrière brillante.
Mais
déjà se manifeste chez lui cet instinct si caractéristique d’autocontrôle, qui
toute sa vie
l’entraînera toujours plus loin et plus
en avant. Car ce jeune professeur reconnaît loyalement ce que tous les autres
neurologues se dissimulent entre eux et souvent à eux-mêmes, à savoir que toute
la technique du traitement nerveux des phénomènes psychogènes, telle qu’elle se
présente en 1885, est totalement inopérante, incapable d’apporter aucun secours
et se trouve acculée à une impasse.
Mais
comment en pratiquer une autre, puisque à Vienne on n’enseigne que celle-là ?
Ce qu’on pouvait apprendre des maîtres viennois en 1885 (et bien plus tard
encore), le jeune professeur l’a appris jusqu’au dernier détail : observation
clinique scrupuleuse et anatomie d’une exactitude parfaite, sans oublier les vertus
fondamentales de l’école de Vienne qui sont la conscience la plus rigoureuse
dans le travail et une application inexorable. Au-delà, que pourrait-il glaner
chez des hommes qui n’en savent pas plus que lui ?
C’est
pourquoi la nouvelle qu’à Paris, depuis plusieurs années, on fait de la psychiatrie
selon une méthode tout à fait différente de celles admises en Autriche exerce sur
Freud une tentation irrésistible.
Surpris
et méfiant, mais extrêmement attiré, il apprend donc que Charcot, spécialiste
de l’anatomie du cerveau, fait de singulières expériences à l’aide de cette
infâme et maudite hypnose, frappée à Vienne d’excommunication depuis le jour où
– Dieu merci ! – on chassa de la ville François-Antoine Mesmer.
Freud
se rend tout de suite compte que de loin, sur les seuls rapports des revues médicales,
on ne peut se faire une idée réelle de ces expériences ; il faut les voir soi-même
pour pouvoir en juger. Guidé par ce flair intérieur mystérieux qui fait deviner
aux créateurs leur voie véritable, Freud décide de se rendre à Paris. Son maître
Brücke soutient la requête du jeune médecin sans fortune qui demande une bourse
de voyage. On la lui accorde. Et en 1886, pour commencer de nouvelles études,
pour apprendre avant d’enseigner, le jeune professeur part pour Paris.
Il se
trouve immédiatement dans une autre atmosphère. Bien que Charcot, comme Brücke,
soit parti de l’anatomie pathologique, il l’a dépassée. Dans son livre célèbre La foi
qui guérit, le grand Français a étudié les conditions psychologiques des
miracles religieux rejetés jusque-là comme invraisemblables par la morgue
scientifique médicale et établi certaines lois typiques dans leurs manifestations.
Au lieu de nier les faits, il les a interprétés et s’est approché avec la même
absence de préjugés de tous les autres systèmes de cures miraculeuses, y
compris le fameux mesmérisme.
Pour
la première fois Freud rencontre un savant qui, à l’encontre de son école de Vienne,
ne rejette pas l’hystérie d’avance avec mépris comme une simulation mais
examine cette maladie de l’âme, la plus intéressante, parce que la plus plastique
de toutes, et prouve que ses crises et ses accès sont les suites de
bouleversements intérieurs et doivent avoir des causes psychiques.
Au cours
de conférences publiques, Charcot démontre sur des patients hypnotisés que ces
paralysies typiques peuvent être provoquées ou supprimées par la suggestion à n’importe
quel moment de l’état de sommeil somnambulique, que, par conséquent, elles ne
constituent pas de simples réflexes physiologiques, mais sont soumises à la volonté.
Bien
que les détails de sa doctrine ne réussissent pas toujours à persuader le jeune
médecin viennois, ce dernier est puissamment impressionné par le fait qu’à
Paris la neurologie reconnaît et tient compte non seulement des causes
physiques, mais aussi psychiques et même métapsychiques. Il voit avec joie qu’ici
la psychologie se rapproche de l’antique science de l’âme, et il se sent plus
attiré par cette méthode intellectuelle que par celle qu’on lui a enseignée
jusque-là.
Dans
cette nouvelle sphère d’activité Freud a de nouveau le bonheur – mais peut-on qualifier
de bonheur ce qui n’est au fond que l’éternelle et réciproque divination
instinctive des esprits supérieurs ? – d’éveiller chez ses maîtres un intérêt
particulier. De même que Brücke, Meynert et Nothangel, à Vienne, Charcot discerne immédiatement en
Freud une nature créatrice et l’attire dans sa sphère intime. Il le charge de
la traduction de ses œuvres en allemand et l’honore de sa confiance.
Lorsque
Freud, quelques mois plus tard, retourne à Vienne, son image intérieure du
monde est changée. La voie de Charcot, il le sent vaguement, n’est pas complètement
la sienne ; ce savant, lui aussi, s’occupe encore trop de l’expérience physique
et trop peu de ce qu’elle révèle dans le domaine de l’âme. Mais ces quelques
mois à eux seuls ont fait mûrir chez le jeune médecin une volonté
d’indépendance et un courage nouveaux. Il peut commencer maintenant son propre travail
créateur.
Il est
vrai qu’il reste d’abord une petite formalité à remplir. Tout bénéficiaire
d’une bourse de voyage de l’Université est tenu, à son retour, de faire un
rapport sur ses expériences scientifiques à l’étranger. Freud présente le sien
à la Société des médecins. Il parle des nouvelles méthodes de Charcot et décrit
ses expériences hypnotiques à la Salpêtrière. Mais depuis François- Antoine
Mesmer, les milieux médicaux viennois se méfient terriblement de tout ce qui
est hypnose. On passe avec un sourire dédaigneux sur la communication de Freud,
à savoir qu’il est possible de provoquer artificiellement les symptômes de
l’hystérie ; quant à l’annonce qu’il existe même des cas d’hystérie masculine,
elle éveille chez ses collègues une franche gaieté. Au début on lui tape avec bienveillance
sur l’épaule en le raillant de s’être laissé conter à Paris de pareilles
balivernes ; mais comme Freud ne cède pas, on ferme ensuite à l’indigne apostat
le sanctuaire du laboratoire de psychiatrie, où – Dieu soit loué ! – on fait
encore de la psychologie « sérieuse et scientifique ».
Depuis
lors, Freud est demeuré la bête noire de l’Université de Vienne, jamais plus il
n’a franchi le seuil de la Société des médecins et ce n’est que grâce à la
protection privée d’une malade influente (comme il le confesse gaiement
lui-même) qu’il obtint, après des années, le titre de professeur
extraordinaire. Mais l’illustre Faculté ne se souvient qu’à contrecœur qu’il
appartient au personnel académique. Le jour de son soixante-dixième
anniversaire elle préfère même nettement ne pas s’en souvenir et se dispense de
tout message et de toute congratulation.
Freud
n’est jamais devenu titulaire d’une
chaire de professeur ; il est resté
ce qu’il était dès le début : un professeur
extraordinaire parmi des professeurs ordinaires !
En
s’opposant à la méthode mécanique de la neurologie, qui s’efforçait de guérir
les maladies de l’âme exclusivement par les excitations cutanées ou des médicaments,
Freud a non seulement gâché sa carrière académique, mais il a aussi perdu sa
clientèle privée.
Désormais,
il doit se débrouiller seul. À peine a-t-il alors
dépassé le côté négatif de la question : s’il sait que par l’étude anatomique
du cerveau et l’usage de l’appareil à mesurer les réactions nerveuses on ne
peut espérer faire des découvertes psychologiques décisives et que seule une
méthode entièrement différente, avec un tout autre point de départ, permettrait
d’approcher les mystérieux enchevêtrements de l’âme, il s’agit maintenant de
trouver ou plutôt d’inventer cette méthode.
C’est
à quoi Freud se consacrera passionnément pendant les cinquante années qui vont
suivre. Paris et Nancy lui ont fourni certaines indications qui le mettent sur
la voie.
Mais
dans la sphère scientifique, tout comme dans l’art, une pensée unique ne peut
jamais donner naissance à des formes définitives ; la fécondation véritable ne
se produit que par le croisement d’une idée et d’une expérience. Il suffit
alors de la moindre impulsion pour que
s’affirme la force créatrice.
C’est
sa collaboration amicale avec le docteur Joseph Breuer, son aîné, que Freud a
rencontré naguère au laboratoire de Brücke, qui va donner cette impulsion.
Breuer, médecin très occupé, fort actif dans le domaine de la science sans être
lui-même créateur, avait entretenu Freud, déjà avant son voyage à Paris, d’un
cas d’hystérie chez une jeune fille, qu’il avait réussi à guérir d’une façon
imprévue.
La
patiente présentait les phénomènes ordinaires de cette maladie : paralysies,
contractures, inhibitions, obscurcissement de la conscience. Or, Breuer avait
observé que cette jeune fille se sentait libérée, qu’il se produisait une
amélioration temporaire dans son état chaque fois qu’elle pouvait lui parler
d’elle abondamment. Le docteur, intelligent, écoutait donc patiemment la malade
donner libre cours à sa fantaisie affective. Ainsi la jeune fille racontait, et
racontait. Mais durant ces « confessions » abruptes, sans aucun lien, Breuer
flairait que la malade évitait toujours intentionnellement l’essentiel, ce qui
avait joué un rôle décisif dans l’éclosion de son hystérie. Il s’aperçut que
cet être savait sur lui-même quelque chose qu’il ne voulait pas savoir et qu’en
conséquence il réprimait. Pour dégager la voie encombrée conduisant à
l’événement caché, il vient à l’idée de Breuer d’hypnotiser régulièrement la
jeune fille. Dans cet état où la volonté est supprimée, il espère pouvoir balayer
d’une façon radicale toutes les inhibitions qui s’opposent encore à l’éclaircissement
définitif. En effet, sa tentative réussit ; en état d’hypnose, où toute pudeur
est abolie, la jeune fille exprime librement ce qu’elle avait avec tant d’obstination
dissimulé au médecin et avant tout à elle-même : au chevet de son père malade
elle avait éprouvé et réprimé certains sentiments. Ces sentiments refoulés pour
des raisons de décence avaient trouvé ou plutôt inventé comme dérivatif les
symptômes maladifs constatés. Car chaque fois que la jeune fille les avoue en
état d’hypnose, leur substitut, le symptôme hystérique, disparaît
immédiatement. Breuer poursuit systématiquement le traitement dans ce sens.
Dans la mesure où il éclaire la malade sur elle-même, les phénomènes
hystériques dangereux s’effacent – ils sont devenus inutiles. Au bout de
quelques mois, la patiente est renvoyée complètement guérie.
Ce
cas curieux, Breuer l’avait donc raconté, comme exceptionnellement remarquable,
à son jeune collègue. Ce qui le satisfait le plus, lui, dans ce traitement,
c’était la guérison d’une névrosée. Mais Freud, avec son profond instinct,
devine sur-le-champ sous la thérapeutique dévoilée par Breuer une loi beaucoup
plus vaste, à savoir que les « énergies de l’âme sont déplaçables », qu’il doit
exister dans le subconscient une force agissante qui métamorphose les
sentiments arrêtés dans leur cours naturel (ou, comme nous disons depuis, non «
abréagis ») et les porte vers d’autres manifestations psychiques ou physiques.
Le
cas trouvé par Breuer montre en quelque sorte sous un angle nouveau les expériences
rapportées de Paris ; les deux amis décident de travailler ensemble pour suivre
jusque dans les ténèbres la trace découverte. Les œuvres qu’ils écrivent alors
en collaboration : Sur le
mécanisme psychique des phénomènes hystériques
(1893) et Études sur l’hystérie (1895)
représentent le premier exposé de ces idées nouvelles ; en elles brille
l’aurore d’une psychologie entièrement différente de celle qui est admise.
Au
cours de leurs recherches communes, il est établi pour la première fois que l’hystérie
n’est pas due, comme on le croyait jusque-là, à une maladie organique, mais à
un trouble provoqué par un conflit intérieur, dont le malade lui-même ne se
rend pas compte ; sous la pression exercée par le conflit se forment ces
symptômes, ces déviations maladives. Les troubles psychiques sont engendrés par
une rétention des sentiments comme la fièvre par une inflammation interne. Et de
même que la fièvre tombe dès que la suppuration trouve une issue, de même
cessent les violentes manifestations de l’hystérie dès que l’on arrive à
dégager le sentiment « rentré » et refoulé, « à diriger sur des voies normales
où elle s’affirme librement la force affective détournée et pour ainsi dire étranglée
qui s’employait à
maintenir le symptôme ».
Au
début, Breuer et Freud recourent à l’hypnose comme instrument de libération
psychique.
À cette
époque préhistorique de la psychanalyse, elle ne constitue aucunement un remède
en soi, mais simplement un moyen de secours. Sa tâche est uniquement d’aider à arrêter
les crises du sentiment : elle représente pour ainsi dire l’anesthésique pour
l’opération à faire. C’est seulement lorsque les entraves de l’état de veille
conscient sont tombées que le malade exprime librement ce qu’il a de plus
secret ; le seul fait de la confession diminue la pression angoissante. On
procure un exutoire à une âme qui étouffe ; c’est l’affranchissement de la
tension que la tragédie grecque chante comme un bonheur et une délivrance ;
Breuer et Freud qualifièrent donc d’abord leur méthode de « cathartique », dans
le sens de la « catharsis » d’Aristote. Grâce à la connaissance de soi-même, la
déviation maladive et artificielle devient superflue, le symptôme qui n’avait
qu’un sens symbolique disparaît.
Breuer
et Freud étaient arrivés en commun à ces résultats importants, décisifs même.
Mais là leur chemin bifurque. Breuer, le médecin, redoutant les dangers de
cette incursion dans le domaine de l’âme, se retourne vers le côté médical ;
lui, ce qui l’intéresse surtout, ce sont les
moyens de guérir l’hystérie, de supprimer les symptômes.
Quant à Freud, qui vient seulement de découvrir en lui le psychologue, il est
essentiellement fasciné par le phénomène psychique, par le mystère qui l’éclaire
du processus de transformation des sentiments. La découverte que ceux-ci
peuvent être refoulés et remplacés par des symptômes excite plus violemment encore
sa curiosité ; il pressent que tout le problème du mécanisme psychique est là.
Car si les sentiments peuvent être refoulés, qui les refoule ? Où sont-ils
refoulés ?
Selon
quelles lois des forces se transportent-elles du psychique dans le physique, et
où se produisent ces transformations incessantes dont l’homme conscient ne sait
rien et dont il sait pourtant beaucoup dès qu’on le force à savoir ? Une sphère
inconnue où la science, jusqu’ici, n’avait encore osé pénétrer, s’ébauche
vaguement devant Freud ; il s’aperçoit au loin des contours nébuleux d’un monde
nouveau : l’Inconscient. Désormais il se consacrera passionnément à « l’étude
de la région inconsciente de la vie de l’âme ». La descente dans l’abîme a
commencé.
IV : Le monde de l’inconscient
Vouloir
oublier ce que l’on sait, rétrograder artificiellement d’un niveau plus élevé à
une conception plus naïve, exige toujours un effort particulier. C’est pourquoi
il est déjà difficile aujourd’hui de se représenter la façon dont le monde scientifique
de 1900 comprenait la notion de l’inconscient.
La psychologie
pré-freudienne n’ignorait pas, bien entendu, que nos possibilités psychiques ne
sont pas entièrement épuisées par l’activité consciente de la raison, qu’il
existe derrière cela une autre puissance qui agit en quelque sorte à l’ombre de
notre vie et de notre pensée. Mais ne sachant que faire de cette connaissance,
elle ne tenta jamais de transporter réellement la notion de l’inconscient dans
le domaine de la science et de l’expérience. La psychologie de cette époque-là
ne s’occupe des phénomènes psychiques que dans la mesure où ils pénètrent dans
le cercle illuminé par la conscience. Pour elle, c’est un contresens – une contradictio in adjecto – que
de vouloir faire de l’inconscient un objet de la conscience. Le sentiment n’est
considéré comme tel que dès qu’on le ressent nettement, la volonté dès qu’elle
veut activement ; mais tant que les manifestations psychiques ne s’élèvent pas
au-dessus de la surface de la vie consciente, la psychologie d’alors les écarte
de l’esprit comme
des impondérables dont on ne peut tenir compte.
Freud
transporte dans la psychanalyse le terme technique « inconscient », mais il lui
donne un tout autre sens que la philosophie scolaire. Pour Freud, le conscient
ne constitue pas le seul acte psychique, ni l’inconscient, par conséquent, une catégorie
absolument différente ou subordonnée ; au contraire, il déclare énergiquement :
tous les actes psychiques sont tout d’abord des produits de l’inconscient ;
ceux dont on prend conscience ne représentent pas une espèce différente ni
supérieure ; leur entrée dans le conscient, ils ne la doivent qu’à une action
extérieure, telle la lumière venant éclairer un objet. Qu’elle soit invisible
dans une pièce obscure ou qu’une lampe électrique la rende perceptible au
regard, une table reste toujours une table. La lumière rend son existence matériellement
plus sensible, mais ce n’est pas elle qui produit sa présence. Certes dans cet
état de visibilité accrue on peut la mesurer plus exactement que dans l’obscurité,
bien que dans les ténèbres même, par une autre méthode, en palpant et en
tâtant, il eût été possible dans une certaine mesure de constater et délimiter
sa nature. Mais, logiquement, la table invisible dans le noir appartient au monde
physique tout autant que la table visible, et de même dans le domaine de la
psychologie l’inconscient fait partie de l’âme autant que le conscient. Par conséquent,
chez Freud, pour la première fois, « inconscient » ne signifie plus «
inconnaissable » ; doté d’un sens nouveau, le mot entre dans la science. Grâce
à cette volonté étonnante de Freud d’examiner non seulement l’extérieur des phénomènes
psychiques, mais aussi leur tréfonds et de sonder sous la surface du conscient
avec une nouvelle attention et un autre instrument méthodologique la cloche à
plongeur de sa psychologie abyssale, la psychologie scolaire redevient enfin
une véritable connaissance de l’âme, une science vitale applicable et même
curative.
L’œuvre
géniale de Freud, c’est cette réforme fondamentale, cette découverte d’une
nouvelle terre d’expériences, cet élargissement formidable du champ d’action de
l’âme. D’un seul coup la sphère psychique perceptible multiplie son étendue
antérieure et offre à la
science, sous la surface, la profondeur. Toutes les
mesures du dynamisme psychique sont bouleversées grâce à cette modification, apparemment
insignifiante – après coup, les idées
décisives apparaissent toujours simples et allant de soi.
Aussi est-il probable qu’une future histoire de l’esprit comptera cet instant
créateur de la psychologie parmi les plus grands et les plus riches de conséquences,
de même que les simples déplacements de l’angle de vision intellectuel de Kant
et de Copernic ont transformé la pensée de toute une époque. Aujourd’hui déjà
l’image que se font de l’âme les universités au début du siècle nous semble
être d’une gaucherie de bois gravé, étroite et fausse comme une carte
ptoléméenne, qui qualifie de Cosmos une petite et misérable partie de l’univers
géographique.
Rappelant
ces cartographes naïfs, les psychologues pré-freudiens voient tout simplement
une terra incognita dans
les continents inexplorés de l’âme, « inconscient » est pour eux un mot qui
remplace inconnaissable et inaccessible. Ils pensent, certes, qu’il doit y
avoir quelque part un réservoir obscur et stagnant de l’âme, où s’écoulent pour
s’y enliser tous nos souvenirs inutilisés, un magasin où l’oublié et
l’inemployé traînent sans but, un dépôt d’où la mémoire tire, tout au plus, de
temps en temps, à la lumière de la conscience un quelconque objet.
Mais
la conception fondamentale de la science pré-freudienne est et reste celle-ci :
ce monde inconscient en soi est entièrement inactif, absolument passif ; il
représente une vie vécue et morte, un passé enterré, et, par là, sans aucune
action, sans aucune influence sur nos sentiments présents.
À
cette conception, Freud oppose la sienne : l’inconscient n’est en aucune façon
le résidu de l’âme, il est au contraire sa matière première, dont seule une
partie minime atteint la surface éclairée du conscient.
Mais
la partie principale, dite inconscient, qui ne se manifeste pas, n’est pas pour
cette raison morte ou privée de dynamisme. En réalité, vivante et active, elle
agit sur notre pensée et nos sentiments ; peut-être même représente-t-elle la
partie la plus plastique de notre existence psychique. C’est pourquoi celui
qui, dans toute décision, ne fait pas entrer en ligne de compte le vouloir inconscient,
commet une erreur, car il exclut du calcul l’élément principal de nos tensions
internes ; de même que l’on se tromperait grossièrement en évaluant la force d’un
iceberg d’après la partie qui émerge de l’eau (son volume véritable restant
caché sous la surface), de même se leurre celui-là qui croit que nos énergies conscientes,
nos pensées claires, déterminent seules nos actions et nos sentiments. Notre
vie ne se déroule pas librement dans la sphère du rationnel, mais cède à
l’incessante pression de l’inconscient ; tout instant de notre vivante journée
est submergé par les vagues d’un passé apparemment oublié.
Notre
monde supérieur n’appartient pas à la volonté consciente et à la raison logique
dans la mesure orgueilleuse que nous supposons, car c’est des ténèbres de
l’inconscient que jaillissent, comme des éclairs, les décisions essentielles et
c’est dans les profondeurs de ce monde des instincts que se préparent les cataclysmes
qui soudain bouleversent notre destinée. C’est là que gîtent serrés les uns
contre les autres tous ces sentiments qui dans la sphère consciente sont
pratiquement enregistrés dans les catégories du temps et de l’espace ; les
désirs d’une enfance oubliée, que nous croyions enterrée à jamais, s’y meuvent
impatiemment, et parfois, ardents et affamés, envahissent notre vie ; la
terreur et l’effroi depuis longtemps effacés de la mémoire consciente font
monter tout à coup de l’inconscient leurs hurlements par le fil conducteur des
nerfs ; là se sont enracinés à notre être non seulement les désirs de notre
propre passé, mais encore ceux des ancêtres barbares et des générations tombées
en poussière. De ces profondeurs sortent les plus caractéristiques de nos
actions, de ce mystère caché à nous-mêmes les soudaines illuminations, la
puissance surhumaine qui domine la nôtre.
Dans
ce crépuscule habite le Moi antique dont notre Moi civilisé ne sait plus rien
ou ne veut plus rien savoir ; mais tout à coup il se dresse, crève la mince
couche de civilisation qui le retenait et ses instincts primitifs et
indomptables se précipitent en nous, menaçants, car c’est la volonté
primordiale de l’inconscient de monter à la lumière, de devenir conscient et de
se libérer par l’action : « Puisque je suis, je dois agir. »
À
tout instant, chaque fois que nous prononçons une parole, que nous
accomplissons un acte quelconque, nous sommes obligés de réprimer ou plutôt de refouler
des mouvements inconscients ; notre sentiment éthique ou civilisateur doit se défendre
sans cesse contre le barbare instinct de jouissance. Ainsi – vision formidable
d’éléments pour la première fois évoqués par Freud – toute notre vie psychique
apparaît comme une lutte incessante et pathétique entre le vouloir conscient et
inconscient, entre l’action responsable et nos instincts irresponsables.
Mais
toute manifestation de ce qui est apparemment inconscient, même si elle nous
reste incompréhensible, possède un sens précis ; faire comprendre à tout individu
le sens de ses élans inconscients, c’est la tâche future que Freud exige d’une nouvelle
et nécessaire psychologie.
Nous
n’apprenons à connaître le monde des sentiments d’un homme que lorsque nous
pouvons éclairer ses régions souterraines : nous ne pouvons découvrir la cause
de ses troubles et de ses désordres que lorsque nous descendons tout au fond de
l’âme. Ce dont l’homme a conscience, le psychologue et le psychiatre n’ont pas
besoin de le lui enseigner. Le médecin ne peut vraiment secourir le malade que
là où celui-ci ignore son inconscient.
Mais
comment descendre dans ces régions crépusculaires ? La science de l’époque ne
connaît aucun moyen. De plus elle avoue carrément l’impossibilité de saisir les
phénomènes du subconscient à l’aide de ses appareils basés sur les principes de
la mécanique. L’ancienne psychologie ne pouvait donc poursuivre ses recherches
qu’à la lumière du jour, dans le monde du conscient. Mais elle passait indifférente
devant l’homme muet ou celui qui parlait en rêve.
Freud brise et rejette cette conception comme
un morceau de bois vermoulu. Selon sa conviction, l’inconscient n’est pas muet.
Il s’exprime en d’autres signes et symboles, il est vrai, que le conscient.
Celui qui veut quitter sa surface pour descendre dans son propre abîme doit
avant tout apprendre la langue de ce monde nouveau. Comme les égyptologues
devant
la Rosette, Freud se met à interpréter signe après signe, puis il élabore un
vocabulaire et une grammaire de la langue de l’inconscient, pour faire
comprendre ces voix qui vibrent, tentations ou avertissements, derrière nos
paroles et notre état de veille et auxquelles généralement nous obéissons plus facilement
qu’à notre bruyante volonté. Celui qui comprend une nouvelle langue saisit un
sens nouveau.
Ainsi
Freud, avec sa nouvelle méthode de psychologie abyssale, découvre un monde psychique
inexploré : grâce à lui seul, la psychologie scientifique, qui n’était pas
l’observation théorique des phénomènes de la conscience, devient ce qu’elle
aurait toujours dû être : l’étude de l’âme. Un hémisphère du Cosmos intérieur
ne reste plus négligé, à l’ombre lunaire de la science. Et dans la mesure où s’éclairent
et se précisent les premiers contours de l’inconscient, se découvre de façon
toujours plus nette une perspective nouvelle sur la structure grandiose et
riche de sens de notre monde psychique.
V : Interprétation des rêves
Comment
les hommes ont-ils si peu réfléchi jusqu’alors aux accidents du sommeil, qui accusent
en l’homme une double vie ? N’y aurait-il pas une nouvelle science dans ce phénomène
?… il annonce au moins la désunion fréquente de nos deux natures. J’ai donc
enfin un témoignage de la supériorité qui distingue nos sens latents de nos
sens apparents.
L’inconscient
est le secret le plus profond de tout homme : la tâche que se propose la
psychanalyse est de l’aider à le dévoiler. Mais comment un secret se
révèle-t-il ?
De
trois manières. On peut arracher de force à un homme ce qu’il cache : ce n’est
pas en vain que les siècles ont montré comment on desserre à l’aide de la
torture les lèvres les plus obstinément closes. On
peut, en combinant les données, deviner une chose dissimulée si l’on profite
des brefs et fugitifs instants où son contour – comme le dos d’un dauphin
au-dessus de l’impénétrable miroir de la mer – émerge de l’obscurité. Enfin, on
peut guetter avec beaucoup de patience le moment où, à l’état de vigilance relâchée,
le secret se trahit lui-même.
La
psychanalyse exerce tour à tour ces trois techniques. Au début, elle essaya de
faire parler de force l’inconscient en le subjuguant par l’hypnose. La
psychologie n’ignorait pas que l’homme sait sur lui-même plus qu’il ne s’avoue
et n’avoue aux autres, mais elle ne connaissait pas le moyen d’aborder ce
subconscient. Le mesmérisme montra le premier qu’à l’état de sommeil hypnotique
on peut tirer d’un homme plus qu’à l’état de veille. Comme celui dont on a anesthésié
la volonté ne sait pas, lorsqu’il est en transe, qu’il parle devant les autres
et croit être seul avec lui-même, il exprime ingénument ses désirs et ses
secrets les plus intimes. C’est pourquoi l’hypnose paraissait d’abord la méthode
la plus riche de promesses ; mais bientôt (pour des raisons qu’il serait trop
long d’exposer en détail) Freud renonce à ce moyen de pénétration violente dans
l’inconscient, qui est immoral et d’ailleurs stérile. De même que la justice,
en une phase plus humaine, renonce volontairement à la torture pour la
remplacer par l’art plus finement ourdi de l’interrogatoire et des indices, la
psychanalyse passe de la première période où l’aveu est arraché de force à
celle où on le devine en combinant les données.
Toute
bête, même la plus agile et la plus légère, laisse des traces sur son passage.
De même que le chasseur retrouve dans la moindre empreinte la marche et
l’espèce du gibier, de même que l’archéologue, sur la foi d’un débris de vase,
établit le caractère d’une génération dans toute une ville ensevelie, de même
la psychanalyse, au cours de sa phase plus avancée, exerce son art de détective
en s’attachant aux faits apparemment insignifiants dans lesquels la vie
inconsciente se trahit à travers le conscient.
Dès
ses premières recherches dans ce sens, Freud découvrit une piste surprenante :
les actes manqués. Par actes manqués (pour toute connaissance nouvelle Freud
trouve toujours le terme frappant qui convient) la psychologie abyssale entend
tous ces phénomènes singuliers qui paraissent à première vue infimes : se
tromper d’expression, prendre une chose pour une autre, faire un lapsus, ce qui
nous arrive à tous dix fois par jour. Mais d’où viennent ces maudites erreurs ?
Quelle est la cause de cette révolte de la matière contre notre volonté ?
Hasard ou lassitude, tout simplement, répond la vieille psychologie, si tant
est qu’elle juge dignes de son attention ces erreurs insignifiantes de la vie quotidienne.
Étourderie, distraction, inattention, dit-elle encore. Mais Freud a le regard
plus aigu : qu’est-ce que l’étourderie, sinon le fait de n’avoir pas ses
pensées là où on le voudrait ? Et si l’on ne réalise point l’acte voulu,
comment se fait-il qu’un autre, involontaire, prenne sa place ? Pourquoi dit-on
un mot différent de celui que l’on voulait dire ? Puisque, dans l’acte manqué, un
acte s’accomplit au lieu de celui qu’on projetait, quelqu’un doit s’être glissé
à l’improviste pour l’exécuter. Il doit y avoir quelqu’un qui fait jaillir le
lapsus au lieu du mot exact, qui cache la chose que l’on voulait trouver, qui
glisse malignement au creux de la main l’objet faux au lieu de celui qu’on
cherchait consciemment.
Freud
dans le domaine psychique (et cette idée domine toute sa méthode) n’admet jamais
qu’une chose soit due au simple hasard ou dénuée de sens. Pour lui tout
événement psychique a un sens précis, toute action son acteur ; et comme, dans
ces actes manqués, le conscient n’agit pas, mais se trouve supplanté, quelle
peut être cette force qui le supplante sinon l’inconscient, cherché depuis si
longtemps et si vainement ? L’acte manqué, pour Freud, ne signifie donc pas
étourderie, absence de pensée, mais au contraire triomphe d’une pensée
refoulée. Par ces lapsus s’exprime « quelque chose » que notre volonté
consciente voulait réduire au silence. Et ce « quelque chose » parle la langue
inconnue, qu’il faut d’abord apprendre, de l’inconscient.
Ainsi
s’éclaire un principe : premièrement, tout acte manqué, toute action résultant
apparemment d’une erreur, exprime un vouloir caché.
Deuxièmement, dans la sphère consciente il doit y avoir une résistance active
contre cette manifestation de l’inconscient. Si,
par exemple (je choisis un des propres exemples de
Freud) un professeur dit du travail d’un collègue, à un congrès : « Nous ne pouvons
suffisamment déprécier cette découverte », son intention consciente
était certes de dire « apprécier »,
mais en son for intérieur il avait pensé
« déprécier ». L’acte manqué trahit son attitude véritable, il
divulgue à sa propre épouvante son secret désir de voir abaisser plutôt
qu’exalter la découverte de son collègue. On dit en se trompant ce qu’en effet
on ne voulait pas dire, mais ce qu’en réalité on avait pensé. On oublie ce qu’intérieurement
on voulait vraiment oublier. Presque toujours l’acte manqué est un aveu et une auto
trahison.
Cette
découverte psychologique de Freud, insignifiante par rapport à ses découvertes
essentielles, est la plus généralement admise, parce que la plus amusante et la
moins choquante : pour sa théorie, elle ne représente qu’une transition. Car
ces actes manqués sont relativement rares ; ils ne nous fournissent que d’infimes
fragments du subconscient, trop peu nombreux et trop disséminés dans le temps
pour qu’on puisse en composer une mosaïque d’importance générale.
Mais
de là, bien entendu, la curiosité observatrice de Freud va plus loin, elle
examine toute la surface de notre vie psychique, pour trouver et interpréter
dans ce sens nouveau d’autres phénomènes « absurdes ». Il n’a pas à chercher
longtemps ; il se trouve vite en face d’une des manifestations les plus
fréquentes de notre vie psychique qui passe également pour absurde, voire pour le
modèle de l’absurde : le rêve.
L’usage
est de considérer le rêve, ce visiteur quotidien de notre sommeil, comme un
intrus étrange, un vagabond capricieux sur la route ordinairement logique et
claire du cerveau. « Tout songe est mensonge », dit-on ; un rêve n’a ni sens ni
but ; c’est un mirage du sang, une bulle de savon et ses images sont sans
signification. On n’a « rien à faire » avec ses rêves ; on n’est pour rien dans
ces jeux naïfs de lutins auxquels se livre notre fantaisie, déclare la vieille
psychologie, en rejetant toute interprétation raisonnable :
se laisser aller à discuter sérieusement avec ce menteur et ce bouffon qu’est le
rêve n’a ni sens ni intérêt au point
de vue scientifique.
Mais
qui parle, qui agit dans nos rêves, qui les peint, les modèle et les sculpte ?
L’Antiquité la plus reculée devinait déjà là le vouloir, l’action et le langage
de quelqu’un d’autre que notre Moi éveillé. Elle disait des rêves qu’ils
étaient « inspirés », introduits en nous par une puissance surhumaine. C’était
là une volonté extra-terrestre, ou, si l’on peut oser ce mot, supersonnelle qui se manifestait. Mais pour toute volonté extérieure
à l’homme le monde mythique ne connaissait qu’une seule interprétation : les
dieux. Car qui, à part eux, avait le pouvoir de produire des métamorphoses et détenait
la puissance suprême ? C’étaient eux, invisibles d’ordinaire, qui dans des
rêves symboliques s’approchaient des hommes, leur murmuraient un message, leur emplissaient
l’esprit de terreur ou d’espoir et, conjurant ou avertissant, traçaient des
images luisantes sur l’écran noir du sommeil. Croyant entendre dans ces
manifestations nocturnes une voix sacrée, une voix divine, les peuples des
temps primitifs mettaient toute leur ferveur à traduire en langage humain cette
langue divine, « le rêve », à y reconnaître la volonté des dieux.
Ainsi,
au commencement de l’humanité, une des premières sciences est l’interprétation
des songes : à la veille des batailles, avant toute décision, après une nuit traversée
de rêves, les prêtres et les sages examinent et interprètent leurs images comme
les symboles d’un danger menaçant ou d’une joie prochaine. Car l’ancien art d’interpréter
les rêves, en opposition avec celui de la psychanalyse qui veut dévoiler à
travers les songes le passé d’un homme, croit que par ces fantasmagories les
immortels annoncent l’avenir aux mortels.
Cette
science mystique s’épanouit, durant des milliers d’années dans les temples des
Pharaons, les acropoles de Grèce, les sanctuaires de Rome et sous le ciel
ardent de Palestine. Pour des centaines et des milliers de peuples et de
générations le rêve était le véritable interprète du destin.
La
nouvelle science empirique, bien entendu, rompt carrément avec cette conception
qu’elle juge superstitieuse et naïve. Niant les dieux et admettant à peine le
divin, elle ne voit dans les songes aucun message du ciel et ne leur trouve du reste
aucun sens. Le rêve est pour elle un chaos, une chose sans valeur, parce que
dénuée de sens, un acte physiologique pur et simple, une vibration tardive,
atone et dissonante du système nerveux, un bouillonnement du sang affluant au cerveau,
un reste d’impressions non digérées au cours de la journée et charriées par le
flot noir du sommeil. Ce mélange incohérent est naturellement privé de tout sens
logique ou psychique. C’est pourquoi la science ne concède à l’imagerie des
rêves ni but ni vérité, ni loi ni signification ; sa psychologie ne cherche pas
à expliquer l’absurde, à interpréter l’importance de ce qui n’en a pas.
Avec
Freud seulement on en revient à une appréciation positive du rêve considéré
comme révélateur du sort. Mais là où les autres ne voyaient que le chaos,
l’incohérence, la psychologie abyssale a reconnu l’enchaînement ; ce qui
semblait à ses prédécesseurs un labyrinthe confus et sans issue, lui apparaît comme
la via regia qui
relie la vie consciente à l’inconsciente. Le rêve est l’intermédiaire entre le
monde de nos sentiments cachés et celui qui est soumis à notre raison : grâce à
lui nous pouvons apprendre bien des choses que nous nous refusons à savoir à
l’état de veille.
Aucun
rêve, déclare Freud, n’est entièrement absurde, chacun, en tant qu’acte psychique
complet, possède un sens précis. Tout songe est la révélation non pas d’une
volonté suprême, divine, surhumaine, mais souvent du vouloir le plus intime et
le plus secret de l’homme.
Certes,
ce messager ne parle pas le langage quotidien de la surface, mais celui de
l’abîme, de la nature inconsciente. Nous ne comprenons pas immédiatement son
sens et sa mission ; nous devons d’abord apprendre à les interpréter. Une science
nouvelle qu’il nous faut créer doit nous enseigner à saisir, à percevoir, à
recomposer en langage compréhensible ce qui passe avec une vitesse
cinématographique sur l’écran noir du sommeil. Car, ainsi que toutes les
langues primitives de l’humanité, celle des Égyptiens, des Chaldéens, des
Mexicains, la langue des songes ne s’exprime qu’en images, et nous avons chaque
fois pour tâche de traduire ses symboles en notions.
Cette
transposition du langage des rêves en langage de la pensée, la méthode
freudienne l’entreprend dans un but nouveau et caractérologique. Si l’ancienne interprétation
prophétique voulait sonder l’avenir, l’interprétation psychologique cherche,
elle, à déceler le passé psycho-biologique et à découvrir
ainsi le présent le plus intime de l’homme. Car le « Moi » qu’on est en
rêve n’est qu’en apparence le même qu’à l’état de veille.
Comme
le temps n’existe pas alors (ce n’est pas par hasard que nous disons qu’une
chose s’est « passée comme un rêve ») nous sommes au moment du rêve simultanément
ce que nous étions jadis et ce que nous sommes maintenant, l’enfant et
l’adolescent, l’homme d’hier et celui d’aujourd’hui, le Moi total, la somme non
seulement de notre vie, mais de tout ce que nous avons vécu, tandis qu’éveillés
nous ne percevons que notre Moi présent. Toute vie est donc double.
En
bas, dans l’inconscient, nous sommes notre totalité, le Jadis et l’Aujourd’hui,
l’homme primitif et le civilisé, mélange confus de sentiments, restes archaïques
d’un Moi plus vaste lié à la nature – en haut, à la lumière claire et
tranchante, rien que le Moi conscient qui existe dans le temps.
Cette
vie universelle, mais plus sourde, communique avec notre existence temporelle
presque uniquement pendant la nuit par ce mystérieux messager des ténèbres : le
rêve ; ce que nous devinons sur nous de plus essentiel, c’est lui qui nous le
suggère. L’écouter, pénétrer son message, c’est donc apprendre notre essence la
plus intime. Celui qui perçoit sa propre volonté non seulement dans sa vie
consciente, mais encore dans les profondeurs de ses rêves, connaît réellement
cette somme de vie vécue et temporelle que nous dénommons notre personnalité.
Mais
comment jeter l’ancre dans ces profondeurs impénétrables et incommensurables ?
Comment reconnaître d’une manière précise ce qui ne se montre jamais nettement,
ce qui ne s’exprime que par symboles ? Comment cette lumière trouble qui
vacille dans les labyrinthes de notre sommeil peut-elle nous éclairer ? Trouver
une clef, découvrir le chiffre révélateur qui traduit dans la langue du conscient
les images incompréhensibles des rêves, semble exiger l’intuition d’un voyant,
la puissance d’un magicien.
Mais
Freud possède dans son atelier psychologique un rossignol qui lui ouvre toutes
les portes, il use d’une méthode presque infaillible : partout où il veut
atteindre au plus compliqué, il part du plus simple. Il place toujours la forme
première près de la forme dernière ; partout et toujours, pour comprendre la
fleur, il remonte d’abord jusqu’aux racines. C’est pourquoi Freud part de
l’enfant dans sa psychologie du rêve, au lieu de partir de l’adulte conscient
et cultivé. Car dans la conscience infantile l’imagination n’a encore
emmagasiné que peu de chose, le cercle des pensées est encore restreint,
l’association faible, donc les matériaux des rêves facilement accessibles. Le
rêve infantile n’exige qu’un minimum d’interprétation. L’enfant a passé devant
une chocolaterie, les parents n’ont rien voulu lui acheter, il rêve de chocolat.
Tout naturellement, dans le cerveau de l’enfant la convoitise se transforme en
image, le désir en rêve. La retenue, la pudeur, l’inhibition intellectuelle ou morale,
tout cela est encore absent. Aussi ingénument qu’il expose à tout venant son physique,
son corps, nu et ignorant de la honte, l’enfant dévoile en rêve ses désirs
intimes.
Ainsi
se prépare, dans une certaine mesure, l’interprétation future. Les images
symboliques du rêve cachent donc, pour la plupart, des désirs refoulés ou
inexaucés, qui, n’ayant pu se réaliser le jour, cherchent à rentrer dans notre
vie par le chemin des songes. Ce qui, pour des raisons quelconques, n’a pu,
dans la journée, devenir action ou parole, s’y exprime en multicolores
fantaisies ; nues et insouciantes les aspirations et les envies du Moi
intérieur peuvent s’ébattre à l’aise dans le flot libre du rêve.
Ce
qui ne peut s’affirmer dans la vie réelle – les plus sombres désirs, les
ardeurs les moins admises et les plus dangereuses – s’y déploie apparemment
sans entraves (bientôt Freud corrigera cette erreur) ; dans cet enclos
inaccessible, l’âme parquée tout le jour peut se décharger enfin de toutes ses tendances
agressives et sexuelles ; en rêve l’homme peut étreindre et violer la femme qui
se refuse à lui dans la vie, le mendiant se saisir de la richesse, l’être laid
se parer d’un beau masque, le vieillard rajeunir, le désespéré devenir heureux,
l’oublié célèbre, le faible fort. Là seulement l’homme peut tuer ses ennemis, assujettir
ses supérieurs, vivre avec une frénésie extatique, divinement libre et
illimitée, son intime et profond vouloir. Tout rêve ne signifie donc pas autre
chose qu’un désir réprimé pendant la journée ou dissimulé à soi-même : telle
paraît être la formule initiale.
Le
grand public en est resté à cette première constatation provisoire de Freud,
car la formule : le rêve correspond à un désir inassouvi, est si commode et si
facile qu’on peut jouer à la balle avec elle. En effet, dans certains milieux
on croit s’occuper sérieusement d’analyse des songes en s’amusant à ce petit jeu
de société qui consiste à chercher à travers les rêves les symboles du désir et
de la sexualité.
En
réalité personne n’a considéré avec plus de respect que Freud les mailles multiples
du réseau des songes, personne n’a comme lui célébré l’art mystique de ses
dessins enchevêtrés. Sa méfiance à l’égard des résultats trop vite obtenus ne
fut pas longtemps à s’apercevoir que ces rapports si directs et si faciles à reconnaître
entre le désir et le rêve n’avaient trait qu’au rêve, peu compliqué, de
l’enfant. Chez l’adulte, la fantaisie créatrice se sert d’un formidable
matériel symbolique de souvenirs et d’associations ; le vocabulaire d’images,
qui dans le cerveau de l’enfant comprend tout au plus quelques centaines de représentations
distinctes, trame ici en de troublantes textures, avec une rapidité et une
habileté inconcevables, des millions et peut-être des milliards d’événements vécus.
Finie,
dans le rêve de l’adulte, cette nudité de l’âme infantile, ignorant la honte,
montrant ses désirs sans entraves ; fini, le bavardage insouciant de ces premiers
jeux nocturnes ; non seulement le rêve de l’adulte est plus différencié, plus
raffiné que celui de l’enfant, mais il est encore hypocrite, fourbe, menteur :
il est devenu à moitié moral. Même en ce monde caché des fantaisies l’éternel Adam
qui vit en l’homme a perdu le paradis de l’ingénuité ; il connaît le bien et le
mal jusqu’au plus profond de son rêve. Même en songe, la porte de la conscience
éthique et sociale n’est pas complètement fermée, et, les yeux clos, les sens flottants,
l’âme de l’homme craint d’être prise en flagrant délit de crimes rêvés,
d’envies indécentes, par sa « censure » intérieure, la conscience – le sur-Moi,
comme l’appelle Freud. Le rêve n’apporte donc pas librement et ouvertement les
messages de l’inconscient, mais les glisse en contrebande, par des voies
secrètes, sous les travestissements les plus singuliers. Dans le rêve de
l’adulte un sentiment veut s’exprimer, mais n’ose le faire librement
; par peur de la censure, il ne parle que par déformations voulues
et très raffinées, il met en avant quelque absurdité pour ne pas laisser
deviner son sens réel : le rêve, comme tout poète, est un menteur véridique ;
il confesse « sub rosa », il dévoile, mais en symboles
seulement, un événement intérieur.
Il
faut donc distinguer soigneusement deux choses : ce que le rêve a « poétisé »
dans le but de voiler – ce qu’on appelle le « travail du rêve » – et ce qui se
cache d’éléments psychiques véritables sous ces voiles confus, c’est-à-dire le
« contenu du rêve ». La tâche de la psychanalyse est de débrouiller cet
écheveau troublant de déformations et de dégager de ce
roman à clef – tout rêve étant « Poésie et Vérité » –
la vérité, l’aveu véritable et par là le noyau du fait. Ce n’est pas ce que dit
le rêve, mais uniquement ce qu’au fond il voulait dire
qui nous fait pénétrer dans l’inconscient de la vie psychique. Là seulement est
la profondeur vers laquelle tend la psychologie abyssale.
Mais
en attribuant à l’analyse des rêves une importance particulière pour l’étude de
la personnalité, Freud ne s’abandonne aucunement à une vague interprétation des
songes. Il exige un processus de recherches scientifiquement exact, semblable à
celui que le critique littéraire applique à une œuvre poétique. De même que
celui-ci s’efforce de séparer les accessoires fantaisistes du noyau vécu, se
demande ce qui a poussé le poète à l’affabulation des faits, de même le
psychanalyste recherche dans la fiction du rêve la poussée affective de son
malade.
C’est
à travers ses rêves que l’image d’un individu apparaît le plus nettement à
Freud ; ici comme toujours il pénètre bien plus profondément les sentiments de l’homme
lorsqu’il est en état de création. Comme le but essentiel du psychanalyste est
de connaître la personnalité, il se sert alors de la substance inventive de
l’homme, des matériaux du rêve, en les passant au crible de son jugement ; s’il
évite les exagérations, s’il résiste à la tentation d’inventer lui-même un sens,
il peut, dans beaucoup de cas, trouver des points d’appui importants pour
définir la situation intérieure de la personnalité.
Il
est hors de doute que l’anthropologie, grâce à cette découverte productive du
symbolisme psychique de certains rêves, doit à Freud des indications précieuses
; mais au cours de ses recherches il a dépassé cette sphère pour réaliser une conquête
plus importante : il a interprété pour la première fois le sens biologique du
phénomène du rêve comme nécessité psychique. La science avait établi depuis
longtemps la signification du sommeil dans l’organisation de la nature : renouvellement
des forces épuisées par les actions de la journée, remplacement de la substance
nerveuse utilisée et brûlée, interruption du travail fatigant et ;conscient du cerveau par une pause d’oisiveté.
Par
conséquent, la forme hygiénique la plus parfaite du sommeil devrait être en
somme un vide noir, quelque chose de semblable à la mort, un arrêt de toute
activité cérébrale, ne pas voir, ne pas savoir, ne pas penser : pourquoi donc
la nature n’a-t-elle pas accordé à l’homme cette forme apparemment la plus
efficace de détente ? Pourquoi, elle, qui est toujours sensée, a-t-elle projeté
sur l’écran noir du sommeil des images si troublantes, pourquoi interrompt-elle
toutes les nuits le vide total, l’évanouissement dans le nirvana avec ces
apparitions flottantes et trompeuses ? À quoi bon les rêves qui interceptent,
dérangent, troublent, entravent, au fond, la détente si sagement conçue ? En effet,
ces phénomènes qui semblent absurdes ne sont-ils pas un contresens de la nature
qui d’ordinaire a toujours un but et obéit à un vaste système ? À cette
question très naturelle, la science de la vie, jusqu’alors, ne savait que
répondre.
Freud,
pour la première fois, établit que les rêves sont nécessaires à la stabilisation
de notre équilibre psychique. Le rêve est la soupape de nos sentiments. Car
notre soif infinie de vie et de jouissance, nos désirs illimités sont à
l’étroit dans notre corps terrestre. Parmi les myriades de désirs qui
assaillent l’homme moyen, combien peut-il vraiment en satisfaire au cours d’une
journée bourgeoisement délimitée ? C’est à peine si chacun de nous arrive à réaliser
un millième de ses aspirations. Un désir inapaisé et inapaisable, visant
l’absolu, bouillonne jusque dans la poitrine du fonctionnaire, du petit
rentier, du travailleur le plus misérable. En nous tous fermentent furieusement
des envies mauvaises, une impuissante volonté de puissance, des convoitises
anarchiques refoulées et lâchement déformées, une vanité déguisée, de violentes
passions et jalousies ; déjà chaque femme qui passe n’éveille-t-elle pas sur son
chemin de multiples et brefs désirs ? Et toute cette soif de possession, toutes
ces envies, toutes ces convoitises insatisfaites se glissent, s’enchevêtrent et
s’accumulent méchamment dans le subconscient, dès le son de la cloche matinale
jusque dans la nuit. Sous cette pression atmosphérique, l’âme ne devait-elle
pas exploser ou se décharger en violences meurtrières, si le rêve nocturne ne
procurait un débouché aux désirs refoulés ?
En
ouvrant, sans danger, la porte du rêve à nos convoitises enfermées tout le
jour, nous libérons notre vie sentimentale de ses hantises, nous désintoxiquons
nos âmes, de même que par le sommeil nous délivrons le corps de l’intoxication
de la fatigue. Nos impulsions criminelles au point de vue social, nous les « abréagissons
», au lieu de nous laisser aller à des actes passibles de la prison, en actions
imaginaires et inoffensives, dans un monde apparent et accessible à nous seuls.
Le
rêve est le substitut de l’acte, qu’il nous évite souvent ; c’est pourquoi la
formule de Platon : « Les bons sont ceux qui se bornent à rêver ce que les
autres font réellement » est si magistrale et si parfaite. Le rêve ne nous
visite pas pour troubler notre sommeil, mais pour le garder ; grâce à ses
visions hallucinantes, l’âme sous pression se décharge de ses tensions – (« Ce
qui s’amasse au fond du cœur s’éternue en rêve », dit un dicton chinois) – de
sorte que
le matin le corps ravivé retrouve une âme purifiée
et légère, au lieu d’une âme qui étouffe.
Freud
a reconnu en cette action affranchissante, cathartique, le sens du rêve dans
notre vie, sens longtemps ignoré et nié. Et cette découverte s’applique aussi
bien au visiteur nocturne du sommeil qu’aux formes plus élevées de toute
rêverie et de tout rêve diurne, telles que le
mythe et la poésie.
Car le but et le vouloir de la poésie, quel est-il, sinon de délivrer
par le symbole l’homme de ses tensions intérieures, d’évacuer dans une zone
paisible le trop-plein qui submergeait son âme.
Et de
même que les individus se libèrent dans le rêve de leurs tourments et de leurs
convoitises, de même les peuples échappent à leurs craintes et trouvent des
débouchés à leurs désirs dans ces créations plastiques que nous appelons religions
et mythes : les instincts sanglants réfugiés dans le symbole se purifient sur
les autels sacrés, et la pression psychique se transforme en paroles
libératrices par la prière et la confession. L’âme de l’humanité ne s’est
jamais révélée que dans la poésie comme imagination créatrice.
Nous
devons la divination de sa force réalisatrice uniquement à ses rêves incarnés
en religions, en mythes et en œuvres d’art. Aucune science psychique – cette connaissance,
Freud l’a imposée à notre époque – ne peut donc atteindre l’essence de la
personnalité de l’homme, si elle ne considère que son activité éveillée et
responsable : il faut aussi qu’elle descende dans l’abîme où son être, demeuré
mythe, forme précisément dans le flux de la création inconsciente l’image la
plus véridique de sa vie intérieure.
VI : La technique de la psychanalyse
Il
est étrange que la vie intérieure de l’homme ait été si médiocrement étudiée et
si pauvrement traitée. On ne s’est guère encore servi de la physique pour l’âme
ni de l’âme pour le monde extérieur.
En de
rares endroits de notre écorce terrestre multiforme, le pétrole jaillit des
profondeurs de la terre, de façon soudaine et inattendue ; en d’autres, l’or
brille dans le sable des rivages ; en d’autres encore le charbon gît à fleur de
terre. Mais la technique humaine n’attend pas que ces événements exceptionnels
nous fassent, çà et là, la grâce de se produire. Elle ne compte pas sur le hasard,
elle perce le sol pour en faire sortir le liquide précieux, elle creuse des
galeries dans les entrailles de la terre, elle en creuse en vain des centaines
avant d’atteindre le minerai recherché.
De même
une science psychique active ne peut pas se contenter des aveux fortuits et
d’ailleurs partiels que fournissent les rêves et les actes manqués : il faut
aussi, pour s’approcher de la véritable couche de l’inconscient, qu’elle
recoure à une psychotechnique, à un travail en profondeur, que, par un effort systématique
et toujours tendu vers le but, elle pénètre jusqu’au tréfonds de la région souterraine.
C’est à quoi Freud est arrivé et il a donné à sa méthode le nom de
psychanalyse.
Elle
ne rappelle en rien aucune des méthodes antérieures de la médecine ou de la
psychologie. Elle est complètement neuve et autochtone, elle représente un
procédé indépendant de tous les autres, une psychologie à côté de toutes celles
d’autrefois, souterraine, si l’on peut dire, et surnommée pour cela, par Freud
même, psychologie abyssale.
Le
médecin qui veut l’appliquer se sert de ses connaissances universitaires dans une
mesure si insignifiante qu’on en arrive bientôt à se demander si le
psychanalyste a vraiment besoin d’une instruction médicale spéciale ; en effet,
après avoir longuement hésité, Freud admet « l’analyse laïque », c’est-à-dire
le traitement par des médecins non diplômés. Car le guérisseur d’âmes dans le
sens freudien abandonne les recherches anatomiques au physiologue, son effort
ne tend qu’à rendre visible l’invisible. Comme il ne cherche rien de palpable
ou de tangible, il n’a besoin d’aucun instrument ; le fauteuil dans lequel il
est installé représente tout l’appareil médical de sa thérapeutique.
La psychanalyse évite toute intervention, tant
physique que morale. Son intention n’est pas d’introduire en
l’homme une chose nouvelle, foi ou médicament, mais d’extraire de lui quelque
chose qui s’y trouve. Seule la connaissance active de soi amène la guérison
dans le sens psychanalytique ; c’est seulement quand le malade est ramené à lui-même,
à sa personnalité et non pas à une banale foi guérisseuse, qu’il devient
seigneur et maître de sa maladie. L’opération, ainsi, ne se fait pas du dehors,
mais s’accomplit entièrement dans l’élément psychique du patient.
Le
médecin n’apporte à ce genre de traitement que son expérience, sa surveillance et
sa prudente direction. Il n’a pas de remèdes tout faits comme le praticien : sa
science n’est ni formulée ni codifiée, elle est distillée peu à peu de
l’essence vitale du malade. Quant à ce dernier, il n’apporte au traitement que
son conflit. Mais au lieu de l’apporter clairement et ouvertement, il le présente
sous les voiles, les masques, les déformations les plus étranges et les plus
trompeurs, de sorte qu’au début la nature de sa maladie n’est reconnaissable ni
pour lui ni pour son médecin. Ce que le névrosé fait voir et avoue n’est qu’un
symptôme. Mais les symptômes, dans la vie psychique, ne montrent jamais
nettement la maladie, ils la dissimulent, au contraire ; car, d’après la conception,
tout à fait neuve, de Freud, les névroses en elles-mêmes n’ont aucune
signification, mais elles ont toutes une cause distincte.
Ce
qui le trouble vraiment, le névrosé ne le sait pas, ou ne veut pas le savoir,
ou ne le sait pas consciemment. Depuis des années son conflit intérieur se
manifeste dans tant de symptômes et d’actes forcés que finalement il arrive à
ne plus savoir en quoi il consiste. C’est alors qu’intervient le psychanalyste.
Sa
tâche est d’aider le névrosé à déchiffrer l’énigme dont il est lui-même la
solution. Il cherche avec lui, dans le miroir des symptômes, les formes
typiques qui provoquèrent le malaise ; petit à petit ils contrôlent
rétrospectivement tous les deux la vie psychique du malade, jusqu’à la
révélation et l’éclaircissement définitif du conflit intérieur.
Au
début, cette technique du traitement psychanalytique fait bien plus penser à la
criminologie qu’à la médecine. Chez tout névrosé, chez tout neurasthénique,
d’après Freud, l’unité de la personnalité a été brisée, on ne sait quand ni
comment, et la première mesure à prendre est de s’informer le plus exactement possible
des « faits de la cause » ; le lieu, le temps et la forme de cet événement
intérieur oublié ou refoulé doivent être reconstitués par la mémoire psychique
aussi exactement que possible.
Mais
dès ce premier pas le procédé psychanalytique rencontre une difficulté que ne
connaît pas la jurisprudence. Car, dans la psychanalyse, le patient, jusqu’à un
certain degré, représente tout en même temps. Il est celui sur qui a été perpétré
le crime, et il est également le criminel. Il est par ses
symptômes accusateur et témoin à charge, et simultanément c’est lui qui
dissimule et embrouille furieusement les faits.
Quelque
part, au tréfonds de lui-même, il sait ce qui s’est passé, et cependant il ne
le sait pas ; ce qu’il dit des causalités n’est pas la cause ; ce qu’il sait,
il ne veut pas le savoir, et ce qu’il ne sait pas, il le sait pourtant d’une
façon quelconque.
Mais,
chose plus fantastique encore, ce procès n’a pas commencé à la consultation du
neurologue ; en réalité il se poursuit depuis des années de façon
ininterrompue, chez le névrosé, sans jamais pouvoir se terminer. Et ce que
l’intervention psychanalytique doit obtenir en dernier ressort, c’est
précisément la fin de ce procès ; c’est donc, sans qu’il s’en rende compte,
pour parvenir à cette solution, à ce dénouement, que le malade appelle le
médecin.
Mais
la psychanalyse n’essaie pas, par une formule rapide, d’arracher immédiatement
à son conflit le névrosé, l’homme qui s’est égaré dans le labyrinthe de son
âme. Au contraire, elle le ramène tout d’abord, à travers le dédale des errements
de sa vie, à l’endroit décisif où a commencé la grave déviation. Pour corriger
dans la texture manquée la trame fausse, pour renouer le fil, le tisserand doit
replacer la machine là où le fil a été rompu. De même, pour renouveler la
continuité de la vie intérieure, le médecin de l’âme doit inévitablement revenir
encore et toujours à l’endroit où la brisure s’est produite : il n’y a ni précipitation,
ni intuition, ni vision qui compte.
Déjà
Schopenhauer, dans un domaine voisin, avait exprimé la supposition qu’une guérison
complète de la démence serait concevable si l’on pouvait atteindre le point où
s’est produit le choc décisif dans l’imagination ; pour comprendre la
flétrissure de la fleur, le chercheur doit descendre jusqu’aux racines, jusque
dans l’inconscient. Et c’est un labyrinthe souterrain, vaste et plein de
détours, de dangers et de pièges qu’il lui faut parcourir. De même qu’un
chirurgien, au cours d’une opération, devient d’autant plus prudent et
circonspect qu’il se rapproche de la texture délicate des nerfs, de même la
psychanalyse tâtonne, avec une lenteur pénible, à travers cette matière,
suprêmement meurtrissable, d’une couche de vie à une
autre plus profonde. Chaque traitement dure non pas des jours et des semaines,
mais toujours des mois, parfois des années ; il exige du thérapeute une concentration
de l’âme que la médecine n’avait même pas soupçonnée jusqu’ici et qui n’est peut-être
comparable par la force et la durée qu’aux exercices de volonté des Jésuites.
Tout dans cette cure se fait sans annotations, sans aide aucune ; le seul moyen
auquel on fasse appel est l’observation, une observation s’étendant sur de
vastes espaces de temps.
Le
malade se met sur un divan, de façon à ne pas voir le médecin assis derrière
lui (ceci pour éliminer les entraves de la pudeur et de la conscience), et il
parle. Mais ce qu’il raconte ne s’enchaîne pas, contrairement à ce que croient
la plupart ; ce n’est pas une confession. Vu par le trou de la serrure, ce
traitement offrirait le spectacle le plus grotesque, car en des mois et des
mois, apparemment, il ne se passe rien, sinon que des deux hommes l’un parle et
l’autre écoute. Le psychanalyste recommande surtout à son patient de renoncer
au cours de ce récit à toute réflexion consciente et de ne pas intervenir dans
la procédure en cours comme avocat, juge ou plaignant ; il ne doit donc rien vouloir,
mais uniquement céder sans raisonnement aux idées qui lui viennent
involontairement à l’esprit (car ces idées, précisément, ne lui viennent pas du
dehors, mais du dedans, de l’inconscient). Il n’a pas à chercher ce qui, selon
lui, a trait au cas, car son déséquilibre psychique témoigne justement qu’il ne
sait pas ce qu’est son « cas », sa maladie. S’il le savait, il serait
psychiquement normal, il ne se créerait pas de symptômes et n’aurait pas besoin
de médecin. La psychanalyse rejette pour cette raison tous les récits préparés
ou écrits et ne demande au patient que de raconter sans suite tout ce qui lui
vient à l’esprit comme souvenirs psychiques. Le névrosé doit parler sans détour,
dire carrément tout ce qui lui passe dans le cerveau, en vrac, sans ordre, même
ce qui n’a point de valeur apparente, car les idées les plus inattendues, les
plus spontanées, qu’on n’a pas cherchées, sont les plus importantes pour le
médecin.
Ce
dernier ne peut se rapprocher de l’essentiel qu’au moyen de ces « détails
secondaires ». Vrai ou faux, important ou insignifiant, sincère ou théâtral,
n’importe : la tâche principale du malade est de raconter beaucoup, de fournir
le plus possible de matériaux, de substances biographique et caractérologique.
C’est
alors que commence la besogne proprement dite de l’analyste. Il faut qu’il
passe au crible psychologique les multiples brouettées, charriées peu à peu, du
formidable tas de décombres de l’édifice vital tombé en ruine – ces milliers de
souvenirs, de remarques, de rêves, que lui a livrés le patient ; il faut qu’il
en rejette les scories et qu’il extraie des matériaux qui lui restent, au moyen
d’une lente refonte, la véritable matière psychanalytique. Jamais il ne doit
accorder une pleine valeur à la matière première des récits du patient ;
toujours il doit se souvenir « que les communications et les idées du malade ne
sont que des déformations de ce qu’on cherche, des allusions, pour ainsi dire, derrière
lesquelles se cachent des choses qu’il faut deviner ».
Car
ce qui importe pour le diagnostic de la maladie, ce ne sont pas les choses vécues
par le névrosé (son âme s’en est depuis longtemps déchargée) mais celles qu’il
n’a pas encore vécues, ce surplus affectif inemployé qui l’oppresse comme un
morceau non digéré pèse sur l’estomac, qui comme lui cherche une issue, mais est
à chaque fois arrêté par une volonté contraire. Cet élément inhibé et son
inhibition, le médecin doit chercher à les déterminer dans chaque manifestation
psychique « avec une égale et subtile attention », pour parvenir peu à peu
au soupçon et du soupçon à la certitude.
Mais
cette observation calme, positive, faite du dehors, lui est à la fois facilitée
et rendue plus pénible, surtout au début de la cure, par l’attitude affective
presque inévitable du malade que Freud nomme « le transfert ». Le névrosé, avant
de s’adresser au médecin, a traîné longtemps, sans jamais pouvoir s’en
délivrer, cet excès de sentiment non vécu et inemployé. Il le transporte dans
des douzaines de symptômes, il se joue à lui-même, dans les jeux les plus
singuliers, son propre conflit inconscient ; mais dès qu’il trouve pour la
première fois dans la personne du psychanalyste un auditeur attentif et un
partenaire professionnel, il lui jette immédiatement son fardeau comme une balle,
il tente de se décharger sur lui de ses sentiments inutilisés. Il établit entre
le médecin et lui certains « rapports », certaines relations affectives
intenses, haine ou amour, n’importe. Ce qui jusqu’ici s’agitait follement dans
un monde illusoire, sans jamais pouvoir se montrer nettement, réussit à se
fixer comme sur une plaque photographique.
Seul
ce « transfert » crée vraiment la situation psychanalytique : le malade qui
n’en est pas capable doit être considéré comme inapte à la cure. Car le
médecin, pour reconnaître le conflit, doit le voir se dérouler devant lui sous
une forme vivante, émotionnelle : le malade et le docteur doivent le vivre
en commun. Cette communauté dans le travail psychanalytique
consiste pour le malade à produire ou plutôt reproduire le conflit et pour le médecin
à en expliquer le sens. Pour cette explication et cette interprétation il n’a
pas à compter du tout (comme on serait immédiatement tenté de le croire) sur l’aide
du malade ; tout psychisme est dominé par la dualité et le double sens des
sentiments.
Le même patient qui se rend chez le psychanalyste
pour se débarrasser de sa maladie – dont il ne connaît que le symptôme – se
cramponne en même temps inconsciemment à elle, car cette maladie-là ne
représente pas une matière étrangère, elle est son produit à lui, son œuvre la
plus intime, une partie active et caractéristique de son Moi dont il ne veut
pas se débarrasser. Il tient solidement à sa maladie, parce qu’il préfère ses
symptômes désagréables à la vérité, qu’il craint, et que le médecin veut lui
expliquer (en somme, contre son désir). Comme il sent et raisonne doublement,
d’une part du point de vue de l’inconscient, d’autre part du point de vue du conscient,
il est en même temps le chasseur et la bête traquée ; seule une partie du
patient est l’auxiliaire du médecin, l’autre demeure son
adversaire le plus acharné, tandis que volontairement, en
apparence, il lui glisse des aveux d’une main, de l’autre, simultanément, il
embrouille et cache les faits réels. Donc, consciemment, le névrosé ne peut en rien
aider celui qui veut le délivrer, il ne peut pas lui dire la
vérité, car c’est précisément le fait de ne pas la savoir, ou de
ne pas vouloir la savoir, qui a produit chez lui ce déséquilibre et ce trouble.
Même aux moments où il veut être sincère, il ment à son propre sujet. Sous
chaque vérité qu’il énonce s’en cache une autre plus profonde, et lorsqu’il avoue
une chose, ce n’est souvent que pour dissimuler, derrière cet aveu, un secret
encore plus intime.
Le
désir d’avouer et la honte s’emmêlent et s’entrechoquent ici mystérieusement ;
le malade, en racontant, tantôt se donne et tantôt se reprend, et sa volonté de
se confesser est inévitablement interrompue par l’inhibition. Quelque chose, en
tout homme, se contracte comme un muscle, dès qu’un autre veut connaître ce
qu’il a de plus caché : toute psychanalyse, en réalité, est donc une lutte.
Mais
le génie de Freud sait toujours faire de l’ennemi le plus acharné l’auxiliaire
le meilleur. Cette résistance elle-même trahit souvent l’involontaire aveu.
Pour l’observateur à l’ouïe fine, l’homme se trahit doublement au cours de l’entretien,
premièrement par ce qu’il dit, et deuxièmement par ce qu’il passe sous silence.
C’est précisément lorsque le patient veut, mais ne peut pas parler, que l’art détective
de Freud s’exerce avec le plus de certitude et qu’il devine la présence du
mystère décisif : l’inhibition, traîtreusement, se fait une auxiliaire et
indique le chemin.
Quand
le malade s’exprime trop haut ou trop bas, quand il hésite ou se hâte, c’est là
que l’inconscient veut parler. Et toutes ces innombrables petites résistances,
ces ralentissements, ces légères hésitations, dès que l’on approche d’un
certain complexe, montrent enfin nettement avec l’inhibition sa cause et son
contenu, c’est-à-dire, en un mot, le conflit cherché et caché.
Car
toujours, au cours d’une psychanalyse, il s’agit de révélations
infinitésimales, de minuscules fragments d’événements vécus, dont se compose
peu à peu la mosaïque de l’image vitale intérieure. Rien de plus naïf que
l’idée courante adoptée dans les salons et les cafés qu’on n’a qu’à jeter dans
le psychanalyste, comme dans un appareil automatique, des rêves et des aveux, à
le mettre en marche par quelques questions, et à en tirer immédiatement un
diagnostic. En réalité, toute cure psychanalytique est un processus
formidablement compliqué, qui n’a rien de mécanique et tient plutôt de l’art ;
à la rigueur elle est peut-être comparée à la restauration, selon toutes les
règles, d’un tableau ancien sali et repeint par une main maladroite – opération
qui exige une patience inouïe, où il faut, millimètre par millimètre, couche
après couche, faire revivre une matière précieuse et délicate avant que l’image
primitive ne reparaisse sous ses couleurs naturelles.
Bien
que s’occupant sans cesse des détails, le psychanalyste ne vise pourtant que le
tout, la reconstruction de la personnalité : c’est pourquoi, dans une analyse véritable,
on ne peut jamais s’arrêter à un complexe isolé ; chaque fois, il faut
reconstruire, en partant des fondements, toute la vie psychique de l’homme. La
première qualité qu’exige cette méthode est donc la patience, alliée à une
attention permanente – sans être ostensiblement tendue – de l’esprit ; sans en
avoir l’air, le médecin doit répartir son attention impartialement et sans préjugés
entre les dires et les silences du patient, surveillant en outre avec vigilance
les nuances de son récit. Il doit chaque fois confronter les dépositions de la séance
avec celles de toutes les séances précédentes, pour remarquer quels sont les
épisodes que son interlocuteur répète le plus souvent et sur quels points son
récit se contredit, mais sans jamais trahir par sa vigilance le but de sa
curiosité.
Car
dès que le malade flaire qu’on l’espionne, il perd sa spontanéité – qui seule
amène ces brefs éclairs phosphorescents de l’inconscient, à la lumière desquels
le médecin reconnaît les contours du paysage de cette âme étrangère. Mais il ne
doit pas non plus imposer au malade sa propre interprétation, car le sens de la
psychanalyse est précisément d’obliger l’auto-compréhension du malade à se
développer.
Le
cas idéal de guérison ne se produit que lorsque le patient reconnaît enfin lui-même
l’inutilité de ses démonstrations névrosiques et ne dépense
plus ses énergies affectives en rêves et en délires, mais les traduit en actes
réels. Alors seulement l’analyste en a fini avec le
malade.
Mais
combien de fois – question épineuse ! – la psychanalyse arrive-telle à une
solution si parfaite ? Je crains bien que la chose ne se produise pas très
souvent. Car son art d’interroger et d’écouter exige une telle ouïe du cœur,
une telle clairvoyance du sentiment, un alliage si extraordinaire des substances
spirituelles les plus précieuses que seul un être
prédestiné, un être ayant vraiment la vocation de
psychologue, est capable ici d’agir en guérisseur.
La
Christian Science, la méthode de Coué, peuvent se permettre de former de
simples mécaniciens de leur système. Il leur suffit d’apprendre par cœur
quelques formules passepartout : « Il n’y a pas de maladie », « Je me sens
mieux tous les jours » ; au moyen de ces idées grossières, les mains les plus
dures martèlent sans grand danger les âmes faibles, jusqu’à ce que le pessimisme
de la maladie soit totalement détruit. Mais dans la cure psychanalytique le
médecin vraiment honnête a le devoir, pour chaque cas individuel, de trouver un
système indépendant, et ce genre d’adaptation créatrice ne s’enseigne pas, même
en y mettant de l’intelligence et de l’application. Il exige un connaisseur d’âmes
né et expérimenté, doué de la faculté de s’introduire par la pensée et le
sentiment dans les destins les plus étrangers, possédant en outre beaucoup de
tact et capable de la plus grande patience d’observation. De plus, un
psychanalyste vraiment réalisateur devrait dégager un certain élément magique,
un courant de sympathie et de sécurité, auquel toute âme étrangère se
confierait volontairement, avec une obéissance passionnée – qualités qui ne
peuvent s’apprendre et ne se trouvent réunies chez le même homme que par la grâce.
La rareté de ces vrais maîtres de l’âme me paraît être la raison pour laquelle
la psychanalyse restera toujours une vocation à la portée de quelques-uns et ne
pourra jamais être considérée comme un métier et une affaire – contrairement à
ce qui arrive trop souvent, hélas, aujourd’hui.
Mais
Freud fait preuve, à ce sujet, d’une indulgence curieuse ; quand il dit que la
pratique efficace de son art d’interprétation exige, bien entendu, du tact et
de l’expérience, mais qu’elle n’est « point difficile à apprendre », qu’il nous
soit permis de tracer en marge de sa phrase un grand et presque furieux point
d’interrogation. Déjà le mot « pratique » me paraît
malheureux par rapport à un processus exigeant la mise en œuvre
des forces les plus grandes du savoir psychique et même le recours à une sorte
d’inspiration psychique ; mais le fait de dire que cette « pratique » s’acquiert
facilement me semble vraiment dangereux. Car l’étude la plus consciencieuse de
la psychotechnique fait aussi peu le vrai psychologue que la
connaissance de la versification fait le
poète ; c’est pourquoi personne d’autre que le psychologue-né, l’homme doué du
pouvoir de pénétrer l’âme humaine, ne devrait être admis à toucher à cet «
organe » qui est le plus fin, le plus subtil et le plus délicat de tous.
On
frémit en pensant au danger que pourrait devenir entre des mains grossières la
méthode inquisitoriale de la psychanalyse que le cerveau créateur de Freud
enfanta dans la plus haute conscience de son extrême délicatesse. Rien, probablement,
n’a autant nui à la réputation de la psychanalyse que le fait de n’être pas
restée l’apanage d’une élite, d’une aristocratie d’âmes et d’avoir voulu
enseigner dans des écoles ce qui ne s’apprend pas. Car le passage hâtif et
inconsidéré de main en main de plusieurs de ses idées ne les a pas précisément clarifiées,
bien au contraire ; ce qui aujourd’hui, dans l’Ancien et plus encore dans le
Nouveau Monde, se fait passer pour de la psychanalyse d’amateur ou
professionnelle n’est souvent qu’une triste parodie de l’œuvre primitive de
Sigmund Freud basée sur la patience et le génie.
Celui
qui veut juger impartialement devra constater que par suite de ces analyses
d’amateurs on ne peut à l’heure actuelle se rendre compte honnêtement des
résultats de la psychanalyse ; à la suite de l’intervention de dilettantes douteux,
pourra-t-elle jamais s’affirmer avec la validité absolue d’une méthode clinique
exacte ? Ce n’est pas à nous qu’il appartient d’en décider, mais à l’avenir.
La
technique psychanalytique de Freud, cela seul est certain, est loin de
représenter le dernier mot dans le domaine de la médecine psychique. Mais elle
garde à tout jamais la gloire de nous avoir ouvert un livre qui fut trop
longtemps scellé, de représenter la première tentative méthodologique faite en
vue de comprendre et de guérir l’individu par la matière même de sa personnalité.
Avec
son instinct génial, Freud seul a dénoncé le vacuum de la
médecine moderne, le fait inconcevable que depuis longtemps des traitements
avaient été
découverts pour les parties les moins importantes du corps
de l’homme – traitement des dents, de la peau, des cheveux – alors que seules
les maladies de l’âme n’avaient encore trouvé aucun refuge dans la science.
Jusqu’à l’âge adulte, les pédagogues aidaient l’individu incomplètement développé,
puis ils l’abandonnaient avec indifférence à lui-même. Et l’on oubliait
totalement ceux qui à l’école n’en avaient pas fini avec eux-mêmes, n’avaient
pas terminé leur pensum et traînaient, impuissants, leurs conflits non abréagis.
Pour ces névrosés, ces psychosés, ces arriérés de l’âme, emprisonnés dans le
monde de leurs instincts, il n’y avait pas de lieux de consultations ; l’âme
malade errait sans appui dans les rues, cherchant en vain une assistance. Freud
a remédié à cette lacune.
La
place où, aux temps antiques, régnait puissamment le psychagogue,
le guérisseur d’âme et le maître de sagesse, et aux époques de piété le prêtre,
il l’a assignée à une science nouvelle et moderne dont on ne voit pas encore
les limites. Mais la tâche est magnifiquement tracée, la porte est ouverte. Et
là où l’esprit humain flaire l’espace et les profondeurs inexplorées, il ne se
repose plus, mais prend son essor et déploie ses inlassables ailes.
VII : Le monde du sexe
L’antinaturel
aussi fait partie de la nature. Celui qui ne la voit point partout, ne la voit
bien nulle part. Le fait que Sigmund Freud soit devenu le fondateur d’une
science sexuelle dont on ne pourrait plus se passer aujourd’hui s’est produit,
en somme, sans qu’il en ait eu lui-même l’intention. Mais, comme si c’était une
des lois secrètes de sa vie, toujours sa voie lui fait dépasser ce qu’il a
primitivement cherché et lui ouvre des domaines où il n’aurait jamais osé
pénétrer de son propre chef. À trente ans, il eût accueilli avec un sourire
incrédule celui qui lui aurait prédit qu’il lui était réservé, à lui
neurologue, de faire de l’interprétation des rêves et de l’organisation
biologique de la vie sexuelle l’objet d’une science ; car rien, dans sa vie
académique ou privée, ne témoignait du moindre intérêt pour des considérations
aussi peu orthodoxes.
Si
Freud est arrivé au problème sexuel, ce n’est point parce qu’il l’a voulu ; au
cours de ses recherches, le problème est venu de lui-même au-devant du
psychologue. Il est venu au-devant de lui, à sa propre surprise, sans être le
moins du monde appelé ou attendu, du fond de l’abîme décelé avec Breuer. En partant
de l’hystérie, Freud et Breuer avaient trouvé une formule révélatrice : les
névroses et la plupart des troubles psychiques naissent d’un désir non
satisfait, entravé et refoulé dans l’inconscient.
Mais
à quelle catégorie appartiennent principalement les désirs que refoule l’homme
civilisé,
qu’il cache au monde et souvent à lui-même comme les
plus intimes et les plus gênants ? Freud a bientôt
fait de se donner une réponse qu’il est impossible de ne pas entendre. La première
cure psychanalytique d’une névrose montre des forces érotiques refoulées. La
deuxième de même, la troisième également. Et bientôt Freud sait : toujours ou
presque toujours la névrose est causée par un désir sexuel qui ne peut
s’accomplir, et qui, transformé en rétentions et inhibitions, pèse sur la vie psychique.
Le premier sentiment de Freud devant cette découverte involontaire fut
peut-être l’étonnement qu’un fait aussi évident eût échappé à tous ses
prédécesseurs.
Cette
causalité directe n’a-t-elle réellement frappé personne ? Non, il n’en est fait
mention dans aucun manuel. Mais ensuite Freud se souvient soudain de certaines allusions
et conversations de ses maîtres célèbres. Quand Chrobak
lui a envoyé une hystérique dont il devait traiter les nerfs, ne l’informait-il
pas discrètement que cette femme, mariée à un impuissant, était restée vierge
après dix-huit ans de mariage et ne lui donnait-il pas, en plaisantant
brutalement, son opinion personnelle sur le moyen physiologique et voulu par
Dieu qui guérirait le plus facilement cette névrosée ? De même, dans un cas similaire,
son maître Charcot, à Paris, n’a-t-il pas défini, au cours d’une causerie,
l’origine d’une maladie nerveuse en déclarant : « Mais c’est toujours la chose sexuelle,
toujours ! » Freud s’étonne. Ils le savaient donc, ses maîtres, et probablement
d’innombrables autorités médicales avant eux. Mais alors, se demande Freud dans
sa naïve loyauté, s’ils le savaient, pourquoi l’ont-ils tenu secret ou n’en
ont-ils fait mention que dans des conversations intimes et jamais en public ?
Bientôt
on fera énergiquement comprendre au jeune médecin pourquoi ces hommes
expérimentés dissimulaient leur savoir au monde. À peine Freud communique-t-il
avec un tranquille réalisme sa découverte par la formule : « Les névroses naissent
là où des obstacles
extérieurs ou intérieurs entravent la satisfaction réelle
des besoins érotiques », qu’une résistance acharnée éclate de tous les côtés.
La science, à cette époque encore porte-drapeau inébranlable de la morale, se
refuse à admettre publiquement cette étiologie sexuelle ; même son ami Breuer,
qui a pourtant dirigé sa main vers la clef du mystère, se retire en toute hâte
de la psychanalyse, dès qu’il voit quelle boîte de Pandore il a aidé à ouvrir.
Freud,
bientôt, doit se rendre compte que ce genre de constatations, en l’an 1900,
touche un point où l’âme, exactement comme le corps, est le plus sensible et le
plus chatouilleuse ; la vanité du siècle de la culture préfère supporter n’importe
quel ravalement intellectuel plutôt que de se voir rappeler que l’instinct
sexuel continue à dominer et à déterminer l’individu et qu’il joue un rôle décisif
dans les créations les plus hautes de la civilisation. « La société est
convaincue que rien ne menacerait davantage sa culture que la libération des
instincts sexuels et leur retour à leurs buts primitifs. La société n’aime donc
pas qu’on lui rappelle cette partie embarrassante de ses fondements. Elle n’a aucun
intérêt à ce qu’on reconnaisse la puissance des instincts sexuels et que soit
exposée l’importance de la vie sexuelle pour l’individu. Elle a plutôt pris le
parti de répandre une éducation qui détourne l’attention de tout ce domaine.
C’est pourquoi elle ne supporte pas le résultat des recherches de la
psychanalyse et aimerait par-dessus tout le stigmatiser comme esthétiquement répugnant,
moralement condamnable ou dangereux. »
Cette
résistance de l’idéologie de toute une époque barre la route à Freud dès le
premier pas. Et il est à la gloire de sa probité d’avoir non seulement
énergiquement accepté la lutte, mais de l’avoir encore rendue plus difficile
par l’intransigeance de son caractère. Car Freud aurait pu exprimer tout ou
presque tout ce qu’il disait sans trop de désagréments si seulement il s’était montré
prêt à décrire sa généalogie de la vie sexuelle avec plus de précautions, de
détours et en y mettant des formes. Il n’aurait eu qu’à revêtir ses convictions
d’un mantelet stylistique, à leur appliquer un peu de fard poétique, et elles
se seraient insinuées sans grand scandale dans le public. L’instinct phallique
sauvage, dont il voulait montrer au monde, dans leur nudité, la poussée et la
virulence, peut-être aurait-il suffi de le nommer plus poliment Éros ou Amour
au lieu de libido. En disant que notre vie psychique était dominée par Éros, il
eût fait penser à Platon à la rigueur.
Mais
Freud, hostile à toutes les demi-mesures, use de mots durs, incisifs, sur
lesquels on ne se trompe pas ; il ne glisse sur aucune précision : il dit
carrément libido en pensant à la jouissance, instinct sexuel, sexualité, au
lieu d’Éros et d’Amour. Freud est toujours trop sincère pour recourir
prudemment aux circonlocutions. Il appelle un chat un chat, il donne aux choses
et aux égarements sexuels leurs noms véritables, avec le même naturel qu’un
géographe désigne ses montagnes et ses villes, un botaniste ses herbes et ses
plantes. Avec un sang-froid clinique il examine toutes les manifestations du
sexuel, même celles appelées vices et perversités, indifférent aux éclats
d’indignation de la morale et aux cris d’épouvante
de la pudeur ; les oreilles bouchées, pour ainsi
dire, il s’introduit patiemment et calmement dans le problème subitement
découvert et entreprend systématiquement la première étude psychogéologique
du monde des instincts humains.
Car
Freud, ce penseur profondément matérialiste et consciemment antireligieux, voit
dans l’instinct la région la plus profonde et la plus ardente de notre moi. Ce
n’est pas l’éternité que veut l’homme, ce n’est pas, selon Freud, la vie
spirituelle que l’âme désire avant tout : elle ne désire qu’instinctivement et
aveuglément.
Le
désir universel est le premier souffle de toute vie psychique. Comme le corps
après la nourriture, l’âme languit après la volupté ; la libido, ce désir de
jouissance originel, cette faim inapaisable de l’âme, la pousse vers le monde.
Mais – et c’est là la découverte proprement dite de Freud pour la science
sexuelle – cette libido n’a au commencement aucun but défini, son sens est
simplement de délivrer l’instinct. Et comme, selon la constatation créatrice de
Freud, les énergies psychiques sont toujours déplaçables, elle peut diriger son
impulsion tantôt sur un objet, tantôt sur un autre.
Le
désir ne se manifeste donc pas constamment dans la recherche de la femme par
l’homme et de l’homme par la femme ; c’est une force aveugle qui veut se dépenser,
la tension de l’arc qui ne sait pas encore ce qu’il vise, l’élan du torrent qui
ne connaît pas l’endroit où il va se jeter. Il veut simplement se détendre,
sans savoir comment il y arrivera. Il peut se traduire et se libérer par des
actes sexuels normaux et naturels ; il peut également se spiritualiser et accomplir
des choses grandioses dans le domaine artistique ou religieux. Il peut s’égarer
et se fourvoyer, se « fixer » au-delà du génital sur les objets les plus inattendus,
et par d’innombrables incidents détourner l’instinct primitivement sexuel de la
sphère physique. Il est apte à prendre toutes les formes, de la lubricité
animale aux vibrations les plus fines de l’esprit humain, lui-même sans forme
et insaisissable, et cependant intervenant partout. Mais toujours, dans les
basses satisfactions et les suprêmes réalisations, il délivre l’homme de sa
soif essentielle et primordiale de jouissance.
Du
fait de ce bouleversement fondamental provoqué par Freud, la conception du
problème sexuel se trouve d’un seul coup complètement changée. Jusqu’alors la
psychologie, ignorant la faculté de transformation des énergies psychiques,
confondait grossièrement le sexuel avec le rôle des organes sexuels ; le
problème de la sexualité, pour la science, représentait l’examen des fonctions du
bas-ventre, ce qui était donc une chose malpropre et gênante.
En séparant
l’idée de sexualité de l’acte sexuel, Freud l’arrache en même temps à son
étroitesse et à son discrédit ; le mot divinatoire de Nietzsche : « Le degré et
la nature de la sexualité d’un homme se manifestent jusqu’aux sommets les plus
élevés de son esprit », apparaît grâce à Freud comme une vérité biologique.
À
l’aide d’innombrables exemples, il prouve comment la libido, cette tension la
plus puissante de l’homme, par une transmission mystérieuse à travers les
années et les décennies, éclate dans des manifestations psychiques absolument
inattendues, comment la nature particulière de la libido ne cesse de s’affirmer
par des métamorphoses et des dissimulations sans nombre, dans les formes de
désir et les substituts de réalisations les plus singuliers.
Là où
il se trouve devant une bizarrerie psychique, une dépression, une névrose, un
acte forcé, le médecin, dans la plupart des cas, peut donc déduire avec
confiance qu’il y a quelque chose d’étrange ou d’anormal dans le destin sexuel
de son patient ; c’est alors, selon la méthode de la psychologie abyssale, qu’il
lui appartient de ramener le malade jusqu’à l’endroit de sa vie intérieure où
un événement a provoqué cette déviation du cours normal de l’instinct.
Ce
nouveau genre de diagnostic fait faire à Freud, derechef, une découverte inattendue.
Déjà, les premières psychanalyses lui avaient montré que les événements sexuels
qui déséquilibrent le névrosé datent de très longtemps ; rien n’était donc plus
naturel que de les chercher dans la jeunesse de l’individu, au temps du
modelage de l’âme ; car seul ce qui s’inscrit durant la période de croissance
de la personnalité sur la plaque encore molle, et par
conséquent réceptive de la conscience en formation, demeure pour
tout homme l’élément ineffaçable qui détermine son destin.
« Que
personne ne croie pouvoir se soustraire aux premières impressions de sa
jeunesse », dit Goethe. Dans chaque cas qu’il a à examiner, Freud recule donc
en tâtonnant jusqu’à la puberté – une période antérieure ne lui paraît d’abord
pas devoir être étudiée : car comment les impressions sexuelles pourraient-elles
se former avant l’aptitude sexuelle ? Il considère encore comme un contresens
l’idée de poursuivre la vie instinctive sexuelle au-delà de cette limite, jusque
dans l’enfance, dont l’heureuse inconscience ne pressent encore rien de la
tension et de la poussée de la sève. Les premières recherches de Freud
s’arrêtent donc à la puberté.
Mais
bientôt, devant certains aveux remarquables, Freud ne peut se refuser à
reconnaître que chez nombre de ses malades la psychanalyse fait surgir, avec
une incontestable netteté, des souvenirs se rapportant à des événements sexuels
bien plus anciens et pour ainsi dire préhistoriques. Des confessions très
claires de ses patients l’amènent à soupçonner que l’époque antérieure à la
puberté, c’est-à-dire l’enfance, doit déjà contenir l’instinct sexuel ou
certaines de ses représentations. Ce soupçon se fait plus
pressant au fur et à mesure qu’avancent les recherches.
Freud
se souvient de ce que la bonne d’enfant et le maître d’école rapportent des manifestations
précoces de la curiosité sexuelle, et subitement sa propre découverte sur la
différence qui existe entre la vie psychique consciente et inconsciente éclaire
lumineusement la situation. Freud reconnaît que la conscience sexuelle ne
s’infiltre pas soudainement dans le corps à l’âge de la puberté – car d’où
viendrait-elle ? – mais que, comme la langue, mille fois plus psychologue que
tous les psychologues scolaires, l’a depuis si longtemps exprimé avec une plasticité
admirable elle « s’éveille » chez l’être à demi formé ; elle existait donc
déjà depuis longtemps dans le corps de l’enfant, mais endormie (c’est-à-dire
latente).
De
même que l’enfant a en puissance la marche dans les jambes avant d’être à même
de marcher, et le désir de parler avant de pouvoir le faire, la sexualité –
bien entendu, sans le moindre pressentiment de sa réalisation pratique – se
tient prête chez lui depuis longtemps. L’enfant – formule décisive – connaît sa
sexualité. Seulement il ne la comprend pas.
Ici,
je ne sais pas, mais je suppose qu’au premier moment Freud a dû être effrayé de
sa propre découverte. Car elle bouleverse les conceptions les plus courantes
d’une façon presque profanatrice. S’il était déjà audacieux de mettre en
évidence et, comme disent tous les autres, d’exagérer l’importance psychique du
sexuel dans la vie de l’adulte – quel défi à la morale de la société que cette
conception révoltante : vouloir découvrir des traces d’affectivité sexuelles
chez l’enfant, auquel l’humanité associe universellement l’idée de la pureté absolue.
Comment, cette vie souriante, tendrement bourgeonnante, connaîtrait déjà le désir
sexuel ou du moins en rêverait !
Cette
idée paraît d’abord absurde, démente, criminelle, antilogique même, car les
organes de l’enfant n’étant pas aptes à la reproduction, cette formule terrible
devait s’ensuivre : « Si l’enfant a une vie sexuelle, elle ne peut donc être
que perverse. » Exprimer une telle chose en 1900 équivalait à un suicide
scientifique. Pourtant Freud l’exprime. Là où ce chercheur impitoyable sent un
terrain solide, il enfonce irrésistiblement jusqu’au bout le foret de son
énergie. Et, à sa propre surprise, il découvre dans la forme la plus
inconsciente de l’homme, dans le nourrisson, l’image la plus caractéristique de
la forme originelle et universelle de l’instinct de jouissance. Précisément parce
que là, à l’entrée de la vie, aucune lueur de conscience morale ne descend dans
le monde inentravé des instincts cet être minuscule
lui révèle le sens primordial et plastique de la libido : attirer la
jouissance, repousser le déplaisir. Ce petit animal humain aspire à la
jouissance de tout, de son propre corps et de l’ambiance, du sein maternel, du doigt
et de l’orteil, du bois et de l’étoffe, du vêtement et de la chair ; sans
retenue et grisé de rêve, il veut faire entrer dans son petit corps mou tout ce
qui lui fait du bien. À cette phase primitive de la volupté, l’être vague
qu’est l’enfant ne distingue pas encore le Moi et le Toi qu’on lui enseignera
plus tard, il ne pressent pas les frontières physiques ou morales que lui
tracera par la suite l’éducation : c’est un être anarchique, panique, qui, avec
une soif inapaisable, veut attirer l’Univers dans son Moi, qui porte tout ce
qu’atteignent ses petits doigts à la seule source de volupté qu’il connaisse, à
sa bouche qui tète (Freud qualifie cette époque d’orale). Il joue ingénument
avec ses membres, totalement dissous dans son désir balbutiant et tétant, et repousse
en même temps avec fureur tout ce qui trouble sa satisfaction délirante. Ce
n’est que chez le nourrisson, dans le « non encore Moi », dans le « vague Soi »
que la libido universelle de l’homme peut s’en donner à cœur joie sans but et sans
objet. Là le Moi inconscient tète encore avidement toute la joie aux seins de
l’Univers.
Mais
cette première phase autoérotique ne dure pas longtemps. Bientôt l’enfant
commence à reconnaître que son corps a des limites : une petite lueur jaillit
dans le minuscule cerveau, une différenciation s’établit entre le dehors et le
dedans. Pour la première fois l’enfant éprouve la résistance du monde et doit
constater que cet élément extérieur est une force dont on dépend. La punition
ne tarde pas à lui enseigner une loi douloureuse et inconcevable pour lui qui
ne lui permet pas de puiser sans limites la jouissance à toutes les sources :
on lui interdit de se montrer nu, de toucher ses excréments et de s’en réjouir
; on le force impitoyablement à renoncer à l’unité amorale de la sensation, à considérer
certaines choses comme permises et d’autres comme défendues. L’exigence de la
culture commence à bâtir dans ce petit être sauvage une conscience sociale et esthétique,
un appareil de contrôle, à l’aide duquel il peut classer ses actions en deux
groupes : les bonnes et les mauvaises. Du fait qu’il acquiert cette
reconnaissance, le petit Adam est chassé du paradis de l’irresponsabilité.
En
même temps s’affirme du dedans un certain recul de l’instinct de jouissance, il
cède la place, chez l’enfant grandissant, au penchant nouveau de
l’auto-découverte. Du « Soi », inconsciemment instinctif, sort un « Moi », et
cette découverte de son Moi représente pour le cerveau de l’enfant une tension
et une occupation telles que l’instinct de jouissance aux manifestations primitivement
paniques en est négligé et n’existe plus qu’en jouissance.
Cet
état d’autooccupation ne se perd pas entièrement dans
le souvenir de l’adulte, il reste même chez certains sous forme de tendance
narcissique, de penchant égocentrique dangereux à s’occuper uniquement du Soi
et à repousser tout lien affectif avec l’univers. L’instinct de jouissance qui
montre chez le nourrisson sa forme originelle et universelle s’enferme et
redevient invisible chez l’adulte. Entre la forme autoérotique et panérotique du nourrisson et l’érotisme sexuel de la
puberté, il y a un sommeil hivernal des passions, un état crépusculaire, au
cours duquel les énergies et les sèves se préparent à leur affranchissement.
Lorsque à cette deuxième phase, celle de la puberté, de
nouveau teintée de sexualité, l’instinct endormi s’éveille peu à peu, lorsque la
libido se retourne vers l’univers, lorsqu’elle cherche de nouveau une «
fixation », un objet sur lequel elle peut transférer sa tension affective – à
ce moment décisif, la volonté biologique de la nature indique énergiquement au
novice la voie naturelle de la reproduction. Des transformations flagrantes
dans le corps du jeune homme, de la jeune fille nubile, à l’époque de la
puberté, leur montrent que la nature se propose là un but. Et ces signes indiquent
nettement la zone génitale. Ils signalent la voie que la nature veut voir
suivre à l’homme pour servir son intention secrète et éternelle : la
reproduction.
La
libido ne doit plus, comme jadis chez le nourrisson, jouir d’elle-même en s’amusant,
mais se soumettre, utilement, au dessein insaisissable de l’univers qui se
réalise dans la procréation. Si l’individu comprend cette indication impérieuse
de la nature et y obéit – si l’homme se joint à la femme et la femme à l’homme
pour l’accomplissement de l’acte créateur – s’il a oublié toutes les autres
possibilités de jouissance de son ancienne volupté panique, son développement
sexuel a suivi un cours direct et régulier, ses énergies se réalisent dans leur
voie naturelle et normale.
Ce «
rythme à deux temps » détermine le développement de toute la vie sexuelle
humaine, et pour des millions et des millions d’êtres l’instinct de jouissance
se conforme sans tension à ce cours régulier : volupté universelle et autojouissance chez l’enfant, besoin de reproduction chez
l’adulte. L’être normal sert avec une parfaite simplicité les fins de la nature
qui veut le voir obéir exclusivement aux lois métaphysiques de la reproduction.
Mais
dans des cas isolés, relativement rares – ceux, précisément, qui intéressent le
médecin de l’âme – on s’aperçoit qu’un trouble néfaste est venu entraver la
saine régularité de ce processus. Nombre d’humains, pour des raisons
particulières à chacun d’eux, ne peuvent se décider à canaliser entièrement
leur instinct de jouissance dans les formes recommandées par la nature ; la libido,
l’énergie sexuelle, chez eux, cherche pour se dissoudre en volupté une
direction autre que la normale.
Chez
ces anormaux et ces névrosés, par suite d’une rupture du rail de leur vie, le
penchant sexuel a été dirigé sur une voie fausse, d’où il n’arrive pas à se
dégager. Les pervers ne sont pas, selon la conception de Freud, des êtres chargés
d’hérédité, des malades, ni surtout des criminels ; ce sont pour la plupart des
hommes qui se souviennent avec une fidélité fatale de certaine forme de
réalisation voluptueuse de leur époque prégénitale, d’un événement érotique de leur
période de développement et qui, dominés par la hantise de la répétition, ne
peuvent chercher la volupté que dans cette direction.
Ainsi
voit-on dans la vie de malheureux adultes aux désirs infantiles que n’attire
pas la réalisation sexuelle jugée naturelle par la société et normale à leur
âme ; toujours ils veulent revivre cet événement érotique (retombé chez la plupart
depuis longtemps dans l’inconscient) et cherchent dans la réalité un substitut
de ce souvenir.
Jean-Jacques
Rousseau dans son impitoyable autobiographie nous a révélé avec une parfaite
maîtrise un cas classique de perversion de ce genre, provoqué par un souvenir
de jeunesse. Sa maîtresse qui était très sévère et qu’il aimait secrètement lui
donnait souvent et furieusement le fouet ; à la propre surprise de l’enfant, ce
châtiment rigoureux infligé par son éducatrice lui causait un plaisir très net.
À l’état latent (si admirablement défini par Freud) Rousseau oublie
complètement ces scènes, mais son corps, son âme, son inconscient ne l’oublient
pas. Et lorsque plus tard l’homme mûr cherche la satisfaction charnelle dans
des rapports normaux avec des femmes, il n’arrive jamais à l’accomplissement de
l’acte physique. Pour qu’il puisse s’unir à une femme, elle doit d’abord
répéter cette flagellation historique ; et c’est ainsi que Jean-Jacques paie
toute sa vie l’éveil précoce et funeste de son
affectivité sexuelle dévoyée par un masochisme incurable qui
le ramène toujours, en dépit de sa révolte intérieure, à cette unique forme de volupté
qui lui soit accessible.
Les pervers
(Freud classe sous ce nom tous ceux qui cherchent la jouissance par d’autres
moyens que celui qui sert la reproduction) ne sont donc ni des malades ni des
natures obstinément anarchiques, s’insurgeant consciemment et audacieusement
contre les lois communes, mais des prisonniers malgré eux enchaînés à un événement
de leur prime jeunesse, enlisés dans l’infantilisme, et dont le désir violent
de vaincre leurs instincts dévoyés fait des névrosés et des psychosés. Car ni
la justice, qui par sa menace plonge le malade plus profondément encore dans
son conflit intérieur, ni la morale qui en appelle à la « raison » ne peuvent
le libérer de ce joug ; il faut pour cela le guérisseur d’âmes qui lui fait
comprendre, avec une sympathie lucide, l’événement primitif.
Car seule l’auto-compréhension du conflit intérieur – tel est l’axiome de Freud
dans la doctrine psychique –
peut réussir à le supprimer : pour se guérir on doit
d’abord savoir le sens de sa maladie.
Ainsi,
selon Freud, tout déséquilibre psychique découle d’une expérience personnelle, généralement
érotique, et même ce que nous nommons nature et hérédité ne représente rien
d’autre que les événements vécus par les générations antérieures et absorbés par
les nerfs ; par conséquent, l’événement vécu est pour la psychanalyse le
facteur décisif dans la formation de l’âme, et elle cherche à comprendre tout hommeindividuellement à travers son passé.
Pour
Freud il n’est pas de psychologie ni de pathologie autres qu’individuelles :
dans la vie de
l’âme rien ne doit être considéré d’après une règle ou
d’après un schéma ; chaque fois il faut
découvrir les données premières qui sont toujours uniques.
Il n’en est pas moins vrai que la plupart des événements sexuels précoces, tout
en conservant leur nuance personnelle, montrent cependant certaines formes de
ressemblance typique ; de même que d’innombrables individus sont visités par
les mêmes formes de rêve (le rêve du vol plané, de l’examen, de la poursuite),
Freud croit reconnaître dans la réalisation sexuelle précoce certaines attitudes
affectives typiques presque obligatoires et il s’est passionnément attaché à
rechercher et à classer ces catégories, ces « complexes ».
Le
plus célèbre – et aussi le plus diffamé – est le complexe dit d’Œdipe, que
Freud présente même comme un des piliers fondamentaux de son édifice
psychanalytique (quant à moi, il ne me paraît pas autre chose qu’un de ces
étais qui, une fois la construction terminée, peuvent être supprimés sans
danger). Il a gagné entre-temps une si fatale popularité qu’il est à peine
nécessaire d’en donner la définition : Freud suppose que l’affectivité funeste
qui se réalise tragiquement dans la légende grecque d’Œdipe, où le fils tue le père
et possède la mère – que cette situation, qui nous paraît barbare, existe
encore aujourd’hui à l’état de désir dans toute âme infantile ; car – hypothèse
la plus discutée de Freud – le premier sentiment érotique de l’enfant vise
toujours la mère, la première tendance agressive le père.
Ce
parallélogramme de forces d’amour pour la mère et de haine pour le père, Freud
croit pouvoir prouver qu’il est le premier groupement naturel et inévitable de toute
vie psychique infantile et à côté de lui il place une série d’autres sentiments
subconscients comme la peur de la castration, le désir d’inceste, etc. – tous
sentiments qui ont été incarnés dans les mythes primitifs de l’humanité. (Car
selon la conception culturelle et biologique de Freud, les mythes et légendes
des peuples ne sont rien d’autre que les rêves-désirs « abréagis » de leur
enfance.)
Ainsi,
tout ce que l’humanité a depuis longtemps rejeté comme contraire à la culture,
la joie
de tuer, l’inceste, le viol, tous ces sombres
égarements du temps des hordes, tout cela frémit encore une fois du désir de se
réaliser dans l’enfance, cette période préhistorique de l’âme humaine : chaque
individu renouvelle symboliquement dans son développement éthique toute l’histoire
de la civilisation.
Invisiblement
puisque inconsciemment, nous charrions tous dans notre sang les vieux instincts
barbares, et aucune culture ne protège complètement l’homme contre les éclairs
subits de ces désirs étrangers à lui-même ; des courants mystérieux de notre
inconscient nous ramènent encore et toujours à ces temps primitifs sans lois ni
morale. Même si nous employons toute notre force à écarter ce monde des
instincts de notre activité consciente, nous ne pouvons, en mettant les choses
au mieux, que l’amender dans le sens moral et spirituel, mais
jamais nous en détacher complètement.
À
cause de cette conception soi-disant ennemie de la civilisation, qui considère
comme vain, dans un certain sens, l’effort millénaire de l’humanité vers la
domination totale des instincts et souligne sans cesse l’invincibilité de la
libido, les adversaires de Freud ont traité sa doctrine sexuelle de pan-sexualisme. Ils l’accusent de surestimer comme psychologue
l’instinct sexuel en lui attribuant une influence aussi prépondérante sur notre
vie psychique et d’exagérer comme médecin en ramenant tout déséquilibre de
l’âme uniquement à ce point de départ et en ne partant que de lui pour aller
vers la guérison.
Cette
objection, selon moi, englobe le vrai et l’inexact. Car en réalité Freud n’a
jamais présenté le principe de jouissance comme la seule force psychique
motrice du monde. Il sait bien que toute tension, tout mouvement – et la vie
est-elle autre chose ? – ne découle que du polemos, du
conflit. C’est pourquoi, dès le début, il a théoriquement opposé à la libido, à
l’instinct centrifuge tendant à dépasser le Moi et cherchant à se fixer, un
autre instinct, qu’il appelle d’abord instinct du Moi, ensuite instinct agressif,
puis finalement instinct de la mort et qui pousse à l’extinction au lieu de la
reproduction, à la destruction au lieu de la création, au Néant au lieu de la
vie.
Mais
– et sous ce rapport seul ses adversaires n’ont pas complètement tort – Freud n’a
pas réussi à représenter cet instinct contraire aussi nettement et avec une
force aussi persuasive que l’instinct sexuel : le royaume des instincts dits du
Moi, dans son tableau philosophique de l’univers, est resté assez vague, car là
où Freud ne perçoit pas avec une netteté absolue, c’est-à-dire dans tout le domaine
purement spéculatif, il lui manque la plasticité magnifique de son don de
délimitation.
Une certaine
surestimation du sexuel domine donc peut-être son œuvre et sa thérapeutique,
mais cette insistance particulière de Freud était historiquement la conséquence
de la sous-estimation et de la dissimulation systématiques de la sexualité par
les autres pendant des dizaines d’années. On avait besoin d’exagération pour
que la pensée pût conquérir l’époque ; en brisant la digue du silence, Freud a
surtout ouvert la discussion. En réalité cette exagération tant décriée du
sexuel n’a jamais constitué de vrai danger, et ce qu’il pouvait y avoir
d’outrancier dans les premiers moments a vite été corrigé par le temps, cet
éternel régulateur de toutes les valeurs.
Aujourd’hui
que vingt-cinq ans se sont écoulés depuis le début des exposés de Freud, l’homme
le plus craintif peut se tranquilliser : grâce à notre connaissance nouvelle,
plus sincère et plus scientifique du problème de la sexualité, le monde n’est
en aucune façon devenu plus sexuel, plus érotomane, plus amoral ; la doctrine
de Freud, au contraire, n’a fait que reconquérir une valeur psychique perdue
par la pruderie de la génération antérieure : l’ingénuité de l’esprit devant
tout le physique.
Une
génération nouvelle a ainsi appris – et déjà on l’enseigne dans les écoles – à
ne plus éviter les décisions intérieures, à ne plus cacher les problèmes les
plus intimes, les plus personnels, mais, au contraire, à prendre conscience le plus
clairement possible du danger et du mystère des crises internes.
Toute
auto-connaissance équivaut déjà à la liberté envers soi-même, et il est hors de
doute que la nouvelle morale sexuelle, plus libre, se montrera dans la future
camaraderie des sexes autrement créatrice de moralité que l’ancienne, toute de dissimulation,
dont Freud – mérite
indéniable – aura, par sa hardiesse et son indépendance
d’esprit, hâté la disparition définitive. Toujours une génération doit sa
liberté extérieure à la liberté intérieure d’un seul
individu, toute science nouvelle a besoin d’un précurseur
qui la rend perceptible aux autres humains.
VIII : Regard crépusculaire au loin
Toute
vision se change en contemplation, toute contemplation en réflexion, toute
réflexion en association, de sorte que l’on peut dire que chaque fois que nous
jetons un regard attentif sur le monde, nous faisons déjà de la théorie.
L’automne
est le temps béni de la contemplation. Les fruits sont récoltés, la tâche
achevée : purs et clairs, le ciel et l’horizon lointain illuminent le paysage
de la vie.
Quand
Freud, à l’âge de soixante-dix ans, jette pour la première fois un regard
rétrospectif sur l’œuvre accomplie, il s’étonne sûrement lui-même en voyant
jusqu’où l’a conduit sa voie créatrice.
Un
jeune neurologue étudie l’explication de l’hystérie. Plus rapidement qu’il ne
le croit, ce problème lui découvre ses abîmes. Mais là, dans ces profondeurs,
un nouveau problème se présente à lui : l’inconscient. Il l’examine et il se trouve
que c’est un miroir magique.
Quel
que soit l’objet spirituel sur lequel il projette sa lumière, il lui donne un
sens nouveau. Ainsi armé d’un don d’interprétation sans égal, mystérieusement
guidé par une mission intérieure, Freud avance d’une révélation à une autre,
d’une vue spirituelle à une nouvelle, plusvaste et
plus élevée – una
parte nasce
dall’altra successivamente, selon
le mot de Léonard de Vinci – et toutes ces découvertes s’enchaînent
naturellement pour former un tableau d’ensemble du monde psychique. Depuis
longtemps sont dépassées les régions de la
neurologie, de la psychanalyse, de l’interprétation des
rêves, de la sexualité, et toujours apparaissent d’autres sciences qui ne
demandent qu’à être renouvelées.
Déjà
la pédagogie, les religions, la mythologie, la poésie et l’art doivent aux
inspirations du vieux savant un enrichissement important : du haut de ses
années, c’est à peine s’il peut embrasser du regard les espaces de l’avenir où
atteint la puissance insoupçonnée de son activité.
Comme
Moïse du sommet de la montagne, Freud, au soir de sa vie, découvre encore un
espace infini de terre inculte que pourrait fertiliser sa doctrine. Pendant
cinquante ans il a suivi intrépidement le sentier de la lutte, chasseur de
mystères et chercheur de vérités, son butin est incalculable.
Que
de choses n’a-t-il pas projetées, pressenties, vues, créées ! Qui serait à même
de dénombrer ses activités dans tous les domaines de l’esprit ? Il pourrait se
reposer, à présent, le vieil homme. En effet, il éprouve quelque part en lui le
besoin de voir les choses d’un œil plus doux, plus indulgent. Son regard qui a
pénétré, sévère et scrutateur, au fond de trop d’âmes sombres, désirerait maintenant
embrasser librement, en une sorte de rêverie spirituelle, l’image entière de
l’univers. Celui qui toujours a labouré les abîmes aimerait
contempler les sommets et les plaines de l’existence. Celui qui toute une vie a
sans repos cherché et interrogé en psychologue essaierait volontiers, à
présent, de se donner en philosophe une réponse à soi-même.
Celui
dont les analyses d’individus isolés ne se comptent plus voudrait maintenant approfondir
le sens de la communauté et mettre à l’épreuve son art d’interprétation dans
une psychanalyse de l’époque. Elle n’est pas récente, cette tentation de voir
le mystère universel exclusivement en penseur, d’en faire une pure vision de
l’esprit.
Mais
la rigueur de sa tâche a interdit à Freud, pendant toute une vie, les tendances
spéculatives ; les lois de la construction psychique devaient d’abord être
expérimentées sur d’innombrables individus avant qu’il osât les appliquer au
général. Et il lui semblait toujours, à cet homme par trop conscient de sa responsabilité,
qu’il n’était pas encore temps.
Mais
à présent que cinquante ans d’un labeur infatigable lui donnent le droit de
dépasser l’individuel en « rêve-pensée », voici qu’il sort pour jeter un regard
au loin et pour appliquer à toute l’humanité la méthode éprouvée sur des
milliers d’humains.
Le
maître, toujours si sûr de lui, commence cette entreprise avec quelque crainte,
quelque timidité. On serait presque tenté de dire qu’il quitte avec remords son
domaine des faits exacts pour celui de ce qui ne saurait être prouvé ; car il
sait, lui qui a démasqué tant d’illusions, combien facilement on cède à des rêves-désirs
philosophiques. Jusqu’ici il avait durement repoussé toute généralisation
spéculative : « Je suis contre la fabrication de conceptions universelles. » Ce
n’est donc pas de gaieté de cœur, avec l’ancienne et inébranlable certitude qu’il
se tourne vers la métaphysique – ou, comme il l’appelle plus prudemment, la
métapsychologie.
Il semble
s’excuser devant lui-même de cette entreprise tardive : « Un certain changement
dont je ne puis nier les conséquences s’est introduit dans mes conditions de
travail. Jadis je n’étais pas de ceux qui ne savent garder secrète une chose
qu’ils croient être une découverte, jusqu’à ce qu’elle se trouve corroborée…Mais
alors le temps s’étendait, incalculable, devant moi – oceans of time,
comme dit un aimable poète – et les matériaux affluaient vers moi si nombreux
que j’arrivais difficilement à expérimenter tout ce qui m’était offert…
Maintenant cela a changé. Le temps devant moi est limité, il n’est pas
complètement rempli par le travail, les occasions de faire de nouvelles
expériences ne se multiplient plus autant. Lorsque je crois voir quelque chose
de neuf, je ne suis plus certain de pouvoir en attendre la preuve. »
On le
voit : cet homme strictement scientifique sait d’avance qu’il va se poser cette
fois toutes sortes de problèmes insidieux. En une sorte de monologue, d’entretien
intellectuel avec lui-même, il examine certaines des questions qui lui pèsent
sans exiger, sans donner de réponse complète.
Ces
livres venus sur le tard, L’Avenir d’une illusion et le
Malaise dans la civilisation ne sont peut-être pas
aussi nourris que les précédents ;
mais ils sont plus poétiques. Ils contiennent
moins de science démontrable, mais plus de
sagesse. Au lieu du dissecteur impitoyable se
révèle enfin le penseur qui synthétise
amplement, au lieu du médecin d’une
science naturelle exacte l’artiste si longtemps
pressenti. C’est comme si, pour la première
fois, derrière le regard scrutateur,
surgissait l’être humain si longuement
dissimulé qu’est Sigmund Freud.
Mais
ce regard qui contemple l’humanité est sombre ; il est devenu tel parce qu’il a
vu trop de choses sombres ; continuellement, pendant cinquante ans, les hommes
n’ont montré à Freud que leurs soucis, leurs misères, leurs tourments et leurs
troubles, tantôt gémissant et interrogeant, tantôt s’emportant, irrités,
hystériques, farouches ; toujours il n’a eu affaire qu’à des malades, des
victimes, des obsédés, des fous ; seul le côté triste et aboulique de
l’humanité est apparu inexorablement à cet homme durant toute une vie. Plongé
éternellement dans son travail, il a rarement entrevu l’autre face de
l’humanité, sereine, joyeuse, confiante, la partie composée d’hommes généreux, insouciants,
gais, légers, enjoués, bien portants, heureux : il n’a rencontré que des
malades, des mélancoliques, des déséquilibrés, rien que des âmes sombres.
Sigmund
Freud est resté trop longtemps et trop profondément médecin pour n’en être pas arrivé
peu à peu à considérer toute l’humanité comme un corps malade. Déjà sa première
impression, dès qu’il jette un regard sur le monde du fond de son cabinet de
travail, fait précéder toutes recherches ultérieures d’un diagnostic
terriblement pessimiste : « Pour toute l’humanité, de même que pour l’individu,
la vie est difficile à supporter. » Mot terrible et fatal qui laisse peu d’espoir,
soupir qui monte du tréfonds plutôt que notion acquise.
On se
rend compte que Freud s’approche de sa tâche culturelle et biologique comme
s’il s’avançait vers le lit d’un malade. Accoutumé à examiner en psychiatre, il
croit nettement apercevoir dans notre époque les symptômes d’un déséquilibre
psychique. Comme la joie est étrangère à son œil, il ne voit dans notre civilisation
que le malaise et se met à analyser cette névrose de l’âme de l’époque.
Comment
est-ce possible, se demande-t-il, que si peu de satisfaction réelle anime notre
civilisation, qui cependant a élevé l’humanité bien au-dessus de tous les espoirs
et pressentiments des générations précédentes ? N’avons-nous pas mille fois
dépassé en nous le vieil Adam, ne sommes-nous pas déjà plus pareils à Dieu qu’à
lui ?
L’oreille,
grâce à la membrane téléphonique, n’entend-elle pas les sons des continents les
plus éloignés ; l’œil, grâce au télescope, ne contemple-t-il pas l’univers des myriades
d’étoiles, et, à l’aide du microscope, ne voit-il pas le Cosmos dans une goutte
d’eau ?
Notre
voix ne survole-t-elle pas en une seconde l’espace et le temps, ne nargue-t-elle
pas l’éternité, fixée au disque d’un gramophone ; l’avion ne nous
transporte-t-il pas avec sécurité à travers l’élément interdit au mortel pendant
des milliers d’années ?
Pourquoi
ces conquêtes techniques n’apaisent-elles pas et ne satisfont-elles pas notre
moi intime ?
Pourquoi,
malgré cette parité avec Dieu, l’âme de l’homme n’éprouve-t-elle pas la vraie
joie de la victoire, mais uniquement le sentiment accablant que nous ne faisons
qu’emprunter ces splendeurs, que nous ne sommes que des « dieux à prothèses » ?
Quelle est l’origine de cette inhibition, de ce déséquilibre, la racine de
cette maladie de l’âme ? se demande Freud en contemplant l’humanité. Et,
gravement, rigoureusement, méthodiquement, comme s’il s’agissait d’un des cas isolés
de sa consultation, le vieux savant se met en devoir de rechercher les causes
du malaise de notre civilisation, cette névrose psychique de l’humanité
actuelle.
On
sait que Freud commence toujours une psychanalyse par la recherche du passé :
il procède de même pour celle de la civilisation à l’âme malade en jetant un
regard rétrospectif sur les formes primitives de la société humaine. Au début
Freud voit apparaître l’homme préhistorique (dans un certain sens le nourrisson
de la civilisation), ignorant mœurs et lois, animalement libre et vierge de
toute inhibition. Mû par son égoïsme concentré, que rien n’entrave, il trouve
une décharge à ses instincts agressifs dans le meurtre et le cannibalisme, à son
penchant sexuel dans le pansexualisme et l’inceste. Mais à peine cet homme
primitif forme-t-il avec ses pareils une horde ou un clan, qu’il est forcé de
se rendre compte qu’il y a des bornes à ses appétits, bornes représentées par
la résistance de ses compagnons : toute vie sociale, même au degré le plus bas,
exige une limitation. L’individu doit se résigner à considérer certaines choses
comme défendues ; on établit des coutumes, des droits, des conventions communes
qui entraînent le châtiment pour toute transgression. Bientôt la connaissance
des interdictions, la crainte du châtiment, tout extérieures, se déplacent peu
à peu à l’intérieur et créent dans le cerveau jusque-là borné et bestial une instance
nouvelle, un sur-Moi, un appareil en quelque sorte signalisateur
qui avertit à temps de ne pas traverser les rails des mœurs, afin de ne pas
être happé par la punition.
Avec
ce sur-Moi, la conscience, naît la culture et en même temps l’idée religieuse.
Car toutes les limites que la nature oppose du dehors à l’instinct humain de
jouissance, le froid, la maladie, la mort, la peur aveugle et primitive de la
créature ne les conçoit toujours que comme envoyées par un adversaire
invisible, par un « Dieu-père », qui a le pouvoir illimité de récompenser et de
châtier, un Dieu de terreur auquel on doit servitude et soumission. La présence
imaginaire d’un Dieu-père omniscient et omnipotent – à la fois idéal suprême du
Moi en tant que représentant de la toute-puissance et image terrifiante en tant
que créateur de tous les effrois – tient en éveil la conscience qui refoule
l’homme révolté dans ses frontières ; grâce à cet auto-refrènement, à cette renonciation,
à cette discipline et autodiscipline, commence la civilisation graduelle de
l’être barbare. En unissant ses forces primitivement ultra-belliqueuses, en leur
assignant une activité commune et créatrice, au lieu de les lancer uniquement
les unes contre les autres en des luttes sanglantes et meurtrières, l’humanité
accroît ses dons éthiques et techniques et enlève peu à peu à son propre idéal,
à Dieu, une bonne part de sa puissance.
L’éclair
est emprisonné, le froid asservi, la distance vaincue, le danger des fauves
dompté par les armes ; tous les éléments : eau, air, feu, assujettis peu à peu
à la communauté civilisée. Grâce à ses forces créatrices organisées, l’humanité
monte toujours plus haut à l’échelle céleste vers le divin ; maîtresse des
sommets et des abîmes, triomphatrice de l’espace, pleine de savoir et presque omnisciente,
elle, partie de la bête, peut déjà se considérer comme égale à Dieu.
Mais
au milieu de ce beau rêve d’une civilisation créatrice de bonheur universel,
Freud, l’incurable désillusionniste – absolument
comme Jean-Jacques Rousseau, plus de cent cinquante ans auparavant – lance la
question : pourquoi, malgré cette parité avec Dieu, l’humanité n’est-elle pas
plus heureuse et plus joyeuse ? Pourquoi notre Moi le plus profond ne se sent-il
pas enrichi, délivré et sauvé par toutes ces victoires civilisatrices de la
communauté ? Et il y répond lui-même, avec sa dureté énergique et implacable :
parce que cet enrichissement par la culture ne nous a pas été donné
gratuitement, mais est payé par une limitation inouïe de la liberté de nos
instincts.
L’envers
de tout gain de civilisation pour l’espèce est une perte de bonheur pour
l’individu (et Freud prend toujours le parti de ce dernier). À l’accroissement
de civilisation humaine collective correspond une diminution de liberté, une
baisse de force affective pour l’âme individuelle. « Notre sentiment actuel du
Moi n’est qu’une partie rabougrie d’un sentiment vaste, universel même,
conforme à une parenté plus intime entre le Moi et le monde environnant. »
Nous avons
trop cédé de notre force à la société, à la collectivité, pour que nos
instincts primitifs, sexuel et agressif, possèdent
encore leur unité et leur puissance anciennes. Plus notre vie psychique
s’éparpille en d’étroits canaux, plus elle perd de sa force torrentielle
élémentaire. Les restrictions sociales plus rigoureuses de siècle en siècle racornissent
et rétrécissent notre force affective, et « la vie sexuelle de l’homme civilisé
notamment en a gravement souffert. Elle fait parfois l’impression d’une
fonction en déclin, comme semble avoir diminué le rôle de nos organes, de notre
denture et de nos cheveux ».
L’âme
de l’homme ne se laisse pas tromper : elle sait d’une façon mystérieuse que les
innombrables jouissances nouvelles et supérieures parmi lesquelles les arts,
les sciences, la technique, essaient quotidiennement de lui faire illusion ;
que l’asservissement de la nature et les multiples commodités de la vie lui ont
valu la perte d’une autre volupté plus totale, plus farouche, plus naturelle.
Quelque chose, en nous, biologiquement caché peut-être dans les labyrinthes du
cerveau et que charrie notre sang, se souvient mystiquement de cette liberté
suprême liée à notre état primitif : tous les instincts vaincus depuis
longtemps par la culture – l’inceste, le parricide, la pansexualité
– hantent encore nos rêves et nos désirs. Même en l’enfant soigné et dorloté,
mis au monde sans chocs et sans douleurs par la plus cultivée des mères dans le
local bien chauffé, éclairé à l’électricité, dûment désinfecté, d’une clinique
de luxe, le vieil homme primitif se réveille : il doit reparcourir
lui-même à travers les millénaires tous les degrés qui conduisent des instincts
paniques à l’autolimitation, il doit revivre et souffrir en son propre petit
corps croissant toute l’évolution de la culture.
Ainsi,
un souvenir de l’ancienne autocratie reste indestructible en nous tous, et à certains
moments notre Moi éthique a la nostalgie folle de l’anarchisme, de la liberté
nomade, de l’animalité de nos débuts. Dans notre vitalité, la perte et le
profit s’équilibrent éternellement, et plus se creuse l’abîme entre les
limitations toujours plus nombreuses qu’impose la communauté et la liberté
primitive, plus s’aggrave la méfiance de l’âme individuelle ; elle se demande
si, au fond, elle n’est pas spoliée par le progrès, et si la socialisation du
Moi ne la frustre pas de son Moi le plus profond.
L’humanité
réussira-t-elle jamais, continue Freud, en s’efforçant de percer l’avenir, à
maîtriser définitivement cette inquiétude, ce dualisme, ce déchirement de son âme
? Désorientée, hésitant entre la crainte de Dieu et la jouissance animale,
entravée par les interdictions, accablée par la névrose de la religion,
trouvera-telle une issue à ce dilemme de sa civilisation ? Les deux puissances originelles,
l’instinct agressif et l’instinct sexuel, ne se soumettront elles pas enfin
volontairement à la raison morale et ne pourrons-nous pas, plus tard,
définitivement écarter comme superflue l’« hypothèse utilitaire » du Dieu qui
juge et qui châtie ? L’avenir – pour parler en psychanalyste – surmontera-t-il
ce conflit affectif le plus secret en le mettant à la lumière de la conscience
? S’assainira-t-il complètement un jour ?
Question
dangereuse. Car en se demandant si la raison pourra devenir maîtresse de notre
vie instinctive, Freud se voit acculé à une lutte tragique. D’une part, on le sait,
la psychanalyse nie la domination de la raison sur l’inconscient : « Les
hommes, dit-elle, sont peu accessibles aux arguments de la raison, ils sont mus
par leurs instincts », et cependant elle affirme, d’autre part, « que nous
n’avons pas d’autre moyen que notre intelligence pour dominer notre vie
instinctive ». Comme doctrine théorique la psychanalyse combat pour la
prédominance des instincts et de l’inconscient ; comme méthode pratique elle
voit dans la raison l’unique moyen de salut pour l’homme et par conséquent pour
l’humanité.
Depuis
longtemps se cache au fond de la psychanalyse cette contradiction secrète ; maintenant,
proportionnellement à l’ampleur de l’examen, elle s’enfle démesurément : Freud
à présent devrait prendre une décision définitive ; c’est justement ici, dans le
domaine philosophique, qu’il devrait se prononcer pour la prépondérance de la
raison ou celle de l’instinct. Mais pour lui, qui ne sait pas mentir et
toujours se refuse à se mentir à lui-même, ce choix est terriblement difficile.
Comment conclure ?
Le
regard bouleversé, le vieil homme vient de voir confirmer sa théorie de la
domination des instincts sur la raison consciente par la psychose collective de
la guerre mondiale : jamais on ne s’était rendu compte aussi sinistrement qu’en
ces quatre années apocalyptiques combien est encore mince la couche de
civilisation qui cache la violence de nos instincts sanguinaires, et comme une
seule poussée de l’inconscient suffit à faire crouler tous les édifices audacieux
de l’esprit et tous les temples de la morale. Il a vu sacrifier la religion, la
culture, tout ce qui ennoblit et élève la vie consciente de l’homme, à la jouissance
sauvage et primitive de la destruction ; toutes les puissances saintes et
sanctifiées se sont trouvées une fois de plus d’une faiblesse enfantine en face
de l’instinct sourd et assoiffé de sang de l’homme primitif. Et pourtant,
quelque chose en Freud se refuse à reconnaître comme définitive cette défaite morale
de l’humanité. Car à quoi bon la raison, à quoi bon avoir lui-même servi
pendant des décennies la science et la vérité, si en fin de compte toute prise
de conscience de l’humanité doit quand même rester impuissante contre son
inconscient ?
Incorruptiblement
honnête, Freud n’ose nier ni la puissance active de la raison ni la force incalculable
de l’instinct. Aussi, pour finir, répond-il prudemment à la question qu’il
s’est posée – envisageant ainsi un « troisième royaume » de l’âme – par un
vague « peut-être », « peut-être qu’un jour très lointain » ; car il ne
voudrait pas, après ce tardif voyage, retourner en lui-même sans la moindre
consolation.
Il
est émouvant d’entendre sa voix toujours si sévère devenir conciliante et
douce, lorsque maintenant, au soir de sa vie, il veut montrer à l’humanité, au
bout de sa route, une petite lueur d’espoir : « Nous pouvons continuer à dire avec
raison que l’intellect humain est faible en comparaison des instincts. Mais
cette faiblesse est chose singulière ; la voix de l’intellect est basse, mais
elle ne cesse pas tant qu’elle ne s’est pas fait entendre. À la fin, après
d’innombrables échecs, elle y réussit quand même. C’est un des rares points sur
lesquels on peut être optimiste pour l’avenir de l’humanité, mais il ne
signifie pas peu de chose en soi. Le primat de l’intellect se trouve, certes,
dans une région lointaine, mais probablement pas inaccessible. »
Ce
sont là des paroles merveilleuses. Mais cette petite lueur dans l’obscurité
vacille pourtant
dans un lointain trop vague pour que l’âme
interrogatrice, glacée par la réalité, puisse s’y réchauffer. Toute « probabilité
» n’est qu’une mince consolation, et aucun « peut-être » n’étanche la soif
inapaisable de foi en des certitudes suprêmes.
Ici
nous nous trouvons devant la limite infranchissable de la psychanalyse : là où
commence le royaume des croyances intérieures, de la confiance créatrice, sa
puissance finit ; consciemment désillusionniste et ennemie de tout mirage, elle
n’a pas d’ailes pour atteindre ces régions élevées. Science exclusive de l’individu,
de l’âme individuelle, elle ne sait rien et ne veut rien savoir d’un sens
collectif ou d’une mission métaphysique de l’humanité : c’est pourquoi elle ne
fait qu’éclairer les faits psychiques et ne réchauffe pas l’âme humaine. Elle
ne peut donner que la santé, mais la santé seule ne suffit pas.
Pour
être heureuse et féconde, l’humanité a besoin d’être sans cesse fortifiée par
une foi qui donne un sens à sa vie. La psychanalyse ne recourt ni à l’opium des
religions, ni aux extases
grisantes des promesses dithyrambiques de Nietzsche, elle n’assure
ni ne promet rien, elle préfère se taire que consoler. Cette sincérité engendrée
entièrement par l’esprit sévère et loyal de Sigmund Freud est admirable sous le
rapport moral. Mais à tout ce qui n’est que vrai se mêle inévitablement un
grain d’amertume et de scepticisme, sur tout ce qui n’est que raison et analyse
plane une certaine ombre tragique. Indéniablement il y a dans la psychanalyse
quelque chose qui sape le divin, quelque chose qui a un goût de terre et de
cendres ; comme tout ce qui n’est qu’humain, elle ne rend pas libre et joyeux ;
la sincérité peut admirablement enrichir l’esprit, mais jamais satisfaire
totalement le sentiment, jamais enseigner à l’humanité à « se dépasser », ce
qui est la satisfaction la plus folle, et pourtant la plus nécessaire.
L’homme
– qui l’a prouvé plus magnifiquement que Freud ? – ne peut, même dans le sens
physique, vivre sans rêve, son corps frêle éclaterait sous la pression des
sentiments irréalisés ; comment alors l’âme de l’humanité supporterait-elle
l’existence sans l’espoir d’un sens plus élevé, sans les rêves de la foi. C’est
pourquoi la science peut sans cesse lui démontrer la puérilité de ses créations
divines, toujours, pour ne pas tomber dans le nihilisme, sa joie de créer
voudra donner un sens nouveau à l’univers, car cette joie de l’effort est déjà
en elle-même le sens le plus profond de toute vie spirituelle.
Pour
l’âme affamée de croyance, la froide et lucide raison, la rigueur, le réalisme
de la psychanalyse n’est pas un aliment. Elle apporte des expériences, sans
plus ; elle peut donner une explication des réalités, mais non de l’univers,
auquel elle n’attribue aucun sens. Là est sa limite.
Elle
a su, mieux que n’importe quelle méthode spirituelle antérieure, rapprocher
l’homme de son propre Moi, mais non pas – ce qui serait nécessaire pour la satisfaction
totale du sentiment – le faire sortir de ce Moi. Elle analyse, sépare, divise,
elle montre à toute vie son sens propre, mais elle ne sait pas regrouper ces
mille et mille éléments et leur donner un sens commun. Pour être réellement créatrice,
il faudrait que sa pensée, qui éclaire et décompose, fût complétée par une
autre qui rassemblerait et ferait fusionner – après la psychanalyse, la psycho-synthèse
– chose qui sera peut-être la science de demain. Quel que soit le chemin
parcouru par Freud, plus loin que lui de vastes espaces restent à explorer.
Maintenant
que l’art d’interprétation du psychanalyste a montré à l’âme les entraves
secrètes qui arrêtent son essor, d’autres pourraient lui parler de sa liberté,
lui apprendre à sortir d’elle-même et à rejoindre le Tout universel.
IX : La portée dans le temps
L’individu
qui naît de l’Un et du Multiple et qui, dès sa naissance, porte en soi tant le
défini que l’indéfini – nous ne voulons point le laisser s’évanouir dans
l’illimité avant d’avoir revu toutes ses catégories de représentations qui font
l’intermédiaire entre l’Un et le Multiple.
Deux
découvertes d’une simultanéité symbolique se produisent dans la dernière
décennie du XIXe siècle : à Wurtzbourg, un physicien peu connu, du nom de Wilhelm
Roentgen, prouve par une expérience inattendue la possibilité de voir à travers
le corps humain considéré jusqu’alors comme impénétrable. À Vienne un médecin aussi
peu connu, Sigmund Freud, découvre la même possibilité pour l’âme. Les deux
méthodes non seulement modifient les bases de leur propre science, mais
fécondent tous les domaines voisins ; par un
croisement remarquable, le médecin tire profit de la
découverte du physicien, et celle du médecin enrichit la psychophysique, la doctrine
des forces de l’âme.
Grâce
à la découverte grandiose de Freud, dont les résultats, aujourd’hui encore,
sont loin d’être épuisés, la psychologie scientifique dépasse enfin les limites
de son exclusivité académique et théorique et entre dans la vie pratique. Par
elle, la psychologie comme science devient pour la première fois applicable à
toutes les créations de l’esprit.
Car
la psychologie de jadis, qu’était-elle ? Une matière scolaire, une science
théorique spéciale, emprisonnée dans les universités et les séminaires,
engendrant des livres aux formules illisibles et insupportables. Celui qui
l’étudiait n’en savait pas plus sur lui-même et ses lois individuelles que s’il
avait étudié le sanscrit ou l’astronomie, et le grand public, par un juste
instinct, considérait ses résultats de laboratoire comme sans portée, parce que
totalement abstraits.
En faisant
passer d’un geste décisif l’étude de l’âme du théorique à l’individuel, et en
faisant de la cristallisation de la personnalité un objet de recherches, Freud transporte
la psychologie scolaire dans la réalité et la rend d’une importance vitale pour
l’homme, puisque désormais applicable. À présent seulement la psychologie peut
assister la pédagogie dans la formation
de l’être humain grandissant ; coopérer à la guérison du malade ; aider au
jugement du dévoyé en justice ; faire comprendre les créations artistiques, et,
en même temps qu’elle cherche à expliquer à chacun son individualité toujours unique,
elle vient en aide à tous. Car celui qui a appris à comprendre l’être humain en
lui-même le comprend en tous les hommes.
En
orientant ainsi la psychologie vers l’âme individuelle, Freud a inconsciemment
délivré la volonté la plus intime de l’époque. Jamais l’homme ne fut plus
curieux de son propre Moi, de sa personnalité, qu’en notre siècle de monotonisation croissante de la vie extérieure. Le siècle
de la technique uniformise et dépersonnalise de plus en plus l’individu dont il
fait un type incolore ; touchant un même salaire par catégorie, habitant les
mêmes maisons, portant les mêmes vêtements, travaillant aux mêmes heures, à la
même machine, cherchant ensuite un refuge dans le même genre de distraction,
devant le même appareil de T. S. F., le même disque phonographique, se livrant aux
mêmes sports, les hommes sont extérieurement, d’une manière effrayante, de plus
en plus ressemblants ; leurs villes aux mêmes rues sont de moins en moins intéressantes,
les nations toujours plus homogènes ; le gigantesque creuset de la
rationalisation fait fondre toutes les distinctions apparentes.
Mais
cependant que notre surface est taillée en série et que les hommes sont classés
à la douzaine conformément au type collectif, au milieu de la
dépersonnalisation progressive des modes de vie, chaque individu apprécie de
plus en plus l’importance de la seule couche vitale de son être inaccessible et
qui échappe à l’influence du dehors : sa personnalité unique et impossible à
reproduire. Elle est devenue la mesure suprême et presque unique de l’homme, et
ce n’est point un hasard si tous les arts et toutes les sciences servent
maintenant si passionnément la caractérologie. La doctrine des types, la
science de la descendance, la théorie de l’hérédité, les recherches sur la
périodicité individuelle s’efforcent de séparer toujours plus systématiquement
le particulier du général ; en littérature la biographie approfondit la science
de la personnalité ; des méthodes d’examen de la physiognomonie intérieure,
comme l’astrologie, la chiromancie, la graphologie, qu’on
croyait mortes depuis longtemps, s’épanouissent de nos
jours d’une façon inattendue. De toutes
les énigmes de l’existence aucune n’importe autant à l’homme d’aujourd’hui que
la révélation de son être et de son propre développement, que les conditions spéciales
et les particularités uniques de sa personnalité.
Freud
a ramené à ce centre de vie intérieure la science psychique devenue abstraite.
Pour la première fois il a développé, en atteignant une grandeur poétique,
l’élément dramatique de la cristallisation de la personnalité humaine, ce
va-et-vient ardent et trouble de la région crépusculaire entre le conscient et l’inconscient,
où le choc le plus infime engendre les conséquences les plus vastes, où le
passé se rattache au présent par les enchevêtrements les plus singuliers,
véritable cosmos dans la sphère étroite du sang et du corps, impossible à
embrasser du regard dans son ensemble et cependant beau à contempler comme une œuvre
d’art dans son insondable conformité aux lois internes.
Mais
les lois gouvernant un homme – c’est là le bouleversement radical apporté par
sa doctrine – ne peuvent jamais être jugées d’après un schéma courant ; il faut
qu’elles soient expérimentées, éprouvées et reconnues de ce fait comme valeurs uniques.
On ne peut pas comprendre une personnalité au moyen d’une formule rigide, mais
uniquement et exclusivement par la forme de son destin, découlant de sa propre
vie : c’est pourquoi toute cure médicale, toute aide morale suppose avant tout chez
Freud le savoir et notamment un savoir affirmatif, sympathisant et par là
vraiment intuitif.
Le commencement
obligatoire de toute science et de toute médecine psychique est pour lui le
respect de la personnalité, ce « mystère révélé », selon le sens goethéen ; ce
respect, Freud, comme personne d’autre, a enseigné à le révérer en tant que
commandement moral. Par lui seul des milliers et des centaines de milliers
d’êtres ont compris pour la première fois la fragilité de l’âme, en particulier
de l’âme infantile ; à la vue des blessures dévoilées par lui, ils ont commencé
à se rendre compte que tout geste grossier, toute intervention brutale (il suffit
parfois d’un seul mot) dans cette matière super-délicate, douée d’une force
mystérieuse de ressouvenance, peut détruire un destin ; que, par conséquent,
toute menace, interdiction, punition ou correction irréfléchie charge son auteur
d’une responsabilité inconnue jusqu’ici.
Le
respect de la personnalité, même dans ses erreurs, c’est ce que Freud a
introduit toujours plus profondément dans la conscience d’aujourd’hui, à
l’école, à l’église, au tribunal, ces refuges de la rigueur ; par cette vision meilleure
des lois psychiques il a propagé dans le monde une délicatesse et une
indulgence plus grandes. L’art de se comprendre mutuellement, le plus important
dans les relations humaines, et celui qui est de plus en plus nécessaire entre les
nations, le seul en somme qui puisse nous aider dans la construction d’une
humanité supérieure, cet art n’a profité d’aucune méthode actuelle ayant trait au
domaine de l’esprit autant que de la doctrine freudienne de la personnalité ;
grâce à Freud on s’est rendu compte pour la première fois dans un sens nouveau
et actif de l’importance de l’individu, de la valeur unique et irremplaçable de
toute âme humaine. Il n’y a pas en Europe, dans tous les domaines de l’art, de
l’étude, des sciences vitales, un seul homme important dont les conceptions ne
soient directement ou indirectement, bon gré, mal gré, influencées d’une
manière créatrice par les idées de Freud : partout cet homme isolé a atteint le
centre de la vie – l’humain. Et tandis que les spécialistes continuent à ne pas
pouvoir s’incliner devant le fait que cette œuvre n’est pas rigoureusement
conforme aux règles de l’enseignement médical, philosophique ou autre, tandis
que les savants officiels disputent encore furieusement à propos de détails et de
finalités, la théorie de Freud a fait depuis longtemps ses preuves et s’est
montrée irréfutablement vraie – vraie dans le sens créateur, selon le mot
inoubliable de Goethe :
«
Seul ce qui est fécond est vrai. »